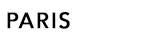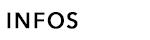|
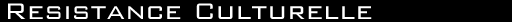

Refonder les Politiques Culturelles Publiques
Par Jean-Louis Sagot-Duvauroux
Une
grosse fatigue s’est abattue sur l’appareil culturel public français,
si prometteur à ses débuts, si abondant. Par quelle alchimie un système
pensé et financé pour répandre les joies de l’esprit dans toutes les
classes de la société s’éloigne-t-il si opiniâtrement de son objectif
originel ? A moins qu’il soit devenu récif et que l’histoire, les
histoires s’en soient allées ailleurs. Des politiques culturelles
accordées aux mondes qui naissent ? Des outils propices à la
rencontre des imaginaires plutôt qu’à la célébration nostalgique
du vieil art ? Les réseaux remplaçant les podiums ? Le bouleversement
est souhaitable. Le naufrage est possible.
« Chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir ». Frantz Fanon
La refondation des politiques culturelles publiques est confrontée à deux enjeux majeurs :
1 – L’agonie du cycle historique de la modernité occidentale.
2 – L’héritage d’un appareil culturel d’Etat construit dans et pour ce cycle agonisant.
Elle nécessite une claire remise à plat des institutions et du projet.
"LA FIN D’UNE HISTOIRE
Engagée au XVe siècle, la modernité occidentale est le projet de
civilisation qui accompagne la conquête de la planète par les nations
« blanches ». L’empire unique impose au monde une histoire
unique, centralisée, hiérarchisée, racialisée, représentée comme un
vecteur tendu vers un progrès continu, vers un gain (une
capitalisation) sans limite. Le vecteur a une pointe, l’Occident (les
nations « avancées »). Les autres sont qualifiés de pays
« les moins avancés » (reculés ?), « en
développement » (vers quoi ?), « émergents » (à
quoi ?). Leur destin serait au mieux le « rattrapage ».
Le moyen du « rattrapage » est la participation à la
mécanique du gain sans limite.
Les philosophies occidentales de l’histoire formalisent cet univers de
représentations. Le rationalisme des Lumières ou l’imperturbable
dialectique hégélienne arriment le monde à la locomotive de l’Occident
et nomment « néant » ce que leurs yeux aveuglés par la
victoire ne voient pas. L’Afrique vaincue serait néant, néant
d’histoire, éternel recommencement, cliché si puissant qu’encore
récemment Nicolas Sarkozy le servait innocemment à des étudiants
dakarois. Cette « génétique » de l’histoire unique est encore
présente chez Marx, surtout dans la vulgate qu’en tire le mouvement
communiste. Certes, la dialectique marxiste s’entrouvre aux vents frais
de la pratique et les « luttes de libération nationale » sont
considérées comme parties prenantes du combat contre le capitalisme
impérialiste. Mais elle lit toujours dans la position historique des
classes ouvrières occidentales sous exploitation de l’industrie
capitaliste la dernière marche avant l’avènement du socialisme, puis de
la société sans classe, le GPS des autres exploités.
Cette configuration de l’histoire est dans l’impasse.
Impasse écologique du progrès continu aujourd’hui représenté par l’obsession du PIB marchand décrété clef du bien être.
Echec social de la mécanique du gain sans limite aujourd’hui
représentée par le capitalisme financiarisé placé en maître des lois.
Délitement de l’empire unique représenté par une domination occidentale
ébréchée qui désormais dispute sa viande avec la Chine communiste et
son orgueil avec l’autonomisation des autres mondes.
C’est par référence à ces trois enjeux historiques et planétaires que
toute politique transformatrice prend sens, rend ses objectifs visibles
et potentiellement convaincants, politique sociale, politique
économique, politique institutionnelle, politique internationale,
politique culturelle. Si ces enjeux sont noyés dans la brume, morcelés
en mesures quantitatives de circonstance, floutés par les échéances
électorales, ils sont vécus comme de menaçants fantômes, provoquent la
peur, enfantent la soumission ou le chaos. L’émancipation politique les
met en lumière et les travaille. Elle inscrit explicitement ses
propositions et ses actions dans la perspective de leur dépassement.
Dans son champ, la refondation des politiques culturelles publiques
vient en réponse à ces enjeux. Elle y contribue pour une part
essentielle. Elle accélère potentiellement la production des univers
symboliques, des signes, des mots indispensables à la naissance d’une
conscience sociale échappant au désarroi. Elle apporte la puissance de
l’action publique à celles et ceux qui rompent la fermeture imaginaire
de l’histoire. Elle apporte ses outils à l’auto-production de notre
commune humanité sur les chemins inédits qui se présentent devant elle.
Elle ouvre le chantier de la grande place publique où les humains
d’aujourd’hui pourront dire, chanter, penser, inventer des mondes
hospitaliers et habitables.
CE QUI EST EN TRAIN DE MOURIR
L’histoire culturelle et artistique de l’Occident n’a pas échappée au cadrage imposé par les desseins de l’empire.
En France, le système culturel public actuellement en service, un des
plus développés dans le monde, a deux sources. La première est une
vieille tradition étatique et nationale, incarnée au XXe siècle par le
gaullisme, qui lie spontanément la grandeur du pays à l’intervention
publique dans le champ des arts.
La seconde a été portée par le mouvement ouvrier, avec l’idée que la
culture était un outil d’émancipation. Cette orientation a été secouée
par les contradictions propres au mouvement communiste, émancipateur
dans le principe, dictatorial sous sa forme soviétique. Effloraison
artistique des années qui suivirent la révolution d’octobre. Couvercle
du stalinisme. Le jdanovisme, l’obligation faite aux artistes, aux
penseurs, aux écrivains d’illustrer la ligne du parti, la répression
qui dans l’aire soviétique s’abattait sur les récalcitrants ont
provoqué dans cette lignée politique une saine réaction, exprimée en
France lors du fameux « comité central d’Argenteuil » (1966)
inspiré par Louis Aragon. La reconnaissance de l’autonomie des
inventeurs d’imaginaires nouveaux en fut un bon fruit. Il contribua
puissamment à la mise en place d’institutions culturelles nombreuses et
bien dotées. Dans les collectivités territoriales dirigées par des
communistes, la foi dans l’accession de tous aux richesses de l’esprit
connut un véritable assentiment populaire. L’électeur n’y renâclait pas
à la construction d’un théâtre. Toutes les politiques culturelles
publiques, de droite comme de gauche, en furent influencées.
Revers de la médaille, cette « libéralisation » tétanisa
toute critique portant sur les processus de production du champ
symbolique, sur les paradigmes selon lesquels il se disait, sur les
acteurs et les actions de la liberté de création. Rien ne devait
écorner la foi nouvelle dans l’autonomie de l’art. Elle contribua à une
fétichisation de l’activité artistique, momentanément efficace pour en
protéger la liberté, mais qui portait à terme, dans son principe,
l’éloignement d’avec la vie. La dévotion due au sacrement et le respect
inspiré par son clergé empêchaient de discerner l’empreinte de l’empire
au cœur même des dispositifs de « démocratisation
culturelle ».
Maintenant que l’empire est rongé par la lèpre, si l’on souhaite que
l’humanité ne finisse pas avec cette « fin de l’histoire »,
il faut désigner sans détour les stigmates paralysants laissés par
cette empreinte sur la vie artistique et culturelle.
Histoire unique
Donc, avec les formes qu’elle a prises dans l’histoire occidentale,
l’invention du champ symbolique aurait trouvé sa voie, sa structuration
et ses paradigmes universels : art, artistes, professionnalisation,
CDN, musées… Il faudrait s’y soumettre pour espérer pouvoir entrer dans
la conversation et accéder aux dispositifs culturels institués. La
récupération des dissidents est aussi possible : le douanier
Rousseau, certains groupes de danse hip hop, quelques compagnies d’arts
de la rue, le photographe malien Seydou Keïta… Il y a des musées
consacrés au patrimoine des arts non-Blancs. Mais ça reste sourdement
subalterne et sans effet sur la structuration du système, qui s’en
trouve même conforté. Fondamentalement, même accompagnée de stimulantes
historiettes, il y aurait « une » histoire de l’art comme il
y aurait « une » histoire de l’humanité. Ou pour le dire
autrement, il y aurait un moule unique permettant aux événements et aux
arts de faire histoire. Par une miraculeuse
coïncidence, l’histoire des constructions symboliques remarquables
avancerait du même pas que celle de l’empire.
Même si elle ne tient plus la route, cette conception tient toujours le haut du pavé.
Histoire progressive
L’histoire unique « progresse » et le champ des arts doit lui
emboîter le pas. Il n’est pourtant pas vraiment propice à cette
représentation très quantitative : les demoiselles d’Avignon
sont-elles « plus » que la Joconde ou l’Apollon du
Belvédère ? Le critère retenu pour adapter l’idée de progrès à
l’art et au jugement esthétique consiste à déterminer en quoi tel
artiste, en quoi telle œuvre font « avancer » l’histoire de
cet art, en quoi ils « font histoire » et ajoutent ainsi un
supplément, un gain à l’âme de l’empire. Chaque art poursuit cette voie
selon une ligne historiographique hors de laquelle ne survivent
que des œuvres et des artistes « mineurs ».
Par exemple, en musique, le vecteur est la sophistication
croissante et la libération de l’harmonie (Palestrina, Monteverdi,
Bach, Beethoven, Wagner, Schoenberg, point final). Dans les arts
plastiques, c’est l’ouverture progressive des règles de la
représentation (Cimabue, Masaccio, Le Caravage, Courbet, Monet,
Picasso, Malevitch, Duchamp, point final). Le XXe siècle est le siècle
du point final (la dodécaphonie, l’art conceptuel, la prise de pouvoir
de la mise en scène sur le théâtre…) Avant même que l’épuisement de
l’empire ne devienne manifeste, les points finals auxquels aboutissent
les artistes du XXe siècle indiquent que la limite de l’histoire unique
est atteinte, qu’elle ne trouve plus de figure crédible pour se
représenter, que tout désormais est permis. Les histoires multiples et
singulières qui surgissent de cette permission s’autonomisent
nécessairement, se désarriment de l’histoire unique, en désamorcent le
concept. Ernest Pignon-Ernest, Jean-Michel Basquiat, Jeff Koons ou
Takashi Murakami racontent chacun des histoires singulières qu’on peu
difficilement aligner sur un même vecteur, même si subsiste la
tentation de se glisser malgré tout d’une manière ou d’une autre dans
le corset défraichi de l’histoire unique, de bénéficier ainsi des fonds
publics ou privés, des honneurs et des références que distribuent
encore les institutions faites par l’histoire unique et pour elle. Le
commerce des marchands d’art dépend beaucoup des fictions imaginées
pour référer coûte que coûte les artistes-maison à la
« grande » histoire.

Autoréférencement.
Les « avancées » de l’histoire unique se jugent
nécessairement en référence au déjà-là de l’histoire unique. Il y a une
logique interne, autoréférencée, dans la séquence
Delacroix-Courbet-Manet-Monet-Cézanne. Cet autoréférencement demande
des savoirs de plus en plus spécialisés, endogamiques, savants,
aristocratiques qui excluent progressivement le grand nombre. En
théâtre, l’irruption au XXe siècle de la mise en scène est en partie
parvenue à « autoréférencer » un art qui y échappait à peu
près, par le fait qu’il raconte, comme la plupart des arts du texte,
des histoires sur lesquelles le tout venant a toujours un certain
savoir (des références liées au flux de la vie et non à l’histoire de
l’art), du fait aussi que ce récit passe à travers la médiation de
corps, de visages, de voix auxquels chacun peut s’identifier. Mais le
Tartuffe de Molière devenu le Tartuffe de Tartempion n’est plus
« une pièce sur l’hypocrisie » où on a vu jouer « une
jeune actrice tellement émouvante ». Il devient une démonstration de la
capacité de Tartempion à déconstruire le texte et l’artiste et à
élargir ainsi la palette intellectuelle du happy few. Aujourd’hui, cela
seul ouvre le droit de monter sur les scènes de l’institution. La
question ne porte pas ici sur l’intérêt certain de l’invention de la
mise en scène, mais sur la façon si accordée à la domination de
l’empire unique par laquelle, dans le milieu qui l’a enfantée et qui
dirige l’institution, cet art plein de ressources surplombe tous les
autres critères d’appréciation existants où à naître
Une des images magiques
de notre ami Claude Baillargeon, décédé ce printemps. Un hommage à cet
artiste modeste qui ne craignait pas de produire des évidences
graphiques tellement pensées et si généreusement données.
Fétichisation
Peu à peu, l’histoire unique a produit une représentation fétichisée
des œuvres, considérées comme portant en elles-mêmes leur valeur,
indépendamment de la nature des événements sociaux qu’elles provoquent
et sans lesquels, pourtant, elles ne sont que « de la
merde », pour reprendre une figure psychanalytique de l’argent. Un
tableau de maître dans un coffre-fort n’est rien, sinon une
« valeur » financière au même titre qu’une action dans une
marque de choucroute ou un détournement de fonds (de fond ?),
c’est-à-dire « de la merde ». Cette sacralisation des
œuvres s’est accompagnée d’une sacerdotalisation des artistes, ordonnés
médiateurs de l’inspiration sacrée. Cette évolution a largement
dispensé les politiques publiques de se porter sur la nature des
événements sociaux qui se nouent autour des œuvres. Abandonnés à la
supposée magie de l’art, beaucoup d’événements où l’art se produit sont
peu à peu colonisés par un public prédestiné, beaux esprits disposant
des clefs de l’autoréférencement (vieux), à l’aise dans les lignées
artistiques de l’histoire unique (Blancs), aptes à s’acquitter des
tarifs « normaux » censés « valoriser » les œuvres
(aisés). De la catégorie « Optima », la plus cossue, en
descendant jusqu’à la 5e catégorie, les places de l’Opéra de Paris sont
proposées pour des prix situés au dessus des 100€. Au Festival
d’Avignon, le tarif « normal » pour une représentation à la
cour d’honneur est de 38€. L’opéra et le festival sont pour une part
très majoritaire financés par la subvention, c’est-à-dire par le
contribuable. Fabriques de la classe dominante au frais de la nation.
Obnubilation marchande
Les propagandistes des tarifs interdits au commun des mortels ont à la
bouche deux obsédants refrains. Premier refrain : « Personne
n’accordera de valeur à cette œuvre de valeur si son tarif ne signale
pas sa valeur ». Pourtant, l’expérience quotidienne de 100 % des
humains les conduit à penser que ce qui est « sans prix » a
davantage de valeur que ce qui peut s’évaluer monétairement. Les
plaisirs que s’échangent les amoureux sont sans prix, ce qui n’empêche
pas que le sexe tarifé soit une option possible. La National Gallery
est d’accès gratuit, ce qui ne conduit pas les Britanniques à croire
que la Vierge aux rochers qu’on y voit ait moins de valeur que sa
version présentée au Louvre moyennant les 15€ du billet d’entrée.
Second refrain : « Les gens payent bien 100 € pour aller
écouter Johnny Halliday ». Oui, mais justement, ce que les
amateurs de ce bon chanteur aiment est un « produit » dont la
saveur est connue, vantée, largement diffusée à moindre frais en dehors
de ses concerts dispendieux, un produit commercial (le mot ne vaut pas
condamnation). Son prix s’évalue en fonction de la raison marchande,
qui fait aussi partie de notre vie. Ceux qui se rendent à un concert de
Johnny « se l’offrent » comme un cadeau exceptionnel, isolé,
comme on s’offre de temps à autre une bouteille de champagne même si ça
doit peser sur le budget familial. Cet événement respectable et coûteux
n’a pas grand-chose à voir avec la pratique régulière du théâtre, ni
avec ce qu’on peut en attendre, ni d’ailleurs avec les justifications
souvent pertinentes que nous servent ceux-là mêmes qui fixent ses
copieux tarifs. Emettons la thèse que l’appareil culturel d’Etat n’a
pas pour vocation d’ajouter aux féries de la grande distribution
culturelle des Fauchon de l’art.
L’absurde alignement de l’intervention publique sur les échelles du pur
marché a un rapport avec l’étroit cousinage qui unit la fétichisation
des œuvres d’art et la fétichisation de la marchandise, si justement
décrite par Karl Marx, objets circulants, évaluables sur une échelle
unique, en version sublime pour l’art, en version triviale pour la
marchandise. Il s’agit par cette fétichisation, cet éblouissement, cet
aveuglement, de camoufler les rapports de classes, les rapports de
domination sous l’illusion que par nature un billet de banque ou qu’une
estampe japonaise auraient un prix. Aux impécunieux, ce système de
classe dit : « Si ta force de travail ne se vend pas assez
cher pour te permettre des samedis soirs à 100 € par personne,
plains-toi à la Providence, pauvre pignouf ». A ceux qui acceptent
d’adopter le régime-panzani les cinq derniers jours du mois pour
pouvoir écouter Johnny en direct-live, le commerce de l’art dit tout
simplement merci.
Le sens de la vie est sans prix. Revendiquer le droit à une vie qui ait
du sens freine les cotations boursières et révulse le néo-management.
L’obnubilation marchande dans les politiques culturelles publiques
participe à créer une atmosphère favorable à l’idée que la régulation
par le marché est la meilleure possible, thèse centrale du libéralisme
économique qu’on peut raisonnablement considérer comme plutôt favorable
aux riches. Pourtant, même entendre en direct-live la voix de Johnny
laisse des traces que les échelles du marché sont inaptes à évaluer. Et
analyser les stratégies commerciales des galeries d’art montre comment
et pourquoi l’illusion de l’histoire unique est artificiellement
maintenue en vie. Le marché a et gardera longtemps sa part dans la
production et la distribution des œuvres. L’intervention publique n’a
de légitimité et de sens que si elle construit face à ce pesant pouvoir
un contrepoids fondé sur l’intérêt public, c’est-à-dire sur des
logiques tout autres.
Toute politique culturelle publique pour le XXI siècle est à la fois un
choix politique et un choix de civilisation. Mettre en œuvre la
transition vers le remplacement de l’histoire unique, de l’empire
unique par la multiplication des histoires singulières et leur mise en
conversation est un choix politique central, un choix de civilisation.
Obsolescence de l’appareil culturel d’Etat
L’appareil culturel d’Etat (le service public de la culture, ses
institutions, ses dispositifs, ses réseaux de pouvoir et de
financement) a été construit dans un temps où l’actuelle révolution du
monde était impensable. La chute du soviétisme ? Impensable. Les
menaces du « progrès » contre la planète ? Indicible. La
mise en cause du rôle dirigeant des classes ouvrières des pays
« avancés » dans tous les champs d’émancipation
possible ? Hérétique. Une France populaire massivement
multicolore ? Burlesque. La Chine communiste premier producteur
mondial de richesse marchande ? Anathème. Par la force de
l’histoire, l’appareil culturel d’Etat a été voulu et pensé, souvent
sans malice, de telle sorte qu’il assure la perpétuation de l’histoire
culturelle unique et éventuellement l’accès des masses (les masses du
centre de l’empire) à ses joies. En dépit de ses dénégations
généralement sincères, cet appareil a toutes les caractéristiques de
l’empire : hiérarchisé, racialisé, genré, administré, soumis à la
mesure de tout par le prix… Et même quand il entend le monde et ses
peuples contester l’empire déclinant qui le modèle, il ne sait pas
comment faire pour servir ce qui émerge, parce qu’il n’est pas fait
pour les temps nouveaux.
Toute politique culturelle publique est placée devant le choix de
refonder la structuration des instruments mis à la disposition de la
vie culturelle et artistique par la puissance publique.
LE TEMPS DU TUILAGE
Nous vivons le temps du tuilage, un temps où l’encore-en-service et le
déjà-là coexistent. L’encore-en-service occupe le champ de vision parce
qu’il est pour l’instant maître des évidences. Les repères du passé
donnent sens à chacune de ses manifestations. Le déjà-là ne fait pas
encore sens. Il est fait de germes éparpillés, de nourrissons
trébuchants, bavants, touchants néanmoins, mais dont une proportion non
négligeable est vouée à la roulette russe de la mortalité infantile et
à l’ironie désabusée du vieil art. Il cohabite nécessairement avec des
manifestations de l’esprit nées sous l’ancien paradigme et dont la
grâce, l’intelligence, la sensibilité, la sophistication sont
indéniables. Aux esprits qui ont faim (et qui ont les moyens de leur
faim), les germes terreux peuvent paraître bien peu roboratifs en
comparaison des rôts servis à la table de l’ancien monde.
La décrépitude en cours de l’histoire unique ne disqualifie pas les
trésors culturels qui ont été produits sous ce régime, ni l’importance
de l’éducation qui permet de s’y repérer et d’en juger, ni les joies de
l’esprit qu’éprouve un Africain ou un Chinois à visiter le Louvre, ni
la nécessité pour toute politique culturelle publique de préserver et
de répandre ce splendide héritage. Un indigent conduit par une bonne
âme ou par un élan du cœur à franchir les intimidations matérielles et
symboliques qui protège le Temple pourra en goûter lui aussi les
sacrements et en jouir. Mais la configuration de l’histoire humaine
dans laquelle ont éclos et continuent à éclore tant de chefs d’œuvres
agonise comme agonise l’empire auquel elle est intimement liée. D’une
agonie menaçante.
En France, la faveur que connaît l’extrême droite Front national naît
d’une difficulté à dissocier de sa représentation impériale et
racialisée l’attachement si naturel des habitants de France au sol de
France, à son l’histoire et à la communauté humaine qui la fait. Dans
un monde équilibré où la richesse serait équitablement partagée, la
France serait non la 6e, mais la 21e puissance économique du monde
puisqu’elle est au 21e rang pour le nombre d’habitants. Plus personne
ne prendrait le risque de se noyer dans la Méditerranée pour échapper
au vertigineux déséquilibre économique hérité du colonialisme et nous
vivrions tous mieux. L’imaginaire construit par l’histoire unique rend
cet objectif si rationnel presqu’impossible à inscrire dans un
programme politique.
L’institution culturelle, conformée par cette histoire, devient peu à
peu et à son corps défendant un des congélateurs de cet imaginaire
périmé. Principal symptôme : elle montre partout son incapacité
croissante à dessiner des perspectives répondant pour notre temps aux
objectifs de démocratisation qui avaient pourtant présidé à sa mise en
place et qu’en dépit des faits, elle persiste à invoquer. Dans son
rapport avec les autres mondes, une charitable arrogance la pousse à un
apostolat stérilisant : nous allons vous apprendre les bonnes pratiques
qui sont les nôtres. La raison de ces impuissances loge dans une
incapacité devenue structurelle à remplir la mission centrale, le
« cœur de métier » d’un service public culturel accordé à
l’ère qui naît : être une fabrique d’un imaginaire partagé en mesure
d’apporter des mots, de l’humanité, de la vie, de la conscience de soi
à la transition post-moderne et post-impériale en cours. Résultat, tout
ça, de plus en plus, pédale dans le vide. Dans ce vide et contre lui
prospèrent les mots, les frustrations et les aigreurs d’un populisme
noyé dans la nostalgie de l’empire, avec en miroir un monstre :
les mots, les frustrations, les aigreurs et les atrocités des croisades
terroristes.
Sans considération pour ce vide naissent les imaginaires nouveaux.
La bonne nouvelle du blues
On en a un exemple historique lumineux, précurseur, sorte de métaphore
en acte des grandeurs et des failles de l’empire unique, de ce qui a
fait sa vitalité et cause son agonie. Cet exemple est en germe dans la
naissance même de la modernité occidentale, qui il y a un demi
millénaire, enfante en même temps et pour des raisons proches les
grâces de la Renaissance et les épouvantes de l’esclavage.
L’histoire unique n’a pas pu empêcher une bifurcation culturelle
massive qui s’est produite dans le cœur brulant du dessein impérial. Il
s’agit de la musique inédite qui monte des champs de coton et de canne
à sucre dans les colonies d’Amérique, en même temps que les maîtres de
l’empire en capitalisent les bénéfices qui permettront
l’industrialisation. Ce chant n’appartient pas à l’empire, il en est
une condamnation vivante. Il n’appartient pas à l’histoire unique, ne
travaille pas les subtilités du contrepoint, mais introduit des
innovations rythmiques à mille lieues de la scansion indigente de la
« musique savante » et nous rappelle que nul ne viendra à
bout des variations rendues possibles par une gamme pentatonique. Il
n’est pas référençable dans le main stream de l’empire et même le
souvenir de l’Afrique qu’il porte en lui a perdu la plupart de ses
mots. Chaque voix, chaque mélodie, chaque prière, chaque imprécation
sont un avènement. Celles et ceux qui les profèrent les adressent
souvent à Dieu, mais ne se prennent pas pour Dieu. Les maîtres de
l’histoire unique les ont réduit au statut de marchandises.
Cette aube va changer l’oreille du monde. Aujourd’hui, où que ce soit
sur la planète, quelle musique populaire n’emprunte pas quelque chose à
cette autre histoire ? Combien de musiques dites savantes s’en
sont laissé pénétrer ? Donc deux histoires (au moins deux) se
développent l’une à côté de l’autre, s’interpénètrent, vivent de leur
vie et de leurs règles et cette émergence dénoue peu à peu l’empire,
contribuent en tout cas à ce dénouement. Il n’est pas indifférent que
cette résistance créative et victorieuse soit née de la plus vive des
contradictions, celle qui place la modernité occidentale sous le double
signe de l’humanisme et de l’esclavage. Elle nous donne à tous une
figure d’une puissante fécondité pour visualiser, comprendre, imaginer
et mener les politiques culturelles post-modernes, post-impériales dont
notre pays a besoin. Ces politiques et les dispositifs dont elles se
doteront doivent être en mesure d’entendre et de favoriser de tels
surgissements, même s’ils balbutient, infirmité moins déprimante que le
radotage.
QUELQUES PISTES
Comprendre et visualiser les enjeux est un préalable. Dessiner la route
qui les traverse est une gageure, comme chaque fois qu’une entreprise
humaine met un pied dans le vide, dans l’inconnu, dans un au delà sans
balise. Il faut pourtant s’y risquer. Sinon s’asseoir et regarder
passer les trains. La modestie est impérative. Même si elles
s’autorisent d’expériences occasionnelles, les quelques pistes ici
proposées ne sont ni exhaustives, ni abouties. Elles appellent le débat
et se réjouissent des pratiques qui poursuivent le même but par
d’autres voies. Les voici.
Repérer
et répertorier les pratiques culturelles qui se construisent déjà sous
de nouveaux paradigmes, leur donner de la puissance
La première piste invite à repérer, à rendre visible, à donner sens au
déjà-là des nouveaux mondes. C’est une tâche ardue pour laquelle il
faudra trouver les instruments adéquats, sans oublier que l’intuition y
aura une part importante. Et le trébuchement aussi. Elle nécessite
d’explorer sans tabou tous les cantons où se produit l’imaginaire
d’aujourd’hui. Le plus décisif et le plus compliqué sera d’entendre ce
qui se chante « dans les champs de coton », ces
« marges » sociales ou géographiques qu’un système culturel
public refondé devra dépériphériser, déhiérarchiser, mettre en réseau
et servir à égalité avec les autres « centres » de culture.
On ne part pas de rien. C’est par exemple l’orientation qu’avait pris
le communiste Michel Duffour, secrétaire d’Etat « au Patrimoine et
à la Décentralisation culturelle » en se consacrant à défricher
les « nouveaux territoires de l’art ». Il reste du chemin à
faire. Beaucoup se passe aussi du côté des étonnantes architectures que
permettent les réseaux numériques, ouvrant des associations insolites
entre la connaissance, l’art, le jeu, la co-opération des œuvres et
leur partage sans limite. Le jugement qualitatif, esthétique, n’est
sans doute pas inapproprié dans l’évaluation de ces constructions
nouvelles. Certains arts, les arts du texte surtout, ainsi que le
cinéma, n’ont pas pu être emprisonnés dans le corset de
l’autoréférencement et échappent de ce fait à l’histoire unique. Leur
matériau est le langage, signifiant qui possède sa propre matérialité,
mais convoque des signifiés appartenant à l’expérience commune. Le
roman par exemple, le cinéma aussi racontent déjà une multiplicité
d’histoires. Les périphéries de l’empire savaient donner forme à leurs
histoires sans passer par le roman, ni par le cinéma. Mais eles se sont
généralement emparées de ces arts sans trop avoir à se conformer au
modèle « central », ni à abandonner des façons de raconter
qui leur sont propres. Et puis, même si bien des aspects de l’appareil
culturel d’Etat produisent objectivement des rapports de domination,
subjectivement c’est souvent (pas toujours) au corps défendant de ceux
qui le font vivre, sincèrement acquis aux idéaux d’égalité et de
démocratie sociale. Cela fait qu’au cœur même de la structure, on peut
trouver mille expérimentations partielles, mille dispositifs ingénieux
qui atténuent les effets du système et pourraient alimenter sa
refondation.
Démarchandiser le service public de la culture
Quand on aborde la question tarifaire, souvent jugé si grossière par le
clergé du système culturel, lui pour qui les spectacles sont pourtant
d’accès gratuit, on s’entend souvent dire : là n’est pas le
problème. Si ! Là n’est pas le seul aspect du problème, mais là
est son principal symptôme. Donner la forme d’un achat à ce qui est une
contribution minoritaire à un coût financé par le peuple, évaluer le
« prix » de cet « achat » selon les canons de
l’imaginaire marchand écarte matériellement, mais aussi symboliquement
la majeure partie du peuple de la « création » contemporaine.
Tarif « normal » inabordable. Tarifs « anormaux »
possibles sur présentation de sa carte d’ « anormal ».
Mystification d’un « prix » menteur, d’un « prix »
qui n’est en réalité qu’une participation proportionnellement minime à
un coût socialement assumé, mensonge qui camoufle la ponction faite sur
tous par l’impôt pour permettre à quelques uns l’accès aux sacrements
de l’art consacré. Faire de l’art une marchandise de luxe n’est pas
anodin. Les politiques publiques doivent affronter cette question.
Gratuités. Prix libres. Mise en échec des stratégies de collectionneurs
qui réservent la possession des œuvres aux plus riches et soumettent
les revenus des artistes à cette pathologie sociale. Par exemple en
valorisant les multiples auxquels la technologie permet désormais de
conserver la pleine qualité esthétique d’une image. Par exemple en
prenant acte que le festival d’Avignon a son marché des œuvres, le off,
qui est d’ailleurs plutôt de bon aloi, et que l’intervention publique,
le in, doit se porter sur des urgences d’intérêt public, par exemple
imaginer et faire la démonstration qu’on peut concevoir les événements
proposés de telle sorte qu’ils s’élargissent au peuple tout entier.
Décoloniser les arts
« Décoloniser les arts » n’est pas un slogan périphérique.
C’est le fil rouge de la transition à opérer. Cet objectif ne se réduit
pas non plus au mouvement de type syndical qu’on voit aujourd’hui et
qui réclame davantage de place dans l’institution pour les enfants
français des peuples colonisés. Soigner le symptôme fait aussi du bien,
agit positivement sur les représentations et il y a urgence à avancer
dans ce sens. Mais décoloniser les arts est d’abord l’axe
incontournable d’une politique culturelle engagée dans la réponse aux
enjeux de civilisation qui taraudent nos mondes. De la même façon,
décoloniser la société française, constituer la communauté libre et
fraternelle des enfants de la République et des enfants de l’empire à
égalité de légitimité est un projet politique crucial pour la survie de
la nation et son unité. L’un ne va pas sans l’autre, car en la matière,
l’imaginaire joue les premiers rôles. La déconstruction des paradigmes
induits par cinq siècles de domination impériale, l’élaboration des
moyens de faire entrer les mondes en conversation est un projet
culturel, artistique, intellectuel qui constitue en quelque sorte un
préalable à la reconstruction de politiques culturelles publiques
émancipatrices et démocratiques accordées à un monde libéré de
l’histoire unique.
Reconnaître la diversité des règles du jeu
L’appareil culturel d’Etat tel qu’il est se trouve grosso modo dans
l’incapacité structurelle de reconnaître qu’il existe une diversité des
règles du jeu, comme la naissance du blues l’a pourtant montré de façon
définitive au cœur même du moteur impérial. Il parvient à ingérer
quelques groupes de danse hip hop, quelques photographes africains,
quelques masques dogons, mais en leur imposant ses rites. Faut-il que
le hip hop quitte les dalles des cités, que l’univers des mangas entre
dans les musées, que l’inventive orthographe de facebook soit
sanctionnée par une académie pour que ces surgissements élargissent
l’imaginaire commun et y envoient des passerelles inédites ?
Comment raccorder, sans imposer de hiérarchie, la nuit de kotèba –
danse, musique, rire, théâtre, critique sociale… – qui se donne
gratuitement à tous par l’art de tous dans un village du Mali avec ce
que produit aussi de singulier le long travail de comédiens
professionnels montant un spectacle programmable par une scène
nationale française. La question que pose l’appareil culturel d’Etat
pour juger du bien et du mal est : « Quelle place cette
œuvre, cet artiste tiennent-il sur l’échelle de valeur déterminée par
les canons de l’histoire occidentale de l’art ? » Soit !
Ce n’est pas vain. Mais en amont, se posent des questions plus larges,
plus profondes, plus inclusives, plus libres : « Que se
passe-t-il à l’occasion de cet événement culturel ? Quelle importance,
quelle qualité possède l’événement qui se noue autour de telle ou telle
mise en forme symbolique ? Comment la qualité de la mise en forme
et du metteur en forme participe-t-elle à la qualité de
l’événement ? » On comprend sans peine que la première
posture rend sourd à la naissance du blues. On comprend aussi que la
seconde série de questions pousse à tendre l’oreille.
Substituer le réseau au podium
Une des modifications culturelles et anthropologiques les plus
puissantes de notre temps est l’explosion des réseaux,
l’expérimentation massive de fonctionnements non hiérarchiques (ou
moins hiérarchiques), de rapports sociaux où la figure du centre et de
la périphérie est déstabilisée, remplacée par des situations où chacun
est tour à tour centre et périphérie. On voit naître de partout la
production de connaissances, de pensée, de liens, d’objets symboliques
proliférants, co-opérés, de plus en plus difficilement emprisonnables
dans les rets de la « propriété intellectuelle ». Le
mouvement du logiciel libre, sa joyeuse contestation en pratique du
travail hiérarchisé et de la propriété individuelle privée, est une
figure éclairante de ces ouvertures. Celles-ci peuvent aussi être
considérées du point de vue de leur qualité esthétique, de leur
architecture. Elles ouvrent sur des objets symboliques que les critères
canoniques du jugement artistique occidental peinent à circonscrire. De
l’univers des mangas naissent du dessin, du cinéma, des jeux
interactifs, une familiarité avec la culture japonaise vivante qui
relie des jeunes de toutes les parties du monde. Un art nouveau et très
sophistiqué du scénario est par exemple en train d’en surgir. Les
laboratoires actuels de l’institution culturelle sont-ils en mesure de
travailler à la qualité de ces univers en y incluant les jeunes qui y
jouent avec une adresse dont les vieux sont privés ? Comment
juger, s’approprier, développer les constructions symboliques
proliférantes et sans frontière qui ne manqueront pas de surgir, qui
émergent déjà, comment les protéger de la confiscation par les vieilles
formes de la propriété capitaliste, leur donner les structurations
libres et coopératives qui correspondent si bien à leur nature ?
Grands poètes, moyens poètes, petits poètes… Théâtres nationaux, CDN,
scènes nationales, scènes conventionnées, théâtres municipaux, MJC…
Comment cette obsession du podium peut-elle rendre compte de ces
émergences ? Plutôt que des institutions hiérarchisées, ne peut-on pas
imaginer un système public de la culture formé de familles, de réseaux
réunissant des lieux, des arts, des types d’événements culturels (ou
non) qui tirent leur sens de leur interaction et qui gèrent
collectivement leurs moyens ? Un grande salle équipée, un petit
théâtre de proximité, un café disposé à accueillir des discussions
thématiques, une compagnie africaine reliée par la télématique et
régulièrement invitée, une vedette de l’écran, trois lycées, deux
comités d’entreprise, un conteur itinérant, une chorale, une
médiathèque, une maison de retraite, un festival, tous réunis par des
connivences aléatoires nées de leurs singularités se penchent ensemble
sur la mission de produire l’univers symbolique dont nous avons besoin,
apportent chacun ses forces et son expertise, mutualisent les moyens et
constituent ensemble un corps vivant aux membres bien individualisés
mais fonctionnant de concert. D’autres réseaux de même nature
établissent avec lui des synapses « interfamiliales ». Les
singularités s’affirment et les frontières s’estompent…
Etablir la conversation
Reste à établir la conversation. Ça ne sera pas facile parce que des
enjeux de pouvoir, d’argent, de notoriété contribuent fortement à
l’arthrose du système. Parce que tous ceux et tout ce qui contribue à
l’empire de l’histoire unique vont se débattre, et de bonne, et de
mauvaise foi. Le réseau n’est pas une assemblée parlementaire où on
vote à la majorité. Il reconnaît, accorde et respecte les fonctions
singulières et non hiérarchisées. Cette mise en conversation n’est pas
une responsabilité des pouvoirs publics. Elle doit être réglée et mise
en œuvre par la société elle-même, notamment avec la communauté
artistique dont c’est une des responsabilités, mais pas elle seule.
L’action politique et associative elle aussi est convoquée, non pas
l’action représentative des élus, qui y participeront à titre de
citoyens, mais par exemple et sans exclusive celle des organisations
politiques ou associatives et des militants. Mis en œuvre, un tel
projet placerait la question culturelle au cœur de l’action et de la
pensée politiques, non dans les mots, mais dans les faits.
11 Juin 2016
Abonnez-Vous à CultureBox
Retour à la Résistance Culturelle
Retour au sommaire
|