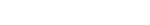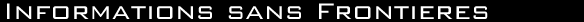
L'Économie Des Musiques Africaines : Un Terrible Paradoxe
Par Gérald Arnaud

Toutes les musiques les plus populaires dans le monde entier sont
d'origine africaine. La musique devrait donc être l'une des principales
ressources économiques de l'Afrique. Mais pour faire de la musique, il
faut des musiciens. Méprisée hier comme aujourd'hui, cette profession
est de plus en plus poussée à l'émigration.
" Lorsque
l'argent apparaît, la musique s'inscrit dans l'usage ; la
marchandise va la piéger, la faire circuler, la censurer. Elle cesse
alors d'être affirmation de l'existence pour être mise en valeur. Son
usage n'a pas résisté à son échange : depuis que les sociétés ont
rompu leurs codes régulateurs, leurs interdits, leurs rites
sacrificiels, la musique flotte, comme une langue dont ceux qui la
parlent auraient oublié le sens mais non la syntaxe. "
Jacques Attali, Bruits, PUF, 1977
Parler
d'une " économie de la musique " ne va pas de soi. De tout temps et en
tous lieux ces termes ont pu paraître antinomiques. Cependant ils
appartiennent au même vocabulaire normatif inventé par une civilisation
disparue, éphémère et très localisée - la Grèce antique - pour imposer
à tous les domaines de la connaissance universelle les règles de sa
propre " logique ".
Les
ethnomusicologues ont d'ailleurs longtemps prétendu que le concept "
musique " n'a d'équivalent dans aucune des quelque 1 200 langues
africaines. Aucun linguiste n'est assez savant pour vérifier cette
allégation excessive et hasardeuse : pour ne prendre qu'un exemple, le
mot ndouma en mbochi (Congo) recouvre tous les sens de " musique " et
l'on pourrait sans doute aussi trouver quelques mots africains
traduisant parfaitement le terme " économie "…
Il n'en est pas moins vrai que chaque culture repose sur ses propres
paradigmes. Un minimum de respect pour la diversité culturelle impose
donc, pour parler de l'économie de la musique, de ne pas oublier qu'il
s'agit en Afrique de mots exotiques, incongrus pour la plupart de ceux
qui font de la " musique " une activité " économique " au sens grec et
occidental de ces deux termes.
" Musicien, ce n'est pas un métier ! "
À l'instar de l'Asie et d'autres régions du monde, l'Afrique ne s'est
pas précipitée aussi vite que l'Occident vers la marchandisation de la
musique - ce que Jacques Attali appelle sa " mise en valeur ".
Contrairement à ce qu'imaginent ceux qui n'y ont jamais mis les pieds
ou qui n'osent s'éloigner des rares routes goudronnées, les musiques
précoloniales y sont encore très vivaces, non pas intactes mais
évolutives et inventives comme elles l'ont toujours été même dans les
recoins les plus éloignés de la " brousse ".
Si l'Afrique est en voie d'urbanisation accélérée, 70 % de sa
population est encore rurale et villageoise, même si elle entretient un
lien familial et communautaire très fort avec les citadins - notamment
lors des fêtes religieuses, funérailles et mariages…
Les musiciens jouent donc un rôle essentiel dans la métamorphose
économique accélérée de l'Afrique, dans ce va-et-vient incessant et
turbulent entre la " brousse " et les bidonvilles ou les quartiers
résidentiels des mégapoles.
Les
styles africains qui émergent sur la scène de la " world music "
naissent tous du succès, dans certains quartiers urbains, de telle ou
telle forme de musique déjà populaire dans une région particulière.
Qu'il s'agisse du " bikutsi " à Yaoundé, de la " juju " à Lagos, du "
mbalax " à Dakar, du " raï " à Oran ou du " zouglou " à Abidjan, tous
ces genres ont des origines " broussardes " et précoloniales. On
assiste donc partout à un continuum, et non à une rupture entre
cultures rurales et urbaines.
Certes le statut économique des musiciens a évolué. Mais a t-il autant changé qu'on le croit ?
Les sociétés africaines ont toujours été fondées sur un système très
complexe de dons et d'allégeances, plus que sur un échange égalitaire,
organisé et quantifié. Les musiciens africains sont ainsi très souvent
confrontés à des difficultés économiques particulières tenant à un
écheveau - parfois inextricable - de relations familiales et sociales
issues de la tradition orale. Ces " coutumes " divergent d'avec les
lois écrites, et elles sont difficiles ou même impossibles à
transgresser sur place. Bien des jeunes musiciens qui se décident
(souvent à contrecœur) à émigrer vers le Nord ou vers un pays africain
un peu plus riche que le leur avouent le faire pour se libérer de cette
pression permanente de la communauté, au moins autant que pour fuir la
pauvreté.
Presque tous les
musiciens des générations " post coloniales ", interrogés sur leur
destin, n'ont jamais attendu que la question leur soit posée pour
avouer qu'ils sont devenus musiciens au prix de palabres avec leurs
parents, leur famille et leur communauté culturelle en général.
Ce conflit est avant tout de nature économique : " Musicien, ce n'est
pas un métier ", ou bien c'est " le pire des métiers ". Cette
scandaleuse et terrible affirmation n'est pas une spécialité africaine,
mais elle prend une dimension tragique sur un continent où la
gérontocratie est souveraine et où la jeunesse n'a d'autre choix
qu'obéir aux aînés ou se rebeller, c'est-à-dire souvent émigrer pour
conquérir une certaine liberté.
L'africanisation de la culture musicale planétaire
On assiste ainsi à un terrible paradoxe. Toutes les musiques les plus
populaires de la planète en ce début du XXIème siècle, au seuil de la
mondialisation, sont d'origine africaine : du blues au slam, du gospel
au rap, du jazz au funk, du " son " afro-cubain à la salsa, etc.
Cependant les musiciens africains, premiers acteurs de cette
progression de la musique vers l'universalité, en sont aussi les
premières victimes d'un point de vue économique.
En 1998, une étude de la Banque Mondiale évaluait les ventes annuelles
de CDs de musique " africaine ou d'inspiration africaine " autour d'1,5
milliard de dollars. Or la production africaine proprement dite ne
représente que 0,5 % du chiffre d'affaires global de l'industrie
phonographique. Cette injustice est d'autant plus stupéfiante que
l'africanisation de la culture musicale planétaire a préfiguré et même
" dopé ", en généralisant une accoutumance aux échanges et au "
métissage ", la globalisation économique.
S'il est quasiment impossible aujourd'hui pour un musicien africain de
vivre décemment chez lui de son art, les causes se trouvent moins dans
les pesanteurs sociales déjà évoquées que dans les conséquences
cumulées de la colonisation, du néocolonialisme et de la libéralisation
des échanges imposée à coups de sabre par le Fonds monétaire
international (FMI).
Les
Africains parlent au total plus de 1 200 langues différentes, et à
chacune d'entre elles, vecteur principal d'une culture originale, sont
associées d'innombrables genres musicaux, et des types d'instruments
dont certains lui sont exclusifs, comme le lamellophone. Les
ethnomusicologues, européens puis africains, ont recensé et enregistré
cet immense patrimoine " précolonial ". Ils ont malheureusement été
moins efficaces en ce qui concerne l'évolution de ces musiques au fil
de la colonisation et de l'urbanisation. Ce fut néanmoins le premier
investissement financier - modeste mais moderne - dans l'économie
musicale africaine.
Les
administrations coloniales ont hélas toujours considéré les musiques
africaines comme des artefacts qu'il fallait archiver et perpétuer tels
quels à peu de frais, sans se soucier de leur avenir, toute évolution
étant perçue par principe comme une décadence.
Les griots, héritiers d'une économie musicale complexe
Cependant le vice principal de tous les débats sur la dimension
économique de l'activité musicale africaine est d'oublier que l'Afrique
n'a pas attendu la colonisation pour franchir la première étape
décisive dans l'avènement de toute " économie musicale " : la
professionnalisation.
Depuis au
moins le XIVème siècle (comme en a témoigné pour la première fois par
écrit l'écrivain-explorateur marocain Ibn Battuta), dans l'Empire du
Mali, le métier musical était déjà aussi bien sinon mieux organisé
qu'en Europe. Cette économie traditionnelle est loin d'avoir disparu.
Si les orchestres de cour se sont raréfiés avec le déclin des
chefferies et royaumes traditionnels, il en demeure d'admirables, au
grand bonheur des musicologues et des touristes, notamment dans la
région des Grands Lacs ou en Afrique de l'Ouest.
La préservation des musiques " patrimoniales " reste aujourd'hui un
enjeu capital, puisque la plupart sont menacées à court terme de
disparition, alors qu'elles sont le terreau encore très fécond de
toutes les musiques actuelles. Leur extinction tarirait tout simplement
la source de l'économie musicale africaine…
On ne dira jamais assez l'incapacité ou du moins l'insoutenable
légèreté des États africains post coloniaux. Quarante-six ans après les
indépendances, l'archivage et l'étude de cet héritage inestimable sont
si négligés qu'ils reposent presque exclusivement sur des financements
et des projets extérieurs. Pire, il existe pour cela des budgets qui ne
sont pas pleinement utilisés, faute d'efficacité ou d'intérêt de la
part des gouvernements. Ainsi depuis 2003, l'Unesco a mis en œuvre un
grand projet de sauvegarde du " patrimoine culturel immatériel de
l'humanité ". Parmi des dizaines de traditions musicales déjà
répertoriées et auxquelles ont été attribuées des subventions, il n'y
en a qu'une demi-douzaine pour l'Afrique, parmi lesquelles les
xylophones sosso bala (Guinée) et timbila (Mozambique), les trompes
gbofé des Tagbana (Côte-d'Ivoire) et les chants des Pygmées Aka
(Centrafrique). Il pourrait y en avoir beaucoup plus, mais pour
participer à ce projet, chaque gouvernement doit présenter un dossier.
Depuis trois ans, contrairement à leurs homologues d'autres continents,
la plupart des ministres africains de la culture n'ont pas eu le temps,
semble-t-il, de rédiger quelques pages sur leur patrimoine musical !
Cette indifférence étatique n'empêche heureusement pas certaines
musiques africaines ancestrales, non seulement de survivre, mais de
s'adapter avec une incroyable habileté à l'économie contemporaine.
Ainsi, il est impossible de comprendre la musique moderne
ouest-africaine en ignorant que la plupart de ses stars appartiennent à
la famille " griotique " : de Kouyate Sory Kandia à Coumba " Gawlo "
Seck en passant par Mory Kanté, Baba Maal, Youssou N'Dour, Ba Cissoko,
Toumani Diabaté, Sekouba Bambino, etc. Les griots, comme bien des
musiciens d'autres régions de l'Afrique, sont les héritiers d'une
économie musicale complexe, qui n'est pas exclusivement monétaire. Par
exemple, le plus célèbre des griots maliens, Kassémady Diabaté,
n'hésitera pas à annuler à la dernière minute un concert dans une salle
parisienne, s'il est convoqué le même soir dans un foyer d'immigrés
pour un mariage où il se doit de chanter en tant que griot. Il est vrai
qu'au-delà du respect de la tradition, d'un strict point de vue
économique, c'est un calcul rentable à court terme, car les liasses de
billets qu'il empochera au cours de cette fête représentent une somme
bien supérieure au cachet prévu pour le concert annulé…
D'ailleurs, aussi déconcertant que cela puisse paraître, presque tous
les musiciens africains " à plein temps " ignorent ou refusent encore
les règles du show-business actuel, et n'en sont pas moins des
professionnels, dont l'activité est régie par des règles coutumières.
Au Burkina Faso et au Ghana par exemple, les groupes convoqués pour les
sorties de masques ne peuvent être rémunérés qu'en cauris - ces
coquillages qui servaient de monnaie avant l'arrivée de " l'argent des
Blancs ". Plus généralement, la parole prévalant sur l'écrit, même dans
les villes, la vie économique du musicien africain repose encore sur la
confiance plutôt que sur le contrat. Du conflit inévitable entre ces
deux concepts est née une situation que les nouvelles générations
tentent de maîtriser, avec d'immenses difficultés.
Du socialisme étatique au libéralisme : un cataclysme musical ?
Si l'on excepte les rares musiciens qui à la fin de l'époque coloniale
animaient (pour un salaire dérisoire) les clubs et les dancings des
quartiers européens, ou ceux encore plus rares qui voyageaient en
Europe, très peu d'Africains ont pénétré les arcanes de l'économie
musicale " moderne " de type occidental avant 1960.
C'est alors qu'avec les " indépendances ", la pratique musicale va
acquérir dans certains pays africains une importance inouïe et un
statut inédit, inspiré de celui des artistes des États " socialistes ",
et non plus des ex-puissances coloniales. ? Conakry, puis à Bamako et
dans bien d'autres capitales des nouveaux États, des milliers de
musiciens d'origine et de formation très diverses se retrouvent promus
fonctionnaires.
Ils sont investis
d'une mission impossible : en même temps au service d'un gouvernement,
qui tourne souvent à la dictature, et d'une culture, à la fois rurale
et urbaine, multiethnique et nationale, ils sont censés harmoniser ces
contradictions. En Afrique de l'ouest notamment, cette période
transitoire a laissé des traces profondes sur la perception que les
musiciens africains ont actuellement de leur statut économique.
Surtout, elle a laissé jusqu'à présent le souvenir légitime d'une sorte
d'âge d'or où pour la première fois en Afrique, il était possible de
bien gagner sa vie comme musicien sans être pour autant confronté aux
pesanteurs de la tradition. Ce fut une période prodigieusement
créative, d'un point de vue esthétique.
Il est impossible pour un mélomane de ne pas reconnaître que le passage
du socialisme étatique au libéralisme débridé tel qu'il a été imposé
par le FMI dans les années 1980 fut un véritable cataclysme musical :
disparition des grands orchestres, décadence de l'éducation musicale et
surtout dissolution des liens si créatifs entre les musiques rurales et
urbaines… En quelques années, toute l'élite musicale s'est retrouvée
dans une précarité dramatique. Ses plus grands créateurs, même les plus
anciens et les plus vénérables, ont été précipités sans pitié dans la
misère.
C'est une logique
économique aberrante dictée par un certain intégrisme capitaliste qui
aura brutalement interrompu l'une des plus belles aventures musicales
du XXème siècle : la transmission en douceur du patrimoine musical
précolonial aux États de l'Afrique postcoloniale.
Le plus absurde est qu'au même moment, en Europe et dans le monde
entier, les médias proclamaient l'avènement de la " world music " et
célébraient son enracinement dans le terroir africain, sans trop se
soucier du sort de la plupart des musiciens africains.
Vingt ans après cette catastrophe silencieuse, presque partout en
Afrique la musique n'est plus perçue, au mieux, que comme une activité
marginale et rarement lucrative. Les décideurs locaux, obsédés par
leurs profits à court terme, sont devenus incapables d'évaluer le
capital considérable et l'immense potentiel de promotion en vue du
développement que représente l'amour du monde entier envers les
musiciens africains.
Face à la
vision tragique qu'offre aux yeux du reste du monde la situation
politique, sanitaire et sociale du continent, la musique reste le
domaine dans lequel il offre son image la plus indiscutablement
positive. Les musiciens africains devraient donc être traités comme les
meilleurs ambassadeurs économiques de l'Afrique…
Non seulement il n'en est rien, mais jamais leur condition sociale n'a
été aussi dévaluée. L'impéritie des gouvernements africains se conjugue
au cynisme de gouvernants européens qui prétendent organiser la fuite
des cerveaux en la rebaptisant " immigration choisie ". Hélas, dans le
domaine musical, ce système est déjà en place depuis trop longtemps.
Selon le musicologue Manda Tchebwa " 70 % des stars de la musique
africaine sont installées à Paris - considéré comme le lieu de
légitimation des carrières au plan international - contre 20 % qui font
la navette entre leur pays d'origine et la capitale française. " (1)
L'économie musicale africaine est donc en majeure partie " expatriée "
et cette tendance n'a fait que s'accentuer depuis une vingtaine
d'années. Parmi ceux, minoritaires, qui restent ou retournent en
Afrique il y a beaucoup de vrais " patriotes africains ", des militants
qui contre vents et marées préféreront toujours vivre parmi les leurs,
en continuant de partager cette part de rêve inexprimable qu'est la
musique lorsqu'elle est d'abord celle d'un individu au sein de sa
communauté natale. Mais comment vivre de sa musique en Afrique ?
Un " minerai sonore " destiné à l'exportation
Comme l'écrit si bien Manda Tchebwa, " les États africains devraient
savoir que la musique n'est plus seulement une spiritualité en partage,
une incantation, un support mystique destiné à honorer les dieux, elle
est un " produit culturel ", un facteur essentiel de développement
économique, un " minerai sonore " désormais coté en Bourse. Qui devrait
rapporter des milliards de dollars si l'Afrique décidait un jour
d'organiser, pour elle-même, un marché de la musique cohérent, riche,
rentable, si elle administrait convenablement sa législation, notamment
en faveur des créateurs, tant au niveau national que sous-régional,
tant au niveau africain qu'au niveau international. " (1)
Les musiques africaines sont encore victimes du système colonial qu'on
appelait jadis " culture de rente ". En Côte-d'Ivoire, premier
producteur mondial de cacao, il est presque impossible de trouver une
tablette de chocolat comestible fabriquée sur place. De même, si l'on
veut acheter un enregistrement de musiques africaines, traditionnelles
ou contemporaines, conforme aux critères techniques en vigueur dans la
sono mondiale, il faudra aller le chercher dans le catalogue de maisons
de disques européennes. Par exemple a été éditée, à Berlin, une
remarquable anthologie en CD d'Ernesto Djedje, avec un beau livret et
une qualité sonore irréprochable, alors qu'à Abidjan on ne trouve pas
le moindre enregistrement du " père de la musique moderne ivoirienne "…
Les musiques africaines sont plus que jamais traitées, à l'instar du
cacao ou du café, comme des produits coloniaux, de simples matières
premières de la " world music " : parmi les enregistrements et même les
spectacles musicaux exportés en vue d'une diffusion extérieure, un
nombre infime est entièrement réalisé en Afrique. La plupart du temps,
au mieux l'artiste est recruté. Il répète et enregistre sur place, puis
il réenregistre, remixe et réadapte sa création au Nord, dans le pays
destinataire, selon des critères esthétiques et technologiques jugés
plus performants par le public ciblé - amateurs de " musiques black "
et/ou diasporas.
Une fatalité le fléau de la piraterie ?
Dans les années 1990, les majors du disque ont évacué le continent.
Elles n'y sont plus présentes, en tant que telles, qu'en Afrique du
Sud. Partout ailleurs, elles ont fermé boutique ou au mieux revendu
leurs filiales à des entrepreneurs locaux comme en Côte-d'Ivoire ou au
Mali. Il est difficile de leur jeter la pierre, car des sociétés comme
EMI-Pathé Marconi ou RCA-Victor ont beaucoup fait, pendant un
demi-siècle, pour promouvoir les musiques africaines. Elles sont
parties découragées, désabusées par l'indifférence ou l'impuissance des
États africains face au fléau de la " piraterie ".
Cette délinquance, l'une des plus lucratives et des moins risquées dans
les kleptocraties africaines, y représente hélas l'essentiel de
l'économie musicale, mais ce n'est pas une fatalité. La lutte contre ce
fléau quand elle est bien menée et appuyée de l'extérieur peut porter
ses fruits. Dans une enquête publiée en 2002, l'IFPI remarquait que si
le piratage représentait encore plus de 50 % du marché au Kenya et au
Nigeria, des pays comme l'Afrique du Sud, le Ghana et le Zimbabwe
avaient réussi à le faire chuter entre 10 et 25 %. L'Afrique
francophone mérite le bonnet d'âne : 80 % à 90 %.
Principaux coupables : le Nigeria, mais aussi la Chine, qui aime tant
l'Afrique qu'elle l'inonde de ses contrefaçons. La piraterie reflète et
aggrave les conflits interétatiques, économiques et politiques, sans
parler des divisions et rivalités qui empoisonnent la vie des musiciens
africains. On se souvient du scandale malien, lorsqu'en 2005, les 150
employés des sociétés Mali K7 et Seydoni se retrouvèrent au chômage,
alors que sans le piratage, le chiffre d'affaires annuel de ces deux
sociétés, cumulé, aurait dépassé 2 milliards de Fcfa ! Principale
raison de ces licenciements : une usine de Conakry inondait Bamako de
cassettes et CD piratés des artistes mandingues !
Comment s'étonner que malgré son attirance et son intérêt pour les
musiques africaines, un professionnel occidental hésite à mettre ses
mains dans un tel panier de crabes ? En 2006, il n'y a plus guère
d'investisseurs extérieurs dans l'économie musicale africaine.
Comment les convaincre que les musiques africaines sont un
extraordinaire trésor, un gisement inépuisable de talents, un capital
humain dont la valeur n'a rien à envier à celle des matières premières
du continent ? La réponse appartient évidemment aux Africains et
d'abord à ceux qui les gouvernent. Car si pour le monde entier Afrique
rime avec musique, hélas cette évidence n'a pas encore été bien
comprise sur place.
Confusion entre musique et show-business
Les musiciens africains ne suscitent d'intérêt chez eux qu'à l'aune du
succès commercial éphémère, qui valorise les chanteurs-vedettes au
détriment des instrumentistes sans lesquels ils n'existeraient pas.
Les musiciens africains ne sont pas aidés. Comment, par qui le
seraient-ils, quand on sait par exemple qu'au Cameroun, pays dont la
richesse culturelle est l'atout principal, la culture ne représente que
0,15 % du budget de l'État ? La même indifférence se retrouve dans la
plupart des États africains.
Comment s'étonner que presque tous les meilleurs musiciens africains
préfèrent émigrer en Europe, aux États-Unis ou même en Asie, au
détriment de la scène musicale continentale ? Cette " fuite des
cerveaux " se généralise et affecte même des pays naguère réputés pour
leur haut niveau de création musicale.
Il y a en outre, dans les élites et les médias africains, une confusion
de plus en plus débilitante entre musique et show-business. La critique
musicale, pourtant assez brillante au lendemain des indépendances,
n'existe presque plus. Les rubriques " culturelles " des journaux et
des sites Internet, comme les émissions de radio ou de télévision, ne
parlent jamais plus de musique, sauf pour commenter les frasques
sexuelles d'une vedette ou encenser tel petit malin qui a réussi à
coller son nom à un nouveau pas de danse.
Ainsi, la mort d'un immense musicien comme Ali Farka Touré passe
presque inaperçue en Afrique, alors que quelques semaines plus tard,
celle du non-musicien Doug Saga, suscite des émeutes dans la
sous-région. Il est vrai que le " coupé-décalé " aura sans doute
rapporté à son inventeur présumé, en deux ou trois ans, bien plus
d'argent que tout ce que Farka a gagné pendant toute sa vie !
Comparer ces deux personnages apparemment antinomiques peut d'ailleurs
paraître absurde, mais cela nous semble assez intéressant dans cet
essai de réflexion sur l'économie musicale africaine.
En effet, Doug Saga - ivoirien issu d'une famille de griots burkinabè -
est devenu le héros de toute la jeune génération en inversant par
dérision le système griotique : les griots modernes sont rémunérés par
des liasses de billets ; conscient du fait que la promotion est devenue
la clé du succès, Doug Saga a démontré sa " sagacité " en distribuant
d'une façon spectaculaire son argent et en appelant cet acte "
travaillement "… comme si la clé du travail consistait à donner plutôt
qu'à recevoir.
Les musiciens, acteurs du développement durable
Ali Farka Touré avait choisi de devenir un véritable acteur économique,
d'abord en créant à Bamako, avec le français Philippe Berthier " Mali
K7 ", cette structure de production exemplaire qui a tenté de résister
héroïquement aux " pirates ". Ali était à la fois musicien et paysan,
artiste et entrepreneur. Ancien ingénieur du son à Radio Mali, il a mis
ses compétences et ses ressources au service d'une entreprise qui a
révélé toute la nouvelle génération de la musique malienne. En même
temps, il a fondé un projet écologique exemplaire pour développer
l'irrigation et l'agriculture vivrière dans son village Niafunké. Ali
est devenu ainsi l'un des premiers musiciens africains à s'investir
financièrement et humainement, à la fois dans le " développement
durable et dans la promotion des musiques africaines. Il n'était pas le
seul.
Bien des musiciens
africains, dès qu'ils percent sur le marché occidental, réinvestissent
leurs gains chez eux, dans des projets parfois un peu trop ambitieux…
ou pas assez ! Alpha Blondy a déjà dépensé des dizaines de millions de
Fcfa pour la réalisation de son " stade musical " de Grand Bassam
(capacité : 100 000 spectateurs), qui n'a pas encore servi. Le " Nongo
Village " de Mory Kanté à Conakry n'est encore qu'un chantier, comme le
" Moffou " de Salif Keita à Bamako… Il n'en demeure pas moins que les
artistes eux-mêmes sont devenus - contraints et forcés, dira-t-on - les
premiers et souvent les seuls investisseurs dans le domaine des
infrastructures musicales. Parmi les réussites à ce jour, on peut citer
notamment le studio Makassi de Sam Fan Thomas et le studio Tsogo de
Sally Nyolo, tous deux à Douala, et bien sûr le studio Xippi de Youssou
N'Dour à Dakar.
Ce dernier a
réussi à développer en vingt ans une PME dynamique et performante,
employant plusieurs dizaines de personnes, dont le premier objectif
déclaré était de sortir l'économie musicale du cadre informel. Cette
mission est en partie accomplie, puisque le Sénégal afficherait
aujourd'hui le taux de piraterie le plus faible de la sous-région
(moins de 50 %) et que le métier musical y est nettement mieux organisé
que dans les pays voisins, avec une quinzaine de producteurs, une
vingtaine de studios et trois usines de pressage officiellement
enregistrés (2).
Ce cycle
vertueux n'est pas toujours encouragé par l'État lui-même.
Paradoxalement, si les " pirates " échappent, par définition, à toutes
les taxes, Youssou s'est vu infliger un redressement fiscal de 180
millions de Fcfa.
Commentaire
furieux d'un autre producteur dakarois : " C'est un scandale quand on
sait que c'est uniquement à cause de l'inaction et de la corruption de
l'administration, des douanes et de la police, que nous perdons la
moitié de notre chiffre d'affaires. "
Cette indignation est d'autant plus légitime que les investissements,
ou même le mécénat des artistes africains se substituent partout à
l'impuissance de l'État et ne se limitent pas au domaine musical. Ainsi
Xippi (en wolof " ouvre l'œil ! ") avait mobilisé la jeunesse dakaroise
pour des campagnes de nettoyage et d'embellissement de Dakar (le fameux
mouvement " Set Setal "). C'est devenu aussi depuis deux ans une ONG
luttant contre le paludisme.
Il
serait injuste de prétendre - comme le font toujours les médias
africains - que les musiciens gaspillent tous leur argent en dépenses
somptuaires. La plupart de ceux qui ont acquis une certaine prospérité
s'efforcent, ne fut-ce que pour entretenir leur prestige, de participer
au développement de leur pays. Il est essentiel que la musique s'impose
enfin comme un moteur de l'essor économique et que les musiciens
démentent peu à peu la croyance traditionnelle qui les fait passer pour
des " parasites ".
Misère de la musique vivante
S'il est un domaine où la faillite de l'économie musicale africaine est
flagrante, c'est bien celui du concert. On peut discuter à l'infini sur
ce concept occidental et la légitimité de sa transplantation en
Afrique. Il est en tout cas évident et paradoxal que dans ce continent
réputé le plus " mélomane " et " musicien " de tous, il est devenu
quasi impossible d'assister à un concert digne de ce nom, dans des
conditions de confort acoustique considérées comme normales dans tout
le reste du monde.
Même à
Abidjan, ville qui compte aujourd'hui près de cinq millions
d'habitants, depuis la destruction du Centre culturel français il
n'existe plus que deux lieux capables d'organiser décemment un concert.
Cette situation se généralise dans toute l'Afrique.
L'organisation d'un grand concert est devenue périlleuse sans soutien
extérieur. La plupart des producteurs professionnels de musique vivante
ont dû renoncer faute de pouvoir s'acquitter des taxes exorbitantes (41
% au Sénégal), sans compter les inévitables enveloppes à glisser à
droite et à gauche.
La seule
solution est de faire appel au soutien d'un sponsor : généralement un
industriel local plus ou moins mélomane, ou un parti politique en
période électorale. La manne provient de plus en plus souvent des
marques de cigarettes, chassées du Nord par les lois anti-tabac et
toujours prêtes à recruter au Sud de nouvelles victimes.
On ne compte plus les soirées de prestige et autres " caravanes
musicales " financées par Craven, Dunhill ou Marlboro…
Un autre signe du déclin de la scène musicale africaine est la
prolifération du " playback ". Ce phénomène ne date pas d'hier, mais il
a gagné du terrain, d'année en année, brisant la carrière
d'innombrables instrumentistes ou les condamnant à l'exil. Le nombre
des musiciens de " variété ", en particulier, ne cesse de diminuer, et
cela pour plusieurs raisons :
la
première est bien sûr financière : même les émissions de télé
populaires n'ont plus les budgets nécessaires pour programmer des
orchestres, a fortiori pour en entretenir à plein temps comme c'était
le cas jusqu'aux années 1980.
La
plupart des lieux de spectacle ne disposent plus des moyens techniques
(micros, amplis, enceintes de retour, etc.) nécessaires pour accueillir
un orchestre.
Les médias
entretiennent un vedettariat qui ne bénéficie qu'aux chanteurs et aux
chanteuses, au détriment des instrumentistes - il est vrai que cette
tendance n'est pas spécifiquement africaine.
Enfin le " playback " répond à un réel engouement du grand public
africain. Conditionné par la télévision, il préfère, lorsqu'il se
déplace, entendre la version enregistrée de ses tubes favoris, plutôt
que découvrir une véritable interprétation " live ".
Cela n'empêche pas quelques grands artistes de continuer à faire vivre
par leurs propres moyens des orchestres : Super Étoile de Youssou
N'Dour ou encore Solar System d'Alpha Blondy. Cependant, la plupart de
ces formations sont de plus en plus tributaires du financement que leur
apportent les tournées à l'extérieur du continent. Certaines n'existent
plus aujourd'hui que par la volonté et la ténacité de producteurs
européens. C'est le cas par exemple du Bembeya Jazz de Guinée,
ressuscité grâce au Français Christian Mousset, ou de l'Orchestra
Baobab sénégalais, reformé à l'initiative de l'Anglais Nick Gold.
La scène musicale africaine souffre, plus généralement, d'une
dépendance croissante à l'égard des financements extérieurs.
Dans bien des grandes villes, les seules programmations régulières de
groupes africains sont assurées par les centres culturels étrangers,
dont ce n'est pourtant pas la vocation première. Cet état de fait est
souvent contesté au sein même des institutions dont ils dépendent :
British Council, Département d'État américain, Institut Goethe ou même
ministère français des Affaires étrangères.
La seule tendance positive que l'on a pu observer depuis quelques
années est la multiplication des festivals : Gospel & racines
(Bénin), les Nuits atypiques de Koudougou, Jazz à Ouaga et Ouaga Hip
Hop (Burkina Faso), le MASSAO (Cameroun), Panafest (Ghana), le Festival
du désert, le Festival du Niger et Tamani (Mali). Leur pérennisation
s'avère souvent difficile et dépend là encore des soutiens extérieurs
ou du tourisme. Il s'agit essentiellement de festivals nationaux ou
régionaux. Mais il manque de grandes rencontres musicales
panafricaines, surtout depuis la mise en sommeil, il y a trois ans, du
Masa d'Abidjan, à cause de la crise politique ivoirienne. Le
rendez-vous biennal congolais, le Fespam, et les Kora Music Awards de
Durban (Afrique du Sud) ne suffisent pas à combler cette lacune. Il est
d'autre part surprenant que le Nigeria, le pays d'Afrique le plus
peuplé et l'un des plus riche, ait été incapable d'organiser un seul
grand festival depuis l'historique Festac de 1977. L'impatience se fait
donc sentir concernant le 3ème Fesman (Festival mondial des arts
nègres) de Dakar, d'abord annoncé pour le 40ème anniversaire du premier
(1966) puis reporté à l'été 2008…
Il faut espérer qu'il ne subira pas le même sort que le mirifique
projet des " Afromusiques " d'Abidjan. Il avait englouti plus d'un
milliard de Fcfa avant d'être annulé au dernier moment par son
promoteur - lequel vient d'être nommé ministre de la Culture !
L'Afrique au cœur de la " Sono mondiale "
Il est impossible de trouver en Afrique des statistiques fiables
permettant d'évaluer, sur place, une économie musicale à 90 % aussi
inestimable qu'informelle. En revanche des indicateurs intéressants
existent quant au poids des musiques africaines sur le marché français.
Ces chiffres sont d'autant plus utiles qu'ils pourraient permettre
d'extrapoler - d'une façon certes imprécise - la place de ces musiques
sur l'ensemble du marché mondial. La France reste en effet le " portail
" principal par lequel les musiciens africains - d'abord ceux des pays
francophones, mais pas eux seuls - pénètrent ce marché et exportent
leurs œuvres dans l'ensemble des pays dits du Nord, - et au Japon.
Ainsi, le succès d'un musicien africain à Paris, bien relayé par une
structure de diffusion et de promotion adéquate est souvent suivi par
une percée dans toute l'Europe et outre-atlantique. Selon Patrice
Hourbette, du " Bureau export de la musique française ", des maisons de
disques américaines comme Kinder ou Putumayo " s'intéressent à
distribuer aux États-Unis les productions de musiques du monde qui ont
acquis un certain développement en France. Henri Dikongué et Sally
Nyolo, par exemple, qui ne dépassent pas le seuil des 10 000 disques
vendus en France, peuvent aujourd'hui vendre sur ces labels américains
jusqu'à 40 000 disques aux États-Unis. " (3)
D'après une étude de l'Observatoire de la musique (réalisée en 2004)
les " musiques du monde " dans leur ensemble représentent en France 5,3
% des ventes de CDs et DVDs musicaux en volume (nombre d'unités) et
5,08 % en valeur. Ce pourcentage est assez stable depuis les années
1990, et il est le même pour la diffusion radiophonique. Selon la même
source (4) l'Afrique représente 23 % des ventes " musiques du monde "
en volume, et 19 % en valeur.
Il
faut souligner que ce chiffre ne comprend pas le Maghreb, regroupé dans
la catégorie " oriental ". C'est le cas aussi dans une autre étude
effectuée en 1999 par l'association Zone franche (5) selon laquelle
l'Afrique représente 13 % de l'offre discographique (nombre de titres)
de la catégorie " musiques du monde " - mais ce chiffre monte à 30 % en
ajoutant le Maghreb et l'Océan indien.
C'est assez conséquent si l'on sait que les musiques du monde en
général correspondent au quart de l'offre discographique totale en
nombre de titres édités.
Ajoutons
enfin que les musiques du monde sont beaucoup mieux représentées dans
le spectacle vivant que dans la production discographique : 26 % des
concerts dans les grandes salles, 35 % dans les petites et jusqu'à 71 %
dans les festivals. La part des musiques africaines n'est pas précisée
dans cette enquête, mais elle semble au moins équivalente à leur poids
discographique. Si l'on ajoute que les " grosses pointures " du marché
des musiques du monde, en France et en Occident, sont pour la plupart
africaines (Cesaria Evora, Youssou N'Dour, Amadou & Mariam, Magic
System, etc.) on peut comprendre l'attraction irrésistible qu'exerce le
" Nord " sur les jeunes musiciens d'Afrique.
Sortir de l'informel
Le problème majeur qui se pose à eux est la difficulté extrême de
percevoir sur le continent leurs droits d'auteur. La piraterie n'est
pas seule en cause : même si elle disparaissait, resterait à résoudre
un peu partout la question de la fiabilité des organismes de gestion.
L'arsenal juridique existe, il a été adopté par la quasi-totalité des
nouveaux États au moment de la décolonisation, peu ou prou calqué sur
les lois européennes. Il faut souligner que même dans les pays
anglophones, le système du droit d'auteur " à la française " a été
préféré à celui du " copyright " anglo-saxon. En théorie, ce sont les
artistes et non leurs producteurs qui détiennent tous les droits moraux
et financiers, sur la publication de leurs œuvres.
Ces droits ont d'abord été transmis par la Sacem à un organisme
panafricain, le Bada (Bureau africain des droits d'auteur). L'Afrique
ayant préféré le nationalisme au panafricanisme, le Bada a disparu en
1972, cédant la place à des " bureaux " nationaux : ces "
établissements publics à caractère professionnel " sont largement
contrôlés par les gouvernements. Leur inefficacité et leur opacité ont
conduit à la faillite du système. (NDLR : au moment où nous bouclons ce
dossier, nous apprenons que le Burida ivoirien, en crise permanente
depuis les années 1990, s'est déclaré en cessation de paiement. Un
nouveau conflit oppose l'UNARTCI (union des artistes) au nouveau
ministre de la Culture qui tente de s'accaparer le filon en créant une
nouvelle structure, l'Onada, dotée d'un conseil de gestion de douze
membres dont cinq nommés par le gouvernement.)
De nombreux musiciens résidant en Afrique préfèrent s'inscrire en
France à la Sacem. Selon Jacques Blache, son directeur des relations
institutionnelles, " il est impossible de connaître le nombre des
adhérents africains, car (condition sine qua non) ils donnent tous une
adresse en France et aucun fichier de la Sacem ne mentionne les
origines ethniques ou géographiques de ses adhérents. "
Cette expatriation économique virtuelle ne sera peut-être plus
nécessaire, car les choses sont en train de bouger sur le terrain. De
sérieux efforts d'assainissement, de professionnalisation et de
transparence ont été entrepris à l'initiative de la Cisac
(Confédération internationale des sociétés d'auteurs et de
compositeurs). Basée à Neuilly (comme la Sacem !) elle regroupe 217
sociétés de 114 pays et revendique 30 000 auteurs-compositeurs déclarés
en Afrique. Cela peut paraître très peu en regard des millions
d'Africains qui exercent le métier de musicien.
La Cisac dispose d'un Comité africain présidé par le Béninois Samuel
Ahokpa et d'une direction des affaires africaines et caraïbes animée
par le Nigérian David Uwemedimo. Preuve d'une certaine efficacité, les
droits musicaux perçus en Afrique ne cessent d'augmenter : passant de
22,6 à 26,7 millions d'euros de 2002 à 2004. Il faut préciser
qu'environ 50 % de ces sommes viennent de la puissante SAMRO
sud-africaine. Autrement dit, même si l'Afrique du Sud ne représente
qu'un peu plus de 10 % du PNB continental, grâce à une organisation
efficace elle capitalise la moitié des droits musicaux perçus dans
toute l'Afrique !
On ne
s'étonnera donc pas si c'est à l'initiative des artistes sud-africains
qu'a été lancé en 2000, l'ambitieux programme " P4P " : " Partnership
for Progress ". Défini par l'un de ses concepteurs comme un " coup de
pied dans la fourmilière ", il consiste à porter les sociétés
d'auteurs-compositeurs africaines au niveau d'efficacité et de rigueur
(parfois contestable aussi, il est vrai !) de leurs homologues
occidentales.
La Cisac, elle,
subventionne des stages de formation économique et juridique pour les
cadres de ces sociétés, des audits comptables et des " fonds de
campagne " stimulant l'adhésion des musiciens et la perception active
de leurs droits. D'autre part, l'adhésion à la Cisac est conditionnelle
et précaire, soumise à des critères précis de bonne gestion et de
transparence. La société ougandaise vient d'y être admise, alors que la
candidature de la Cameroon Music Corporation a été refusée. Le
principal intérêt de cette conditionnalité est de manifester aux yeux
de tous les musiciens la fiabilité de ceux qui sont censés défendre
leurs droits et intérêts. Cette internationalisation/normalisation
progressive du statut d'auteur-compositeur amorce un " nivellement par
le haut " qui bénéficiera sûrement à toute l'économie musicale
africaine. Il existe d'ailleurs d'autres organisations qui œuvrent dans
ce sens : l'AIPPI (Association internationale pour la protection de la
propriété intellectuelle) est surtout active dans les états anglophones
; l'OAPI (Organisation africaine de la propriété intellectuelle)
rassemble 16 pays francophones depuis les accords de Bangui (1977).
Tous ces organismes ont bien entendu leurs sites Internet, ce qui
contribue à désenclaver l'économie musicale, à battre en brèche les
prés-carrés, les privilèges injustifiés et les situations acquises.
Il y a encore pour les musiciens africains un grave déficit
d'information et de communication avec le reste du monde, mais
certaines expériences récentes prouvent qu'il s'amenuise. Depuis
quelques années, le poids de la piraterie a fortement diminué dans
quelques pays comme le Bénin, la Côte-d'Ivoire ou le Sénégal, grâce à
l'apposition sur les cassettes et CD d'une étiquette comportant un
hologramme pratiquement infalsifiable. Ce concept, généralisé en
Afrique de l'Ouest sous le joli nom de " programme banderole ", est une
création de musiciens jamaïcains !
Dans cette perspective, on constate une nette évolution de l'économie
musicale africaine vers plus d'indépendance. Même si elle reste
fortement tributaire de l'aide des anciennes puissances coloniales, et
plus généralement des " bailleurs de fonds " du Nord, on assiste à une
lente harmonisation sur le modèle sud-africain.
Ce n'est pas un hasard si les " Kora awards " sont devenus le principal
événement médiatique consacré aux musiques africaines.
En
termes monétaires, l'Afrique du sud représente la moitié de l'économie
musicale africaine. C'est aussi un pays qui a hérité de son histoire
une forte tradition de militantisme et de solidarité : contrairement à
ce qui se passe dans le reste du continent, les musiciens y sont très
bien organisés, conscients de leurs droits et prêts à en découdre pour
les défendre non seulement sur leur territoire national, mais à
l'échelle du continent.
En 2003,
leur puissante société, la SAMRO, a organisé au Cap une réunion au
cours de laquelle a été lancé par la Fédération internationale des
musiciens, avec l'appui de l'OIT et de l'Unesco un ambitieux projet de
développement de coopératives musicales dans toute l'Afrique. Outre
l'Afrique du Sud elle-même - dont les acteurs sont en train de
s'associer dans la " South African Music Industry Cooperation
Initiative ", d'autres pays se sont lancés dans cette aventure, comme
le Burkina Faso et la Namibie.
L'objectif, qui est à terme de créer une sorte de " super lobby musical
" à l'échelle panafricaine, sera certainement difficile à atteindre.
Cela semble pourtant la meilleure piste par laquelle l'économie
musicale africaine pourrait connaître enfin les avantages, et non plus
seulement les inconvénients de la mondialisation.
Gérald Arnaud
1-
Manda Tchebwa : Musiques africaines : nouveaux enjeux, nouveaux défis
(Collection " Mémoire des Peuples/Éditions Unesco 2005).
2- Lire à
ce sujet le rapport de l'Agence intergouvernementale de la francophonie
(AIF) sur " Les entreprises culturelles au Sénégal " par Ousmane Sow
Huchard.
3- Cité par François Bensignor dans le guide Planètes Musiques (IRMA, 2000)
4- Consultable sur le site citémusique.com
5- Consultable sur le site zonefranche.com
6- cisac.org
aippi.org
oapi.wipo.net
Né
en 1957 dans la Montagne Noire (Languedoc), après des études de
philosophie et de sciences politiques, puis une licence d'histoire de
l'art, Gérald Arnaud a été disquaire et libraire à la Fnac. Rédacteur
en chef de " Jazz Hot " (1980-1986), il a décidé de vivre de sa plume
sans la caresser dans le sens du poil. Journaliste indépendant, auteur
de livres sur le jazz, de documentaires archéologiques et musicaux,
marié à une Africaine, il s'est enfin décidé à cultiver sa passion
bizarre et suspecte pour le " continent noir et ses diasporas "."
Octobre 2009
Abonnez-vous à Africultures
Retour à la Culture
Retour au sommaire
|