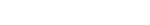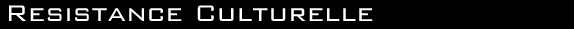|
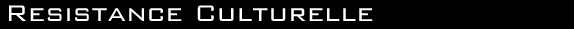
Christian Bobin: "Nous ne sommes pas obligés d'obéir"
Propos recueillis par François Busnel (Lire)

Christian
Bobin, auteur du Très-bas en 1992, vient de publier L'Homme-joie.
François Busnel est allé le rencontrer dans sa bucolique retraite de
Saône-et-Loire.
"Certains livres deviennent immédiatement des amis. Ce sont des livres
rares, souvent cachés dans les rayonnages d'une librairie ou d'une
bibliothèque. On les découvre par hasard, ou par ouï-dire, ou encore
parce qu'un ami qui vous veut du bien vous les a offerts. Ce ne sont
pas de lourds traités sur le bonheur, non, pas directement, mais ce
sont des livres qui rendent heureux. Ils parlent de la joie, de la
gaieté, de l'émerveillement, de la sidération. De tout ce qui fait que
la vie est belle malgré la peine, malgré la douleur, malgré la bêtise
ambiante, malgré la mort - aussi. Christian Bobin nous offre de tels
livres. Le dernier en date s'intitule L'Homme-Joie et est
incroyablement lumineux. Peut-être faut-il le situer comme le point le
plus lumineux, d'ailleurs, dans une bibliographie superbe mais
torturée, où la mélancolie, l'absence et la mort tiennent une place
déterminante. Une bibliographie forte de grands succès comme
L'Inespérée ou La Plus que vive mais aussi - pour la partie croyante et
un peu mystique de l'oeuvre - Le Très-Bas. Christian Bobin a choisi la
solitude. Il vit loin de Paris, de l'agitation, des mondanités, des
injonctions du monde moderne, dans un petit village près du Creusot, en
Bourgogne. Il publie des livres comme on jette des bouteilles à la mer
et leur donne des titres parfaits: L'Eloignement du monde, Eloge du
rien, Eclat du solitaire, L'Enchantement simple ou encore Une petite
robe de fête. Il pèse chaque mot. Prend son temps pour répondre.
Sourit. Et fait preuve d'un humour délicieux, lui qui écrit dans
L'Homme-Joie: "J'ai lu plus de livres qu'un alcoolique boit de
bouteilles."
La Bourgogne, où vous habitez, semble fonctionner de plus en plus comme un refuge pour vous... Le lieu du bonheur parfait ?
Christian Bobin. C'est mon berceau et c'est la base d'envol de tous mes songes.
Christian Bobin est né en
1951 au Creusot. Il est l'auteur d'ouvrages dont les titres s'éclairent
les uns les autres comme les fragments d'un seul puzzle. Entre autres:
Une petite robe de fête (Gallimard, 1991), L'Enchantement simple
(Lettres Vives, 1986), Eloge du rien, Le Très-Bas, L'Inespérée, La Plus
que vive (Gallimard, 1996), Autoportrait au radiateur (Gallimard,
1997).
Faites-vous partie de ces
écrivains qui se sentent attachés géographiquement à un territoire, qui
ont besoin d'être sédentaires pour écrire? De quel ordre est votre
attachement ?
Je ne crois pas me tenir dans la cage d'un territoire. Je pourrais dire
que, dans un sens, j'écris tout le temps. J'ai comme une hémorragie
d'écriture tout le temps. Je ne prends pas de notes. Ou alors de façon
très exceptionnelle : je vais noter une phrase qui me vient, une chose
vue de façon très simple, très réduite, puis, si elle doit vivre plus
tard dans un livre, elle vivra, prendra de l'ampleur. Mais je regarde
tout, tout le temps, toujours. Je vis, c'est vrai, dans une campagne
tout à côté du Creusot. Mais mon vrai pays, c'est la page
blanche.
Comment écrivez-vous ?
Je vais faire un léger détour pour vous répondre. Je pense que
l'écriture est un travail de guérison. Elle a à voir avec quelque chose
qui relève de la guérison. Pas uniquement ma propre guérison mais une
guérison de la vie. De la vie souffrante. De la vie mise à mal par les
conditions modernes. Etrangement, pour guérir il faut d'abord rendre
malade. Rendre malade d'émotions, rendre malade de beauté, vous voyez ?
Mon travail, si j'en ai un, est de transmettre une émotion qui m'est
venue. De faire en sorte que cette émotion soit contagieuse. Je suis
donc toujours dans une sorte d'"attention flottante", comme disent les
psychanalystes, c'est-à-dire une attention légère et soutenue aux
choses, aux gens. Et puis quand quelque chose d'exceptionnel arrive, je
le recueille.
Quel est ce "quelque chose d'exceptionnel" ?
L'exceptionnel ? C'est l'ordinaire. C'est un visage. C'est une
marguerite dans un pré. C'est une parole inouïe entendue quelque part.
Dans votre précédent livre
vous écrivez : "Chaque jour a son poison et pour qui sait voir, son
antidote." Quel est l'antidote au poison des jours ordinaires et
comment apprendre à le voir ? Car là est le vrai problème : comment
reconnaître le miracle lorsqu'il arrive.
Quand le miracle arrive, vous le savez. Si vous me demandez quels sont
les vrais trésors aujourd'hui, à l'heure qu'il est, à cette époque de
ma vie, je répondrais : la patience et l'humeur bonne. Oui : une bonne
humeur. J'ai entendu, il n'y a pas longtemps, un plâtrier siffler, mais
- comment dire...? - il avait mille rossignols dans sa poitrine, il
était dans une pièce vide, il enlevait un vieux papier peint, il était
seul depuis des heures à cette tâche et il sifflait. Et cette image m'a
réjoui et j'ai eu comme l'intuition que cette humeur-là rinçait la vie,
la lavait, comme si cette gaieté de l'artisan réveillait jusqu'à la
dernière et la plus lointaine étoile dans le ciel. Ça, vous voyez, ce
sont des riens, des moins que rien, des micro-événements, des choses
minuscules, mais ce sont ces événements qui fracturent la vie, qui la
rouvrent, qui l'aident à respirer à nouveau. Lorsque de tels événements
adviennent, croyez-moi, vous le savez. Vous le savez parce qu'une sorte
de gaieté vous vient. C'est sans valeur marchande, la gaieté, sans
raison, sans explication ! Mais c'est comme si, tout d'un coup, la vie
elle-même passait à votre fenêtre avec une couronne de lumière un peu
de travers sur la tête.
Dans L'Homme-Joie, vous
écrivez dès les premières pages que "l'art de vivre consiste à garder
intact le sentiment de la vie et à ne jamais déserter le point
d'émerveillement et de sidération qui seul permet à l'âme de voir".
Pour y parvenir ne faut-il pas d'abord trouver quelque part la force de
tourner le dos aux grandes injonctions du monde moderne, c'est-à-dire à
ces verbes que vous énumérez si bien : "acheter, envier, triompher,
écraser l'autre..." ?
Il s'agit juste de faire un pas de côté, mais ce pas de côté fait que
vous arrivez au paradis. Un paradis qui se trouve non pas ailleurs et
demain mais ici et maintenant. Je vais dire une banalité mais le monde
est d'une puissance terrible et mortifère. Chaque jour, chacun de nous
l'éprouve. Après tout, nous ne sommes pas obligés d'obéir. Après tout,
nous pouvons tout d'un coup nous réveiller. La vie est une chose
extrêmement fragile et hors de prix. C'est un diamant. En venant vous
voir, ici, à Paris, j'ai vu des gens couchés sur les trottoirs. Un peu
plus loin, j'ai ouvert un livre que je venais d'acheter et je me suis
surpris à le lire. Il faisait très froid dehors mais la lecture m'a
offert une sorte de cabane, de protection. Ce n'est rien, n'est-ce pas,
des phrases dans un livre, ou un plâtrier qui siffle un air de quatre
sous ? Ce n'est rien. Mais si les planètes suivent leur cours et si la
Terre est toujours sous nos pieds, c'est grâce à des riens comme
cela.
Les esprits grincheux vont
encore dire : "Vous êtes devenu mièvre, Christian Bobin..." Que
signifie cet éloge des marguerites dans un pré, des planètes
lointaines, du plâtrier qui siffle ?
[Il éclate de rire.] Mais la réponse est très simple : nous n'avons que
ça. Nous n'avons que la vie la plus pauvre, la plus ordinaire, la plus
banale. Nous n'avons, en vérité, que cela. De temps en temps, parce que
nous sommes dans un âge plus jeune ou parce que la fortune, les bonnes
faveurs du monde, viennent à nous, nous revêtons un manteau de
puissance et nous nous moquons de cette soi-disant "mièvrerie". Mais le
manteau de puissance va glisser de nos épaules, tôt ou tard... Non, je
ne suis pas mièvre. Je parle de l'essentiel, tout simplement. Et
l'essentiel, c'est la vie la plus nue, la plus rude, celle qui nous
reste quand tout le reste nous a été enlevé. Je vais à l'essentiel. Je
ne fais pas l'apologie de quelque chose qui serait simplet. La
marguerite dans son pré, le plâtrier qui siffle, les planètes
lointaines : voilà, au contraire, quelque chose qui est rude,
émerveillant, parce que ces choses résistent à tout.
Mais cet état d'émerveillement est particulièrement difficile à atteindre, paradoxalement...
Oui, curieusement. Je crois qu'il faut chercher sans chercher. Cela peut venir de partout.
C'est donc du minuscule et de l'imprévisible ?
Oui. C'est cela que j'appelle la gaieté : du minuscule et de l'imprévisible.
Dans Autoportrait au
radiateur, en 1997, vous évoquiez déjà cela en disant que pour y
parvenir il fallait disposer d'un "temps pur" : "Je me suis fait
écrivain ou plus exactement je me suis laissé faire écrivain pour
disposer d'un temps pur, vidé de toute occupation sérieuse."
Oui.
Tout à l'heure vous
évoquiez de vous-même les psychanalystes et leur langage. Avez-vous eu
besoin d'eux pour atteindre ce point d'émerveillement et de sidération,
pour comprendre que ce manteau de puissance va finalement tomber et
glisser?
Ou bien nous sera arraché... Mais cela revient au même. Je n'ai pas
suivi de psychanalyse, j'ai laissé les événements me révéler à moi-même
avec leur violence habituelle. Ça a marché à moitié ou aux trois quarts
-parce qu'il reste toujours une part d'inconnu en nous-mêmes,
évidemment. Mais j'ai demandé à l'écriture de m'amener vers des zones
plus claires, vers une terre plus ample et plus ouverte. Et c'est ce
qui s'est passé. Je ne suis pas allé chercher un savoir technique. Je
ne crois guère aux théories : dessous les théories, cherchez la
déception...
Vous parlez comme si vous aviez conclu un pacte avec l'écriture...
Oui, je crois que l'écriture en sait plus long que moi. [Il marque une pause, observe un long silence, en souriant.]
Et, en même temps, vous semblez considérer la vie comme étant une
aventure, une expérience, y compris dans ses drames les plus forts.
Vous avez écrit sur la mort de l'être aimé, l'arrachement, la douleur.
Peut-on vraiment, sereinement, retrouver la joie ?
Alors là, il faudrait que je parle, si je puis dire ainsi, sur la pointe des pieds. [Un silence.]
Comme vous écrivez.
Vous êtes gentil de dire ça.
Non. Je le dis parce que c'est vrai.
Je pense qu'il faut faire très attention, sur cette question de la mort
et de la joie. Le plus beau proverbe que je connaisse vient d'Egypte.
C'est une injonction : "Ne fais jamais peur à quelqu'un, n'inspire
jamais la peur à un autre être humain." Je trouve que c'est une
sentence magnifique. Et j'y ajouterai : n'injurie jamais la douleur de
l'autre, ne va pas trop vite, ne fais pas l'économie de ce que les
autres vivent. Comment pourrais-je vous dire cela ? J'ai de la joie à
aller dans les endroits, même les moins éclairés qui soient. Je pense,
par exemple, à des hôpitaux ou des maisons de retraite, endroits que je
continue de fréquenter. J'ai une joie profonde à traverser les
épaisseurs de grisaille, la dureté que le monde met sur certains
visages à la fin d'une vie. J'éprouve une joie profonde à enlever tous
ces voiles et à voir, soudain, deux yeux qui brûlent dans l'ombre.
L'humain est un soleil. La vie, voilà la seule merveille. Et c'est la
seule merveille non commercialisable. L'humain est un soleil que l'on
peut aller chercher dessous les décombres, dessous la fatigue, dessous
les pertes. Il n'y a rien de pire que de perdre un enfant. Rien de
pire. C'est connaître et éprouver l'hémorragie de ses propres forces.
Oui, la vie est très rude. Mais j'essaie de peindre, de livre en livre,
le sourire que je vois sur ces lèvres. Malgré tout. Je connais la perte
de qui on aime plus que tout. Et je le redis: la vie est peut-être cent
milliards de fois plus belle que nous l'imaginons - ou que nous la
vivons.
Qu'attendez-vous d'un livre, quand vous êtes lecteur ?
J'attends tout. Absolument tout. J'attends une paix immense - elle
vient souvent, monte du livre. J'attends de connaître un peu mieux mon
visage - il est si mouvant, de passage, comme celui de ceux qui nous
lisent en ce moment, comme le vôtre. D'un livre, j'attends qu'il
travaille comme un miroir, qu'il travaille pour moi. J'attends aussi
qu'il me donne, qu'une sorte de lumière monte de lui. Et j'attends,
enfin, de rencontrer un humain parce que je crois que c'est la chose
sans doute la plus rare au monde, une rencontre, une vraie rencontre.
J'attends qu'une personne sorte du livre et se mette à me parler et, en
me parlant, me découvre, moi.
Cette personne, est-ce l'auteur ou les personnages ?
L'auteur ! Au-delà des personnages d'un roman, je veux sentir la
personne de l'auteur. Je cherche le vivant. Un livre fonctionne comme
une baguette de coudrier, ces baguettes que l'on tient à la main et
dont les vibrations soudaines indiquent une source heureuse dans le sol
: certains livres indiquent une source heureuse dans notre esprit ou
dans le monde. Lorsque cela arrive, c'est la plus belle chose qui soit
!
Avec quel livre cela vous est-il arrivé ?
Jardins et routes, d'Ernst Jünger. Jünger est un écrivain allemand,
comme on sait, et qui a traversé les deux guerres mondiales. Jünger
n'est pas du tout l'homme sur lequel on a plaqué une image au mieux
austère, au pire militariste. Son oeuvre est comparable à celle de
Montaigne : c'est un homme qui traverse les épreuves de la vie, toutes,
avec noblesse, nonchalance parfois, en cherchant toujours ce qui
témoigne du surgissement coloré de la vie. Jünger a un esprit
passionnément contemplatif. Dans son Journal parisien, il assiste à la
première apparition de l'étoile jaune sur la poitrine d'une passante.
Et il note qu'il a cet instinct, ce geste qui le foudroie lui-même :
faire le salut militaire à cette jeune femme. Le salut militaire était
tourné ordinairement vers le puissant, vers le monstre, vers le Dieu
tout-puissant qui avait fait sa tanière en Allemagne et avait essaimé
partout. Mais ce salut donné au plus faible est, je trouve,
bouleversant. C'est magnifique! C'est une crête d'humanité! Et quand je
lis cela, je vois quelqu'un de vivant, parce que peut-être, vivant et
aimant, c'est pareil. Et parce que, aimant et être attentif à ce qui
est en train d'être broyé, c'est pareil.
Quelle place occupent les écrivains du Grand Siècle dans votre vie ?
Jünger est un grand collectionneur, un grand traqueur, un grand
chasseur d'insectes et de fleurs. Et un être attentif aux nuages. Il
appartient à cette grande tradition qui vient de Montaigne et de Pascal
et de Saint-Cyran. Le Grand Siècle ? Ses écrivains parlent au coeur,
tout de suite. Ils enfoncent la dague de leurs phrases dans le coeur du
lecteur, sans détours. Leurs livres sont comme des meurtres lumineux.
Des meurtres lumineux ?
Oui. C'est comme ça que je qualifierais la poésie ou la pensée
lorsqu'elle est à son plus haut. Quelque chose qui vous sort du monde.
Pour que vous puissiez commencer à voir et à comprendre ce qu'est cette
vie qui vous a été donnée, qui vous sera enlevée un jour, il faut
d'abord sortir du monde, sortir du somnambulisme dans lequel le monde
vous tient. Et pour cela, il vous faut un grand coup! La beauté, c'est
cette dague qui s'enfonce dans la poitrine ou l'âme du lecteur. Les
phrases de Pascal, des grands moralistes du XVIIe siècle, ces
pensées-là ont cet effet. Je les retrouve en amont chez Montaigne et en
aval chez Jünger : elles ont quelque chose de brûlant et de délivrant.
Tous ces écrivains ont l'art de resserrer le langage sur un point et un
seul.
Lequel ?
Comment se tenir dans la vie. Comment être à la hauteur de la vie, si noble et si fragile.
Diriez-vous que votre travail d'écriture s'apparente à cette tradition ?
La comparaison est beaucoup trop grande pour moi ! Mais, évidemment,
oui. Vous savez, je n'ai pas vraiment choisi d'écrire comme ça. J'ai
entamé une course, celle de la vie, et à chaque chute, à chaque genou
écorché, une page d'encre apparaît. Je frotte mes écorchures avec une
poignée d'encre pour les guérir. Et puis il y a, aussi, l'inverse,
c'est-à-dire les éblouissements.
Quels sont-ils ?
Tout ce qui arrive. Mais il n'arrive pas quelque chose tous les jours,
entendons-nous bien ! Le manège ne tourne pas tous les jours. Il est
parfois à l'arrêt, bâché. Mais quand quelque chose arrive, ça devient
pour moi une urgence de l'écrire, de le transmettre. En partageant la
joie, vous la multipliez. Et écrire, c'est partager pour
multiplier.
Et les jours où il n'arrive rien, comment les vivez-vous ?
Ce sont des jours où je dois avoir une tête un petit peu renfrognée,
chiffonnée. Une tête comme un papier froissé. Alors j'attends. Tout
simplement, j'attends. Sans impatience. C'est la seule sagesse que je
me connaisse.
L'attente, une sagesse ?
Oui, l'attente. Parce que je sais, d'expérience, que les portes fermées vont se rouvrir.
Comment peut-on attendre sans impatience ?
J'attends à la façon du pêcheur au bord de l'eau, vous voyez? Il n'y a
pas de prise, il n'y a rien, il n'y a pas une ride sur l'eau, la
lumière du ciel décroît, il commence à faire frais mais j'attends. Je
sais que rien n'est vain, même ces jours-là. Aujourd'hui, nous
commettons presque tous la même erreur : nous croyons que l'énergie,
c'est la vérité. Certes l'énergie est nécessaire... mais il y a une
mauvaise énergie.
Laquelle?
La mauvaise énergie est celle qui consiste à essayer de forcer les
chemins du ciel. La mauvaise énergie est celle qui veut accélérer
chimiquement les battements du coeur. La mauvaise énergie, c'est
vouloir tout tout de suite, les applaudissements avant même d'avoir
commencé l'effort... Notre époque veut du survitaminé. Elle a oublié la
lenteur. J'essaie, par les livres que j'écris, de retrouver cela, de
faire revenir la lenteur.
Ne faut-il pas avoir beaucoup souffert pour arriver à un tel détachement ?
[Long silence.] Je ne sais pas quoi dire.
La vérité.
Oui, la vérité... Mais, vous savez, la vie est tellement dure... La vie
a été beaucoup plus dure pour tellement plus de gens que pour moi...
Comment pourrais-je dire que j'ai souffert alors que se passent encore
certaines choses aujourd'hui ? Je dirais simplement, par pudeur, que je
n'ai pas abandonné l'enfant que j'étais. Voilà.
Et quel enfant étiez-vous ?
Un enfant qui ne faisait pas grand-chose. Qui regardait par la vitre.
Qui regardait ce qu'il se passait quand il se passait quelque chose.
Pensez-vous toujours que
nous prenons notre véritable visage et notre véritable force dans
l'enfance, qu'ensuite rien ne change ?
Oui, c'est ce qu'on appelle les caractères. C'est une drôle de chose :
il est possible que le caractère d'une personne ne change jamais. On
voit cela, dans la religion, par exemple. Prenez saint Paul. C'est
amusant car il est d'abord persécuteur des chrétiens avant d'être
renversé sur le chemin de Damas et de se convertir, de devenir le
premier défenseur des chrétiens. Mais il est aussi fou, aussi violent,
dans sa défense que dans son attaque ! Son caractère, passé le feu de
la révélation, est resté intact. Je crois donc, en effet, que l'on peut
retrouver chez chacun et à tout âge les traits de l'enfance. Ils sont
parfois encrassés, mais ils sont toujours là.
Dans L'Homme-Joie, cette
confession : "Si mes phrases sourient c'est parce qu'elles sortent du
noir." Comment convertir le drame en joie ?
Peut-être en éprouvant la sensation de confiance dans la base de la
vie. Il arrive que la vie soit partie. Que l'on soit délaissé,
abandonné. Chacun fait cette expérience tôt ou tard, et parfois sur une
durée très longue. Soit. Mais même dans ces moments-là, il y a quelque
chose qui ne nous quitte pas, que je ne saurais pas nommer, que je ne
veux pas nommer - parce que la nommer, ce serait l'abîmer et,
peut-être, la faire fuir à jamais. Il y a un point de confiance,
quelque chose en nous comme une petite chambre dans le coeur, dans
laquelle il ne faut laisser entrer personne. Pas même ceux que nous
aimons.
Pas même ceux que nous aimons ?
Pas même ceux que nous aimons, non. Parce que le coup peut aussi venir,
parfois, de ceux que nous aimons. Il y a quelque chose de plus haut, de
plus secret. Ce retrait-là permet de traverser tous les hivers, tous
les incendies. Pourquoi ? Je n'ai pas d'explications. C'est comme ça :
c'est là.
Vous n'aimez pas beaucoup
les explications. Dans L'Homme-Joie, vous promenant dans l'exposition,
magnifique, consacrée au peintre Pierre Soulages à Montpellier, vous
écrivez ceci, en parlant de sa peinture : "Je ne peux rien expliquer.
Expliquer n'éclaire jamais." Mais alors, qu'est-ce qui éclaire, d'où
vient la vraie lumière ?
La vraie lumière vient de ce que l'on ressent. Un enfant, même privé de
mots, comprend ce que disent les grands : il regarde les visages,
entend les inflexions des voix. Si on lui ment, il le sent ; si on lui
dit la vérité, il le sent ; si on est bienveillant envers lui, il le
sent. Ce savoir n'est pas explicable mais il nous porte tout au long de
notre vie. C'est une intelligence muette que la vie a d'elle-même.
Revenons à ce détachement... Vous évoquez, dans L'Homme-Joie, le moment
de sa vie où Glenn Gould, ce génie de l'interprétation et du piano,
décide de quitter la scène.
Pourquoi ce moment-là ? Faut-il y voir un éloge de la démission ?
Oui, c'est une démission mais c'est aussi une entrée dans quelque chose
qui est la pensée pure, c'est-à-dire la vie même. Imaginez un homme
dans la jeunesse de ses forces, applaudi dans le monde entier, à qui,
tout d'un coup, les applaudissements donnent une sorte de migraine,
l'empêchant de mener sa vie au mieux, c'est-à-dire de tendre vers ce
point qu'il cherche toujours et qu'on l'entend chercher dès qu'il
joue... C'est un point de silence, une sorte de précision, de pureté
cristalline, un état du monde et des étoiles. Gould lâche alors ces
facilités que sont les approbations et les applaudissements pour
revenir à sa tanière, pour ne plus se consacrer qu'à une seule chose.
J'essaie de mettre des mots sur cette chose. Il va vers son coeur. Il
déserte. Mais s'il déserte, c'est pour gagner la bataille.
Dans le monde actuel, comment faire pour garder intacte notre capacité d'émerveillement ?
Toujours ramener la vie à sa base, à ses nécessités premières : la
faim, la soif, la poésie, l'attention au monde et aux gens. Il est
possible que le monde moderne soit une sorte d'entreprise anonyme de
destruction de nos forces vitales - sous le prétexte de les exalter. Il
détruit notre capacité à être attentif, rêveur, lent, amoureux, notre
capacité à faire des gestes gratuits, des gestes que nous ne comprenons
pas. Il est possible que ce monde moderne, que nous avons fait surgir
et qui nous échappe de plus en plus, soit une sorte de machine de
guerre impavide. Les livres, la poésie, certaines musiques peuvent nous
ramener à nous-mêmes, nous redonner des forces pour lutter contre cette
forme d'éparpillement. La méditation, la simplicité, la vie ordinaire :
voilà qui donne des forces pour résister. Le grand mot est celui-là :
résister.
A vous lire, à vous
écouter, on a l'impression que vivre est une chose simple : il suffit
d'y consacrer chaque seconde de sa vie ! Dans vos livres, vous semblez
dire que si nous avons pratiqué ces actes de résistance et même si la
vie nous submerge, ce n'est pas grave...
C'est lié à la joie. Il faut savoir perdre. Et trouver la joie dans la
défaite. Je vais vous donner un exemple que tout le monde va comprendre
tout de suite. Quand on a trente ans à peu près, l'âge des bandes
d'amis, et que c'est l'été, cette saison incroyablement belle, et que
l'on tente de traverser une rivière sans trop se mouiller, que fait-on
? On passe d'un galet à l'autre. On peut gagner, c'est-à-dire arriver
sur l'autre rive indemne. Mais on peut aussi perdre tout d'un coup,
glisser brusquement, tomber, se mouiller... et s'apercevoir que perdre,
c'est encore plus drôle que de gagner, et que ce n'est pas grave ! Ce
qui comptait, ce n'était pas d'atteindre l'autre rive indemne mais
d'être ensemble, vivant, de se réjouir de petits riens comme ceux-là.
Et vous, vous avez beaucoup perdu ?
On ne parvient pas à un certain âge sans avoir perdu. Beaucoup, oui. Ce
que j'ai perdu est irrattrapable. Je ne parle ni des objets ni des
biens ni même de l'argent mais des êtres. J'ai perdu des êtres qui
étaient pour moi des sources de soleil. Ce soleil a été mis en terre.
Apparemment mis en terre. Moi, je pense que je continue à en recevoir
les rayons. Mais je sais aussi, en même temps, que c'est une perte et
qu'elle est irrattrapable. Je sais les deux choses. Que dire de plus?
Avec l'aimable autorisation de France Inter
Février 2013
Ecoutez France Inter
Retour à la Culture
Retour au sommaire
|