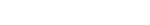|
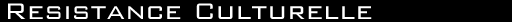
Hommage à Alain Resnais
Par Jacques Mandelbaum

Né
à Vannes, dans le Morbihan, le 3 juin 1922, le cinéaste Alain Resnais
est mort samedi 1er mars à Paris « entouré de sa famille », a annoncé
son producteur Jean-Louis Livi. Il avait 91 ans.
Sa longévité, son élégance, sa discrétion, son impeccable tignasse
blanche arborée depuis si longtemps qu'on avait fini par oublier qu'il
fût jamais jeune, tout cela faisait d'Alain Resnais une sorte de statue
du commandeur du cinéma d'auteur français, aussi folâtre et
expérimentateur fût-il en réalité. Car jeune, il l'a été
indubitablement un jour, et sans doute devait-il sa science de la
conservation au fait de l'être resté plus longtemps que tout autre.
Là-dessus flotte toujours un mystère. Le sentiment d'une jeunesse volée
parce que fils unique, et asthmatique, de pharmacien catholique dans
une ville de province ? L'imprégnation durable de l'éblouissement
surréaliste et de sa glorification de l'enfance ? L'amour invétéré
de la bande dessinée, du serial, du roman populaire ? Le fait d'avoir
eu vingt ans sous l'Occupation ? Jeune donc, forever, et rapidement
scandaleux, surprenant, comme on dit : moderne. Plus prompt à le
devenir en tous cas, même si c'était d'un cheveu, que les Jeunes Turcs
de la Nouvelle Vague, qui le toisent admiratifs depuis l'autre rive de
la Seine..
C'est bien la même génération : tous ont
connu la seconde guerre mondiale, tous en sont sortis avec le désir de
renouveler le cinéma, sinon le monde. Dans le match qui ne fut jamais
réellement disputé entre rive gauche (Alain Resnais, Chris Marker,
Agnès Varda...) et rive droite (la bande des Cahiers du cinéma :
Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques Rivette, Claude Chabrol,
Eric Rohmer...) de la révolution cinématographique en marche, les
premiers penchent de fait à gauche, et les seconds à droite, mais même
cela ne tarde pas à bouger.
RESNAIS ET LA SCIENCE DU MONTAGE
Ce qui est plus assuré, c'est que les premiers sont des champions,
reconnus pour tels, du montage. Qui dit montage dit coupe, taille,
façonnage de la réalité, cinéma d'intervention, d'idées, de concept. Et
c'est bien d'un art virtuose du montage, subtil et percutant, que
procèdent les premiers coups d'éclat d'Alain Resnais à travers ses
courts-métrages documentaires. Il y met à profit les cours de l'Idhec,
école de cinéma créée par le gouvernement de Vichy où, à 21 ans, on le
compte en 1943 parmi les élèves de la section montage. L'Histoire est
friande de ces télescopages. Car la science du montage de Resnais, en
même temps que dans la matière filmique, coupe et raccorde dans
l'Histoire, autrement dit y prend un parti.
Et ce parti est pour le moins incisif. Guernica (1950), montage-choc
autour du lamento antifasciste de Pablo Picasso. Les statues meurent
aussi (1953), censuré jusqu'en 1964, charge insolente contre le
colonialisme culturel avec les mots ciselés de Chris Marker, sous le
regard anguleux, démultiplié et ténébreux de sculptures africaines. Le
Chant du styrène (1958), ode ambiguë à la matière plastique de chez
Pechiney, rythmée par des explosions de couleurs en scope, et enlevée
sur des alexandrins pince-sans-rire signés Raymond Queneau (« O
temps, suspend ton bol… »).
« NUIT ET BROUILLARD »

Cette veine du montage souverain aura culminé dès 1956 avec Nuit et
brouillard. A l'origine, il s'agit d'un film de commande du Comité
d'histoire de la seconde guerre mondiale, qui propose un montage
d'archives d'une trentaine de minutes destiné à célébrer le dixième
anniversaire de la libération des camps nazis. A l'arrivée, Nuit et
brouillard est un film terrassant qui s'inscrit en lettres de feu dans
la double histoire du cinéma et de la mémoire de la barbarie nazie.
Le noir et blanc des atrocités d'hier ne cesse d'y inquiéter la couleur
d'un paysage d'aujourd'hui, apaisé. Sur cet effet de montage
saisissant, qui fait de la barbarie une présence désormais installée
dans la chair du monde, le texte de Jean Cayrol revient en contrepoint
: « Même un paysage tranquille, même une prairie avec des vols de
corbeau, des moissons et des feux d'herbe, même une route où passent
des voitures, des paysans, des couples, même un village de vacances,
avec une foire et un clocher, peuvent conduire tout simplement à un
camp de concentration. »
On doit ce chef-d'œuvre à Resnais, qui le réalise, évidemment, mais
encore à Anatole Dauman, qui le produit, à Cayrol, ancien déporté qui
en écrit le commentaire, à Chris Marker, qui le retouche en sous-main,
à Michel Bouquet, qui le fait entendre et ne veut pas que son nom
apparaisse au générique en hommage à la mémoire des déportés, à Hanns
Eisler, collaborateur de Brecht, qui en compose la musique.
Ce film qui prend rendez-vous avec la postérité est aussi de son
époque. En l'état de la recherche historique et de la construction
mémorielle au mitan des années 1950, la conscience de la spécificité du
génocide juif ne s'y impose pas (il faudra attendre pour cela le Shoah
de Claude Lanzmann en 1985).
LA SILHOUETTE DU GENDARME FRANÇAIS
La question revient donc par la bande, pour nourrir un scandale. Une
des images du film montre en effet une photographie du camp
d'internement de Pithiviers, où l'Etat français parque les Juifs dans
l'attente de leur déportation par les nazis. Sur cette image, au
premier plan, la silhouette d'un gendarme français dans un poste de
guet. La commission de contrôle exige aussitôt la suppression du plan.
Echaudé par l'expérience des Statues meurent aussi, Resnais, soutenu
par son producteur, réclame d'abord une demande écrite, puis maintient
la photographie en barrant d'un bandeau noir la silhouette de la honte,
rendant ainsi visible l'occultation de la collaboration. Le film sera
vu ainsi jusqu'en 1997.
Ce n'est pas le seul déshonneur infligé par l'Etat français à ce
chef-d'œuvre. Comme le veut la tradition à l'époque, la commission de
sélection des films français au Festival de Cannes soumet ses choix au
secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce. Nuit et brouillard fait
alors partie de la compétition. Mais le titulaire de la fonction, qui
se nomme pour la petite histoire Maurice Lemaire, met son veto sur ce
seul film. Les associations de déportés, qui le soutiennent en
revanche, créent un tel scandale que le gouvernement accepte le
compromis d'une présence du film à Cannes, mais hors compétition.
Qu'importe, Nuit et brouillard, montré à des générations de lycéens
français, et bien au-delà de la France d'ailleurs, fera l'effet à
beaucoup de ses spectateurs d'un choc fondateur. Ainsi du critique
Serge Daney, qui l'écrit magnifiquement dans un texte devenu lui aussi
célèbre (« Le travelling de Kapo » paru dans la revue Trafic en 1992) :
« Resnais fut pour moi un passeur de plus. S'il révolutionnait comme on
disait alors le “langage cinématographique”, c'est qu'il se contentait
de prendre son sujet au sérieux et qu'il avait eu l'intuition, presque
la chance, de reconnaître ce sujet au milieu de tous les autres : rien
de moins que l'espèce humaine telle qu'elle était sortie des camps
nazis et du trauma atomique : abîmée et défigurée. »
« HIROSHIMA MON AMOUR »

Quant au malheureux Alain Resnais, il n'en a pas fini avec la
malédiction cannoise, qui le poursuivra peu ou prou toute sa vie. Son
premier long-métrage, Hiroshima mon amour (1959), rien de moins, y est
ainsi mis hors compétition par les arbitres des élégances de l'époque,
à rebours du jeune François Truffaut qui y concourt avec Les Quatre
Cents Coups, après avoir copieusement insulté l'institution l'année
précédente. Allez comprendre. Il faut croire que les raisons en sont
diplomatiques. Cannes est aussi à cette époque une machine destinée à
maintenir la guerre froide. Il s'agit aujourd'hui de n'y pas choquer
les Etats-Unis, comme hier l'Allemagne (Nuit et brouillard), comme
demain l'Espagne (La guerre est finie).
Le plus politique des cinéastes français avec Godard – du moins à cette
époque – en fait logiquement les frais. Hiroshima mon amour, sur un
scénario et des dialogues de Marguerite Duras, raconte l'histoire d'une
actrice qui vient tourner dans la ville un film pour la paix, et y
rencontre un architecte japonais avec lequel elle a une liaison. Il lui
parle de la tragédie collective causée par la bombe d'Hiroshima, elle
lui répond par l'infamie publique de Nevers, tondue parce qu'elle aima
un soldat allemand. Emanuelle Riva et Eiji Okada interprètent ce film
inoubliable, dont l'apport à l'art cinématographique est impressionnant
: diffusion du passé dans le présent, discontinuité narrative, bande
sonore obsédante, transvasement réciproque du réel et de l'imaginaire,
flux de conscience.
RESNAIS ET LA GUERRE D'ALGÉRIE
Deux ans plus tard, après avoir entre-temps signé le manifeste des 121
(qui réclamait le droit à l'insoumission pour la guerre d'Algérie),
Resnais double la mise avec L'Année dernière à Marienbad (1961), film
écrit avec le chantre du nouveau roman Alain Robbe-Grillet. Le fond
politique est cette fois mis de côté, en faveur d'une étrange séance
d'incubation filmée entre un studio parisien et un jardin bavarois. Un
homme tente d'y convaincre une femme (la débutante Delphine Seyrig) qui
ne le croit pas qu'ils se sont aimés sur ces lieux, l'année précédente.
Motif obsessionnel, qui se joue dans un palace baroque devenu
projection labyrinthique d'un univers mental situé comme hors du temps.
Mais de même que le film, curieusement, n'est pas tourné à Marienbad,
le nom allemand de cette ville d'eau tchèque est-il alors caduc. Plus
propice à Resnais que Cannes, la Mostra de Venise décerne le Lion d'or
à cette œuvre mystérieuse et provocatrice.
Ceux qui reprochaient (déjà) à Resnais de s'être coupé de son époque en
sont pour leurs frais : en 1963, Muriel et le temps d'un retour aborde,
notamment, les zones brûlantes de la torture en Algérie. On y retrouve
Delphine Seyrig en veuve recroquevillée sur elle-même, faisant
profession d'antiquaire à domicile à Boulogne-sur-Mer. Un huis clos
trouble la met en présence de son beau-fils qui revient de la sale
guerre d'Algérie durablement traumatisé, d'un vieil amour de jeunesse
fuyant et affabulateur et d'une jeune actrice qu'il veut faire passer
pour sa nièce.
Valse amère des souvenirs, mensonges, remords, malentendus,
incompréhensions : de l'Occupation à la guerre coloniale, tout un passé
qui ne passe pas taraude cette petite bourgeoisie tétanisée qui habite
une ville elle-même en proie aux stigmates du passé. Un film immense,
d'une cruauté inexorable. En 1966, Resnais poursuit sa traversée de
l'histoire contemporaine avec La guerre est finie.

Scénarisé par Jorge Semprun qui, deux ans auparavant, s'est fait
exclure du Parti communiste espagnol clandestin et s'inspire de son
expérience personnelle, le film est interprété par Yves Montand. Les
deux hommes seront trois ans plus tard au service du célébrissime Z de
Costa Gavras. Montand interprète un rôle ici plus complexe, non pas
tant de pure victime que de militant communiste assailli par un ennemi
plus grand encore que le fascisme : le doute. Le film saisit aussi
bien, durant trois jours déterminants de son existence, la prise de
conscience de Diego, agent clandestin pris entre deux pays, mais aussi
bien deux femmes (la marmoréenne suédoise Ingrid Thulin, échappée des
macérations bergmaniennes, et la piquante débutante canadienne
Geneviève Bujold), deux identités, deux vies. De nouveau, c'est la
panade cannoise, le film étant cette fois retiré de la compétition
après intervention officielle de l'Espagne.
DÉSENGAGEMENT DES QUESTIONS POLITIQUES
Il est plus singulier de constater qu'à rebours des trois films
précédents, La guerre est finie semble être quasiment effacé de la
mémoire collective. On y voit un sens. Ce film marque, en vérité, un
imperceptible infléchissement dans le cinéma de Resnais, qui aboutira
bientôt à une mutation visible : son désengagement des questions
politiques au profit d'une exploration de l'intimité. Bien sûr, Resnais
n'a jamais conçu son cinéma comme militant. La question politique,
l'attention portée aux violences de l'Histoire auront toujours été,
dans son œuvre, indissociables d'une préoccupation plus générale sur
l'imaginaire, la mémoire et le temps, comme facteurs constitutifs d'une
insaisissable et fragile identité.
Il n'en reste pas moins qu'un changement de cap va marquer sa carrière,
au point que, dans le public comme dans la critique, deux réactions
antagonistes accueilleront cette inflexion. La déception, au titre
d'une démission qui frapperait désormais de vanité son goût de
l'expérimentation formelle. Ou la fidélité à l'ingénierie stylistique
qu'il continuera de déployer, avec brio, de film en film. En tout état
de cause, il faut se satisfaire de ce paradoxe : c'est à l'approche de
mai 1968, alors que culmine l'engagement idéologique, qu'Alain Resnais
abandonne ses prérogatives de cinéaste concerné par les grands enjeux
de son époque. Un personnage qu'il nomme Claude Ridder lui sert
d'instrument dans cette opération, en deux temps.
Le premier est la participation de Resnais, en 1967, à un film
collectif et militant intitulé Loin du Vietnam. Bernard Fresson
interprète, dans ce court-métrage tourné en un certain sens contre la
dimension militante du film, un romancier, intellectuel de gauche, qui
se met à douter sévèrement de ses convictions et de son engagement.
Comme geste engagé, on a fait mieux.

Le second est le long-métrage Je t'aime je t'aime (1968) dans lequel
Claude Rich endosse à son tour le patronyme liquidateur. Il y incarne
le survivant d'une tentative de suicide qui se laisse persuader par des
scientifiques de voyager dans son passé pour y découvrir les raisons de
son mal-être. L'expérience tourne mal et Ridder, installé dans une
sorte de vulve géante, s'anéantit dans les souvenirs détraqués d'une
vie sans qualité, marquée par le fantôme d'une femme défunte. Hommage à
La Jetée de son ami Chris Marker, écrit par Jacques Sternberg, cet
étrange et séduisant récit de science-fiction – faut-il le préciser ? –
ne passera jamais à Cannes où il est pourtant le premier film de
Resnais accepté en compétition. Manque de chance, cette fois c'est le
festival qui s'arrête pour cause de révolution en marche. Ironie du
sort, Je t'aime, je t'aime inaugure pourtant ce moment important de
l'œuvre de Resnais où le personnage passe du statut de sujet de
l'Histoire à celui de sujet d'expérience.
OBSESSION DE LA MORT
Suite à l'échec public du film et à une série de déconvenues aux
Etats-Unis, c'est la rencontre avec le célèbre agent Gérard Lebovici
qui permet à Resnais de se relancer selon ce nouveau paradigme. Si le
cinéaste ne s'est jamais vraiment expliqué là-dessus, il faut croire
que quelque chose s'est produit en lui à cette époque qui l'incline à
ce raisonnement : à quoi bon chercher la résolution collective des maux
humains dès lors que l'individu ne s'appartient pas, étant pour
lui-même un insondable et douloureux mystère ?

Ce n'est donc plus à l'Histoire comme mouvement collectif que se
confronte désormais le romanesque chez Alain Resnais. C'est aux
affabulations d'un escroc mondain (Stavisky, 1973), à l'inconscient
déchaîné d'un vieil écrivain malade (Providence, 1977), aux théories
neurophysiologiques du professeur Laborit sur le comportement humain
(Mon oncle d'Amérique, 1980), à l'utopie enfantine incessamment trahie
par les adultes (La vie est un roman, 1983), à l'amour tel qu'il ne
peut que rejoindre la mort (L'Amour à mort, 1984). Deux mouvements
caractérisent ces films. Une descente de plus en plus marquée dans les
profondeurs (pulsion sexuelle, assouvissement du désir, instincts de
domination, lutte pour la survie) qui ravalent l'homme à sa nature
animale. Et la montée concomitante d'une obsession de la mort, de la
maladie, du suicide.

Sombre période, pleine d'angoisse et de pessimisme, de laquelle Resnais
finit par sortir en entrant en théâtre, en y trouvant plus exactement
une inspiration qui se substitue à la longue fréquentation des
écrivains qui aura marqué le début de sa carrière. Ce recours au
théâtre semble devoir porter un coup d'arrêt à l'inquiétude dévorante
qui a fini par s'emparer du réalisateur devant le malheur persistant de
l'homme et la faillite des systèmes censés le prévenir.

AZÉMA, ARDITI, DUSSOLIER : LA TROUPE FIDÈLE
Le théâtre, du moins, apporte-t-il la sûreté d'une convention, la
séduction d'un simulacre, l'intelligence d'un artifice. L'hypothèse,
aussi, d'une joie enfantine, d'un plaisir partagé, d'un jeu
possiblement infini. Alain Resnais va s'y claquemurer, y réunir une
petite troupe fidèle (Sabine Azéma, Pierre Arditi, André Dussollier,
Fanny Ardant, Lambert Wilson…) et tenter, de décor en décor, d'y
réenchanter le monde. Son nouveau credo pourrait tenir dans cette
formule : « Je hais le soleil, c'est un projecteur qu'on ne peut pas
déplacer. »

Ce cycle, qui domine toute la fin de la carrière du cinéaste, commence
en 1986 avec Mélo, une pièce adaptée d'Henri Bernstein, boulevardier
poussiéreux et cible des ligues antisémites dans l'entre-deux-guerres.
Cette impertinence contre-culturelle et anachronique permet à Resnais
d'organiser autour du triangle classique (mari-femme-amant incarnés par
le trio canonique Arditi-Azéma-Dussollier) une sorte de vaudeville,
soit un mouvement qui verse insensiblement de la gaudriole à la
tragédie.
Deux titres suivront, grâce auxquels l'image de Resnais est comme
réimplantée dans le code génétique du public de cinéma français, celle
d'un vieux monsieur pas si grave qu'il en a toujours eu l'air, grand
fantaisiste caché sous un imperméable taupe. Il s'agit, bien sûr, de
Smoking/No smoking (1993) et On connaît la chanson (1997). Le premier
est un exercice virtuose, adapté de l'auteur dramatique anglais Alan
Ayckbourn. Il met en scène Sabine Azéma et Pierre Arditi dans dix rôles
différents et deux films divergents, dont les prémisses respectives
tiennent à la décision d'un personnage d'arrêter ou de continuer de
fumer.
« ON CONNAÎT LA CHANSON », PLUS GROS SUCCÈS DE RESNAIS

Anglophile, maniaque, facétieux, vertigineux, Smoking/No smoking est
l'art de la combinaison poussé à sa meilleure extrémité. On connaît la
chanson, scénarisé, dialogué et interprété par Agnès Jaoui et
Jean-Pierre Bacri, qui avaient déjà adapté le précédent, est une
fantaisie sentimentale dépressive et néanmoins chantée qui met dans la
bouche des acteurs des tirades de chansons populaires en version
originale. C'est le plus gros succès d'Alain Resnais, avec 2 600
000 entrées.
Une part de malentendu l'entoure, l'allant des ritournelles grisant les
spectateurs et les empêchant de voir le vide fantomatique qu'elles
comblent chez les personnages. Car on ne se refait pas. Mise
provisoirement entre parenthèses entre les planches du théâtre, la mort
revient à grands pas y rejoindre le cinéaste.
Le philosophe Gilles Deleuze l'avait fort bien vu : « Resnais n'a qu'un
sujet : l'homme qui revient de la mort. » La plupart de ses films, en
effet, envisagent la refondation d'un monde après le désastre. Ce que
n'eut pas le temps, hélas, d'observer Deleuze, c'est qu'à quatre-vingts
ans, l'hypothèse d'en revenir devient très improbable. Resnais fait
donc de cette perspective ce qu'il sait le mieux faire : en jouer.
Organiser, en un mot, sa sortie pour mieux la conjurer. Chorégraphier
un ballet d'ectoplasmes belle époque (Pas sur la bouche, 2003),
éteindre les désirs sous un tapis de neige (Cœurs, 2006), s'envoler au
pays de l'enfance éternelle (Les Herbes folles, 2009), convier à sa
propre veillée funèbre ses acteurs préférés sous l'invocation de Jean
Anouilh (Vous n'avez encore rien vu, 2012), puis bisser le coup en
revenant à ce cher Alan Ayckbourn (Aimer, boire et chanter, 2014).
Ainsi, jusqu'à son dernier souffle, ce cinéaste né dans un siècle de cendres aura cultivé, tel le Phénix, l'art d'en renaître..
2 Mars 2014
Abonnez-Vous au Monde
Retour à la Culture
Retour au sommaire
|