Joseph Stiglitz: «Le mode de vie américain n'est pas tenable» Par Grégoire Biseau ET Fabrice Rousselot 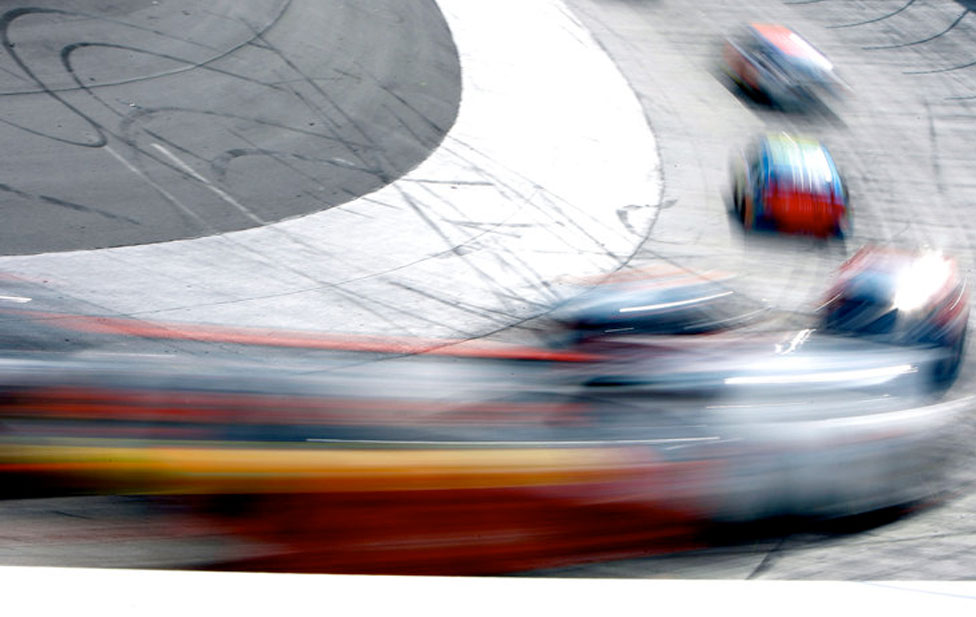
Il faut aussi considérer le coût de la démobilisation et du rapatriement des soldats et des équipements, et l’argent qu’il nous faudra dépenser pour rebâtir des forces armées aussi performantes qu’avant l’intervention en Irak. Enfin, reste le coût lié au rapatriement des soldats blessés et handicapés. Vous évoquez aussi les coûts sociaux ? Il y a les coûts sociaux micro-économiques et macro-économiques. Premier exemple : lorsqu’un soldat fortement handicapé revient d’Irak, souvent, l’un des membres de sa famille est obligé d’arrêter de travailler pour l’aider. Il faut alors prendre en charge cette famille et lui assurer des aides financières. En terme macro économique, il est évident que la guerre en Irak a eu un effet négatif sur l’activité américaine. Quelles sont les conséquences de la guerre sur l’économie américaine ? Tout d’abord, la guerre a contribué à l’augmentation des prix du pétrole. Les prix ont grimpé bien au-dessus de 100 dollars le baril et les experts les plus prudents estiment que 5 à 10 dollars de la hausse lui sont imputables. En 2002, les marchés énergétiques avaient analysé l’évolution du prix du pétrole pour les dix ans à venir. Selon eux, la production suivrait l’accroissement de la demande et le prix du baril serait relativement stable. L’Irak a totalement changé l’équation, principalement du fait de l’instabilité qui a gagné le Proche- Orient. Et l’un des effets pervers fut que les producteurs de pétrole, qui ont perçu des revenus plus importants, ont décidé pour certains de ne pas accroître leur production. Ensuite, il faut considérer les faibles retours sur investissement de cette guerre. L’argent dépensé en Irak, quand on paye une entreprise de travaux publics népalaise par exemple, ne profite pas de la même façon à l’économie américaine que si l’on construisait une école ou un parc de jeux.  L’intervention en Irak a-t-elle joué un rôle dans la crise des subprimes… Oui, tout à fait. Le Président Bush a déclaré que la guerre n’avait rien à faire avec les problèmes économiques, que les Américains avaient simplement construit et acheté trop de maisons. Mais il faut essayer de comprendre. Parce que l’économie américaine était plus faible, la FED (Réserve fédérale) a voulu créer plus de liquidités, elle a donc décidé de garder les taux d’intérêts à des niveaux très faibles tout en laissant se développer de nombreux produits de crédits, sans aucun contrôle. Cela a permis de maintenir l’activité à un certain niveau pendant un certain temps, et cela a préservé aussi la bulle immobilière. L’économie américaine avait des problèmes et la guerre en Irak les a aggravés. Les économistes ont cru que nous étions entrés dans une nouvelle ère. La hausse du pétrole semblait ne pas affecter autant que cela l’économie, pas comme elle le faisait depuis les années 70. Mais en fait, c’est parce que l’on supportait à bout de bras cette même économie que l’effet était moindre. En un an, en 2006, plus de 900 millions de dollars ont été consacrés aux remboursements d’emprunt. C’est énorme dans une économie qui pèse 13 trillions de dollars. Le problème est que nous sommes au bord de la récession et que notre marge de manœuvre est considérablement réduite. En 2008, le déficit américain sera vraisemblablement de 500 milliards de dollars : nous n’avons plus les moyens de stimuler l’économie. Les dépenses consacrées à l’industrie de la défense peuvent-elles avoir des effets positifs sur l’économie en matière de retombées technologiques ? Bien sûr, certains secteurs en ont bénéficié. Mais dans sa globalité, l’argent dépensé pour la guerre n’accroît pas la productivité future des Etats-Unis. Pas de la même façon que si l’on avait investi dans les infrastructures ou la recherche. On note des bénéfices ponctuels et marginaux, dans les industries spécialisées pour les prothèses, à cause des blessés. Mais c’est sans comparaison avec les bénéfices que l’on aurait pu retirer si l’argent avait été investi dans l’amélioration de l’état de l’économie. Peut-on parler de récession ? Officiellement, l’économie fait face à un fort ralentissement. La crise des subprimes n’est pas terminée. Dans de nombreux cas aux Etats Unis, la valeur de l’emprunt immobilier dépasse celle de la maison. Ceux qui ne peuvent plus payer leurs emprunts sont souvent confrontés au chômage. Les gens se voient proposer des formules de crédit qui aggravent leur situation et prolongent leur endettement. On leur suggère de payer moins les trois premières années, en faisant le calcul que leur maison va prendre de la valeur et qu’ils pourront rembourser plus tard ou revendre leur bien. Seul problème : l’immobilier est en chute et tous ces montages s’écroulent. Tout cela était un leurre. De plus en plus d’emprunts s’effondrent forçant les gens à quitter leurs maisons. Et ça va continuer. Le gouvernement veut que les Américains aient confiance en leur économie. Il parle d’une situation de l’emploi stable, de croissance à 0,6 % du PIB. Mais on constate deux choses: la consommation, qui soutient la croissance, tient beaucoup à l’écoulement de stocks qui n’étaient pas vendus. Les ventes commerciales sont dans le rouge. Côté emploi, l’offre n’a pas progressé depuis six mois, il y a même moins d’heures de travail sur le marché. Un signe clair que l’économie est malade. La crise des subprimes va-t-elle continuer à affecter l’économie européenne ? Oui. De nombreuses banques européennes ont acheté des produits dérivés des subprimes et en subissent le contrecoup. De plus, si l’économie américaine continue à ralentir, l’une de ses rares forces restent les exportations, à cause de la faiblesse du dollar vis-à-vis de l’euro. Tout cela n’est pas bon pour l’Europe.  On assiste à une flambée des prix du pétrole, des émeutes de la faim, une crise mondiale, des menaces de récession… Est-ce une juxtaposition de crises indépendantes ou une seule et même crise ? Ces crises sont liées entre elles, mais elles ont leur propre dimension. La crise pétrolière est liée à la situation de la guerre en Irak. Celle des subprimes, une conséquence de la guerre et de la hausse du baril. La crise alimentaire, via l’essor des bio carburants, résulte de la crise pétrolière. L’Inde a eu raison d’être très énervée lorsque George Bush avait montré du doigt les grandes économies émergentes comme responsables de la crise alimentaire mondiale. Or en matière d’agriculture, il n’y a eu aucune surprise : les Chinois ne se sont pas décidés à manger plus de céréales et de porc du jour au lendemain. La vraie surprise, l’événement totalement inattendu, c’est la guerre en Irak. Et comme le prix du pétrole a grimpé de façon soudaine et violente, les Etats-Unis ont augmenté les subventions à la production d’éthanol, entraînant la hausse des céréales… A vous entendre, la guerre en Irak serait au commencement de toutes ces crises ? Elle a en tout cas une grosse part de responsabilités. Peut-être que ces crises se seraient passées de toute façon, mais la guerre les a précipitées et les a amplifiées. Pourquoi avez-vous accepté l’invitation de Nicolas Sarkozy à participer à sa commission de réflexion sur le changement des instruments de mesure de la croissance française ? C’est une commission d’abord nationale, mais les problèmes dont on va parler sont globaux. En clair : comment mesurer les performances et le progrès social d’une économie. C’est très important car ce que vous mesurez dans les statistiques conditionne ce que vous faites en matière de politique économique. Par exemple, l’Argentine dans le milieu des années 90 donnait l’impression d’aller très très bien, notamment à travers la mesure de la croissance de son PIB. Mais cette croissance, basée sur la consommation, était financée par l’étranger et ne pouvait donc pas perdurer. D’où la crise qui a ensuite éclaté. Donc la mesure du PIB ne dit rien sur le caractère soutenable de la croissance. Et on pourrait dire aujourd’hui la même chose des Etats-Unis. L’ONU a développé un indicateur du développement humain, qui intègre ce que vous dépensez en matière d’éducation ou de santé… Et bien à l’aune de cette statistique, les Etats-unis se retrouvent la dixième économie mondiale. Dans ce débat, la France présente-elle des spécificités ? Je vois deux ou trois choses. D’abord, beaucoup de gens considèrent que le système de santé français, si vous le comparez à celui des Etats-Unis, est beaucoup plus performant. En terme de sécurité, de qualité et aussi d’accès aux soins, notamment pour les moins favorisés. Et cela est largement sous-évalué. Ensuite, c’est l’environnement. Les Français sont très sensibles aux questions écologiques, et le PIB n’intègre aucune trace de cela. Enfin, c’est la valeur que vous accordez aux loisirs. Dans une économie qui fonctionne bien, c’est très important qu’un chômeur qui veut travailler puisse trouver un travail rapidement. De même, un salarié qui souhaite passer plus de temps avec sa famille, doit pouvoir le faire. C’est le signe d’une société qui a choisi de profiter de la hausse de la productivité. Donc si vous mesurez le progrès social par des indicateurs économiques conventionnels, vous passez à côté de tout ça. Et la richesse que vous mesurez est bien moindre. On est, là, très loin du modèle américain, pourtant beaucoup plus performant en terme de croissance… Ce qui se passe aux Etats-Unis est contraire à ce qu’enseigne la théorie économique élémentaire. Selon elle, quand une économie devient plus productive, vous profitez normalement d’une augmentation du temps libre. Or, les Etats-Unis évoluent dans un sens opposé. Quelque chose ne fonctionne pas. Par ailleurs, le mode de consommation et de production américain, n’est absolument pas tenable en matière de préservation de la planète. Avec le modèle américain, le monde n’est pas viable. Dans un peu moins de cent ans, la Chine va avoir la capacité de consommer ce que consomment les Etats-Unis. Si cela devait arriver, ce serait une catastrophe pour la planète. Et comme il est impossible de dire aux pays en voie de développement, «vous allez vous restreindre pour nous permettre de continuer à consommer comme aujourd’hui», il n’y a pas d’autres choix que de changer de modèle de croissance. Y-a-t-il une prise de conscience de cette révolution dans la société américaine ? Ça commence à peine. Les Américains sont en train de se rendre compte qu’il va consommer moins d’essence. Mais ils n’ont pas mesuré l’amplitude de cette réduction ni ce que cela va signifier en matière de changement de comportement. Vous êtes optimiste sur le fait que le futur président américain marquera une rupture vis-à-vis de l’administration Bush sur les questions climatiques … Oui. Et y compris, si John Mac Cain est élu. Je suis très critique vis-à-vis de son programme économique et de sa position sur l’Irak, mais je suis convaincu qu’il est concerné depuis longtemps par le réchauffement climatique. Mais il sera toujours très attentif aux intérêts des grandes entreprises et défendra en priorité les solutions qui sont compatibles avec le mécanisme de marché, comme les permis à polluer. De toute façon, le mouvement est irréversible: il n’y a qu’à voir avec quel sérieux les autorités chinoises s’attaquent au problème. Le pouvoir central de Pékin a encore du mal à faire descendre ce message dans les provinces. Et je suis convaincu qu’on est juste au commencement d’un long processus qui ne s’arrêtera pas. Savoir mesurer et évaluer les coûts environnementaux dans la création de richesse nationale est la condition pour faire évoluer la société dans son ensemble. Mai 2008 Abonnez-vous au Monde Retour à l'Economie Retour au Sommaire
|
 |
