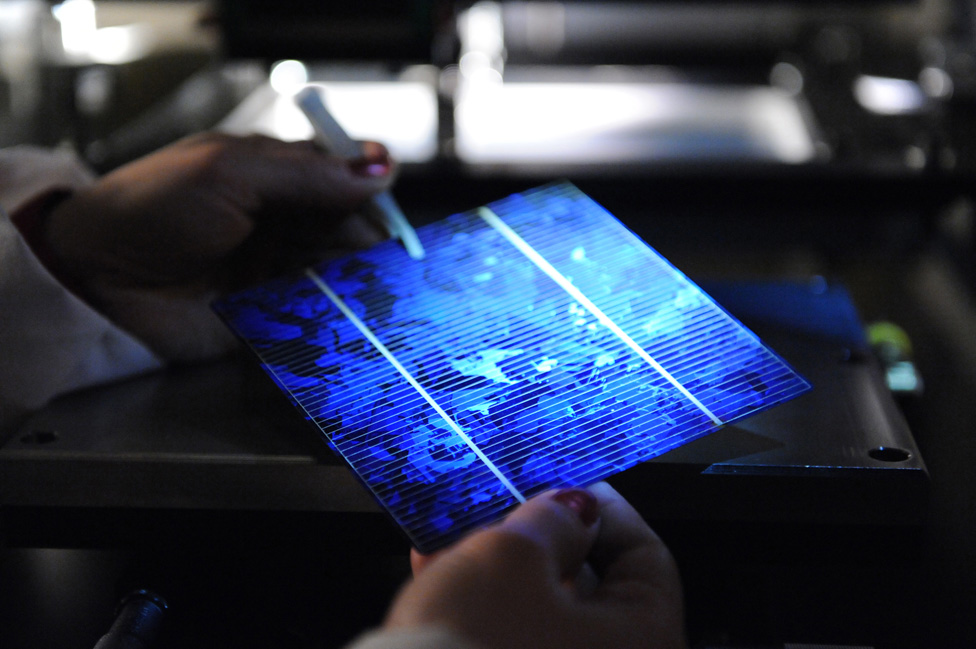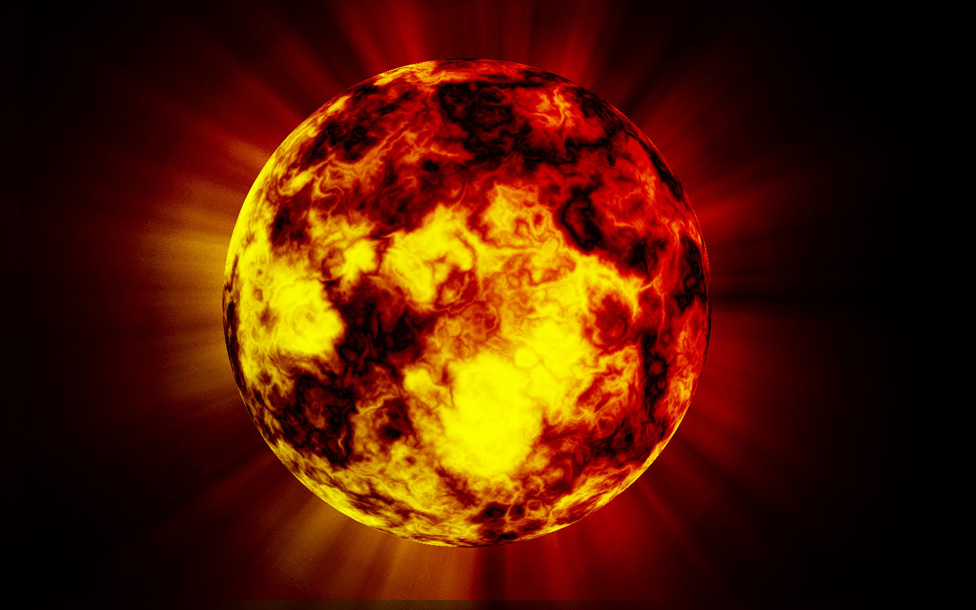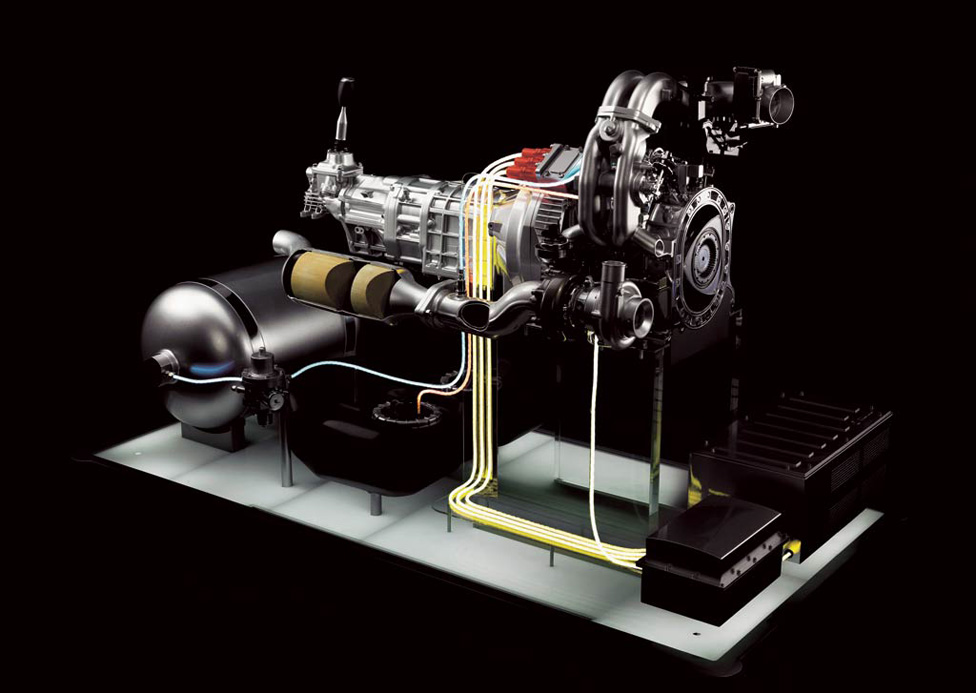Sur la piste de l'hydrogène
Avec le CNRS
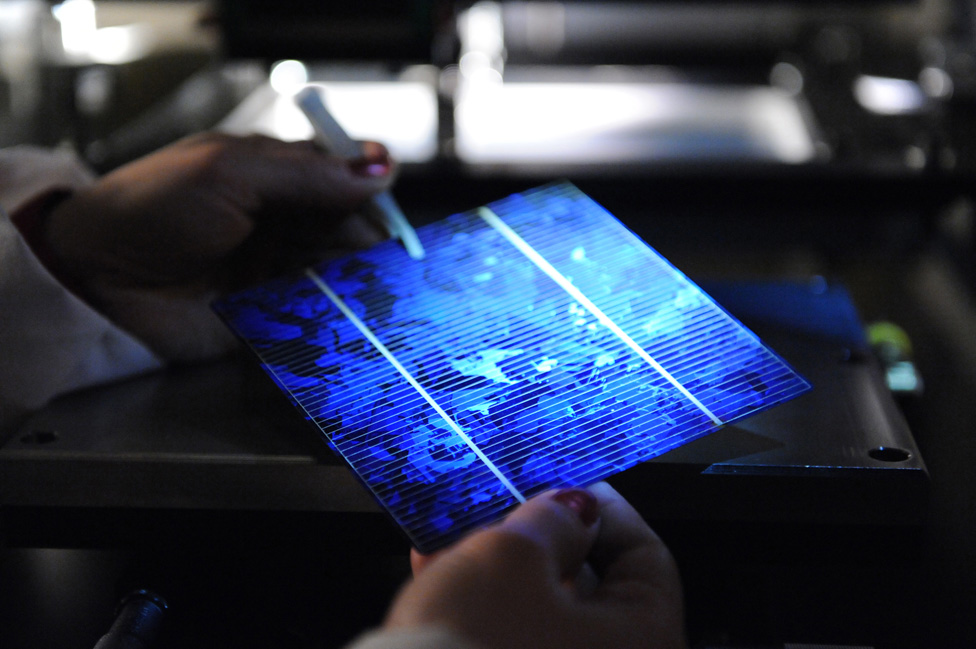
En
utilisant une substance type bicarbonate de soude, la digestion des
eaux usées par des microbes peut produire de l'énergie sous forme
d'électricité annoncent des chercheurs.
C'est
l'impasse ! Pollution des villes, réchauffement du climat… Le scénario
catastrophe est connu. Au rythme actuel, la température de la planète
aura augmenté de 1,5 °C à 4,5 °C durant le siècle qui vient. Principale
responsable : l'augmentation des émissions de CO2, essentiellement due
à la combustion des énergies fossiles. Pire, après avoir provoqué
l'asphyxie de la planète, ces énergies fossiles essentielles au
fonctionnement de notre économie… disparaîtront ! Les ultimes barils de
pétrole pourraient être pompés vers 2080, selon l'Institut français du
pétrole. Moins polluant, le gaz naturel serait épuisé, à consommation
constante, en une soixantaine d'années. « Il resterait encore assez de
charbon pour alimenter la planète en énergie pendant plusieurs siècles,
souligne Olivier Godard, directeur de recherche au CNRS. Mais sa
combustion dégage plus de CO2 que le pétrole. Au-delà de la raréfaction
des ressources fossiles, un véritable problème écologique se pose tant
que ne se produit pas une rupture technologique sur la capture et
l'enfouissement du CO2 ou sur le type d'énergie utilisé dans les
transports. » D'autant que les prévisionnistes annoncent un doublement
de la consommation mondiale d'énergie d'ici 2040-2050. Que faire ?

La France, avec les autres pays européens, a déjà fait des choix.
Signer Kyoto et stopper ses émissions de gaz à effet de serre.
S'engager, avec l'Europe, à ce que 20 % de l'électricité provienne de
sources renouvelables… « Ce qui ne devrait pas être trop difficile si
l'on considère que notre pays produit déjà 15 % de son électricité avec
de l'hydraulique », estime Olivier Godard. Certes. Mais cela
suffira-t-il à réduire les émissions « alors que la tendance naturelle
serait, pour le seul secteur des transports, une augmentation des
émissions, à l'horizon 2020, des deux tiers par rapport à 1990 » ? Or,
les possibilités d'installation de centrales hydrauliques en France
sont pratiquement épuisées. Et la part des énergies renouvelables
telles que le solaire, la biomasse ou l'éolien est, pour l'instant en
tout cas, réduite à la portion congrue. Dans le domaine de la
recherche, une autre énergie a le vent en poupe. Très abondante, plus
énergétique que le pétrole ou le gaz naturel, ni polluante, ni toxique,
elle pourrait, du moins en théorie, répondre à tous nos besoins. Son
nom : l'hydrogène. Problème : si l'hydrogène, lié à l'oxygène, est très
abondant sous forme d'eau, les molécules d'hydrogène, elles, ne se
trouvent pas à l'état pur. L'hydrogène est un vecteur d'énergie et non
une source. Il faut donc d'abord le produire, le stocker, et
l'embarquer à bord des véhicules, ce qui suppose d'énormes contraintes.
Au CNRS, les chercheurs s'attellent à lever ces verrous technologiques
dans le cadre du programme Énergie.

Si l'hydrogène devait représenter une proportion notable des besoins
énergétiques mondiaux, disons 20 % en 2050, les capacités de
production devraient être multipliées par un facteur de l'ordre de 25.
C'est dire l'ampleur de la tâche. Aujourd'hui en effet, il est surtout
utilisé comme matière de base par l'industrie chimique et
pétrochimique. Sa production représente 1,5 % seulement de la
production mondiale d'énergie primaire. Qui plus est, 95 % de cet
hydrogène est produit à partir de dérivés des combustibles fossiles,
par un procédé appelé vaporeformage, qui, en outre, rejette du CO2.
L'autre technique actuellement utilisée, l'électrolyse, permet de
produire de l'hydrogène à partir de l'eau. Problème : sa décomposition
par électrolyse nécessite l'apport… d'énergie électrique, que l'on doit
produire par ailleurs. Du coup, le rendement global est médiocre : de
l'ordre de 25 %.

L'idéal serait d'obtenir de l'hydrogène « propre » sans production
préalable d'électricité, ni dégagement de gaz à effet de serre. Ce qui
est théoriquement possible. Comment ? « Grâce à des microalgues »,
répond Jack Legrand qui coordonne un programme du CNRS à l'université
de Nantes. Certaines algues vertes unicellulaires ou cyanobactéries
sont, en effet, connues pour fournir de l'hydrogène par photosynthèse.
À partir de l'énergie solaire et en utilisant de l'eau, elles donnent
de l'hydrogène et de l'oxygène, sans dégagement de CO2. Le hic, c'est
que dans la nature les microalgues produisent de l'hydrogène de façon
transitoire. « Le processus est lié à la photosynthèse et conduit à un
dégagement en parallèle d'hydrogène et d'oxygène, rappelle Jack
Legrand. Or, l'enzyme de la microalgue qui permet la production
d'hydrogène, l'hydrogénase, est fortement sensible à l'oxygène. Du
coup, la production d'hydrogène s'arrête rapidement. » La solution ? «
D'abord, jouer sur la flexibilité du métabolisme des algues, explique
Jack Legrand. L'idée, c'est d'alterner les phases aérobies, pendant
lesquelles la plante grossit en se constituant des réserves carbonées
sur lesquelles elle va ensuite puiser pour produire de l'hydrogène en
phase anaérobie. Mais, grâce à un switch métabolique, on va ensuite
réussir à lui faire produire de l'hydrogène sans produire en parallèle
de l'oxygène. » Dans un premier temps, il s'agira de mieux comprendre
et d'améliorer les processus biologiques impliqués, puis de les mettre
en œuvre dans un photobioréacteur. « Dans un deuxième temps, on
pourrait même envisager de modifier génétiquement les microalgues,
voire de mimer chimiquement uniquement le comportement de l'algue dont
on a besoin, en s'affranchissant des limitations du vivant,
s'enthousiasme Jack Legrand. Mais pour l'instant, on n'a aucune idée du
rendement que l'on pourrait obtenir ainsi… »

Une autre piste pourrait être le craquage de l'eau grâce à un
concentrateur solaire. En clair, décomposer l'eau en hydrogène et en
oxygène uniquement sous l'effet de la chaleur en utilisant des cycles
thermochimiques. Au four solaire d'Odeillo, des équipes du CNRS
étudient cette éventualité. Mais il s'agit aussi d'une solution à long
terme. « Elle ne peut être envisagée que d'ici cinquante à soixante
ans, relativise Gilles Flamant du CNRS. Car elle pose des problèmes
scientifiques importants : ça marche sur le papier mais, en réalité,
beaucoup de cycles sont difficiles à réaliser complètement. En
attendant de trouver une solution, on pourrait cependant faire du
craquage de méthane. » Sous l'action du concentrateur solaire, le
méthane se décompose en hydrogène et en… carbone. « Mais ce dernier
pourrait être utilisé comme noir de carbone, lequel sert à fabriquer
des pneus, des piles ou des polymères conducteurs, souligne Gilles
Flamant. On aurait donc en prime un procédé de production propre du
noir de carbone, alors que pour l'instant, il est produit grâce à la
combustion partielle d'hydrocarbures. D'ailleurs, le craquage solaire
du méthane fait l'objet d'une proposition de projet européen dans le
cadre du premier appel à proposition du 6e PCRD1. »

Si la perspective de production d'hydrogène à grande échelle à partir
d'énergies renouvelables semble donc lointaine, les piles à combustible
elles, sont toutes proches de la commercialisation. Elles sont
attendues vers 2005 dans le domaine du portable (ordinateurs,
téléphones, caméscopes, matériels de camping, etc.), du petit
stationnaire (électroménager, chauffe-eau, chaudière, etc.) et du
transport public. Et autour de 2010-2015 pour l'automobile. Leur
principe : à partir d'hydrogène et d'oxygène, on obtient de
l'électricité, de la chaleur et de l'eau. Aujourd'hui six types de
piles existent, mais l'une d'entre elles semble particulièrement
prometteuse : la PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell), ou pile à
membrane échangeuse de protons. Elle pourrait être utilisée dans tous
les types d'applications, pour alimenter tant des logements que des
véhicules ou des portables. Problème, le coût : une pile à combustible
coûte vingt fois plus qu'un moteur « standard » de voiture et douze
fois plus qu'une chaudière « classique »… « On travaille cependant à le
faire baisser, souligne Pascal Brault (CNRS-université d'Orléans). Pour
la PEMFC, nous venons de breveter un nouveau procédé qui permet
d'utiliser entre deux et cinq fois moins de platine aux électrodes, ce
qui fait baisser le coût d'autant. L'astuce consiste à mieux répartir
le platine sur l'électrode de façon à en mettre moins. » Cerise sur le
gâteau : le procédé breveté utilise une technologie propre pour
fabriquer les électrodes. « La pulvérisation plasma, avec des gaz
chimiquement neutres, précise Pascal Brault, alors qu'actuellement un
procédé chimique plus polluant est utilisé. Aujourd'hui, nous sommes à
la recherche de partenaires industriels. »

Si le platine est cher, la membrane en Nafion, un polymère
commercialisé par DuPont de Nemours, l'est encore plus. Elle
représente 25 à 35 % du prix de la PEMFC. Or, justement, il
serait bien d'en changer… « Un autre point faible de la PEMFC, c'est sa
température de fonctionnement, un peu trop basse : 80 °C », relève
Claude Lamy, directeur d'un groupe de recherche au CNRS et à
l'université de Poitiers. À 80 °C en effet, la différence de
température avec l'air ambiant est faible, ce qui impose des radiateurs
énormes, difficiles à intégrer notamment dans une voiture. « L'idéal
serait d'atteindre 120 °C. Mais les membranes Nafion sont incapables de
fonctionner correctement à cette température. Si l'on trouvait de
nouvelles membranes, fabriquées avec d'autres matériaux, qui
fonctionnent à 120 °C, ce serait beaucoup plus simple, poursuit Claude
Lamy. Et l'on ferait coup double : des piles qui fonctionnent mieux,
avec des matériaux moins chers. » Plusieurs laboratoires du CNRS y
travaillent.
À Nancy, les chercheurs se penchent sur la modélisation du cœur de
pile. L'objectif in fine est le même : « analyser finement les
transferts de fluides et d'énergie thermique et proposer de nouvelles
solutions de gestion pour améliorer le rendement de la pile et
faire baisser son coût », résume Sophie Didierjean du CNRS. Le
rendement électrique actuel d'une PEMFC est d'environ 40 %, mais il
pourrait se rapprocher de 50 %. Énorme, par rapport à celui d'un moteur
« standard » de voiture qui est de… 20 % ! Reste que pour alimenter les
piles à combustible, il faut un réservoir d'hydrogène. Or, l'hydrogène
est un gaz léger, volumineux, ce qui pose problème lorsque l'on doit en
embarquer plusieurs kilos à bord d'une voiture. Jusqu'à présent, deux
solutions sont appliquées sur les prototypes. La compression, qui
permet de réduire le volume du réservoir. Mais plus on comprime, plus
on doit augmenter l'épaisseur des parois et donc le poids du réservoir…
Quant à la deuxième solution, la liquéfaction de l'hydrogène, elle
permet certes de doubler les capacités de stockage, mais elle consomme
environ la moitié de l'énergie contenue dans l'hydrogène, juste pour le
maintenir à la température à laquelle il devient liquide !
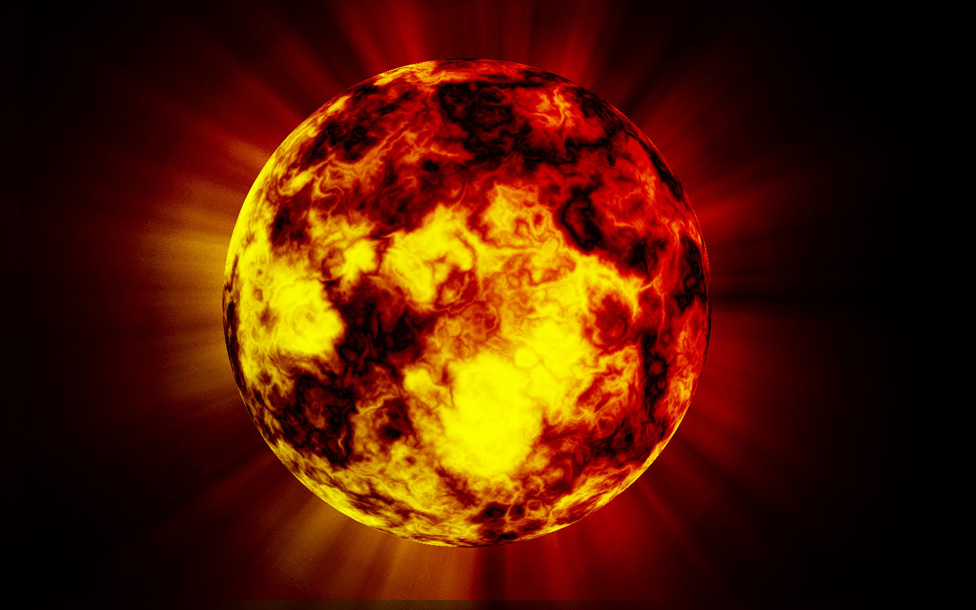
Pour sortir de ces dilemmes, deux alternatives sont étudiées. Dans leur
principe, il s'agit de matériaux qui se comportent comme de véritables
éponges, capables d'absorber l'hydrogène et de le restituer à volonté :
les hydrures – c'est-à-dire des alliages de métaux – et des
nanostructures de carbone.
« Les hydrures sont sans doute plus proches de l'application concrète,
notamment pour les applications stationnaires, estime Annick
Percheron-Guégan du CNRS. Ce sont des matériaux bien connus, qui ont
une bonne capacité de stockage : deux fois supérieure en volume à celle
de l'hydrogène liquide. Nous avons d'ailleurs un projet, dans le cadre
du réseau technologique PACO pour tester, d'ici trois ans, l'un de ces
réservoirs à hydrure, qui alimentera une pile PEMFC pour des
applications domestiques. » Reste que les hydrures ont un inconvénient
: ils sont lourds. Ce n'est certes pas gênant pour les applications
stationnaires. Mais pour les véhicules, le rapport de la masse
d'hydrogène stockée sur la masse totale du système, ce qu'on appelle la
performance massique, est faible : 3 % seulement. Or, l'objectif à
atteindre, la norme du Department of Energy américain (DOE), est de 6,5
%. « Nous avons cependant une piste pour alléger nos hydrures :
élaborer un alliage avec un matériau plus léger : par exemple du
magnésium », précise Annick Percheron-Guégan.

Les nanostructures en carbone n'ont pas cet inconvénient. « Des
simulations numériques montrent même que l'on pourrait atteindre une
performance massique de 8 %, avance Alix Gicquel du CNRS. « Nous sommes
cependant toujours à la recherche du matériau idéal présentant la
meilleure structure : aujourd'hui les nanofibres semblent plus
intéressantes que les nanotubes », relève Alix Gicquel. Ensuite, il
faudra maîtriser le procédé de production. À Villetaneuse, son
laboratoire commence à faire pousser des nanotubes avec un nouveau
procédé à plasma. Au four d'Odeillo, Gilles Flamant utilise des
concentrateurs solaires. Mais les réservoirs en nanocarbones comportent
un désavantage : ils fonctionnent à des pressions relativement élevées…
Au-delà des verrous technologiques, une foule de questions se posent
encore. Comment peut s'effectuer le passage massif à des énergies
renouvelables ? En combien de temps ? Sous quelle impulsion ? À quel
coût ? Avec quels changements dans nos habitudes de consommation ?…
Pour l'instant, les réponses restent parcellaires. « Il existe certes
des modèles économiques, des modèles énergétiques, avec différentes
écoles et différents outils, note Luc Baumstark du CNRS. Mais notre
objectif, c'est de mettre en cohérence ces différents modèles de façon
à proposer des scénarios qui permettent de tracer le cheminement
de long terme vers des sociétés à bas profil d'émissions de gaz à effet
de serre. » C'est l'une des pistes de recherche du programme
socio-économique du CNRS qui vient de débuter. « De la même manière,
les transports et l'habitat constituent des enjeux majeurs de la
consommation énergétique… Mais transport et habitat sont intimement
liés. Et l'on ne pourra pas élaborer des scénarios-villes durables sans
intégrer les interactions entre les politiques publiques des
transports, de l'habitat et les styles de vie. » Enfin, la diffusion
des innovations technologiques est un mécanisme complexe. « Un fort
soutien des pouvoirs publics n'est pas la garantie du succès, souligne
Luc Baumstark. Mais notre but c'est justement d'analyser ces obstacles
afin de donner aux pouvoirs publics des outils qui leur permettent de
promouvoir les technologies les plus efficaces. »
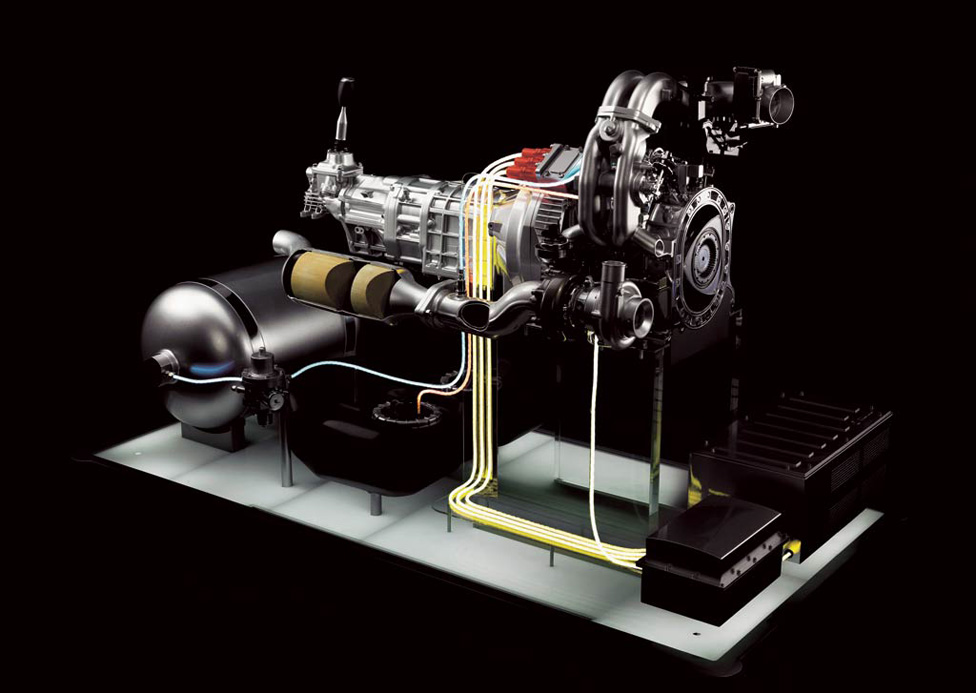
Catherine Pagan
Notes :
1. Le 6e PCRD : Le programme-cadre de recherche et développement fixe
les priorités de la Commission européenne en matière de R & D pour
les quatre ans à venir.
10 Mars 2013
Consultez le Site du CNRS
Retour à
l'Energie
Retour au Sommaire
|