
Jacques Delors : « L’Europe doit se relancer »
Propos
recueillis à Bruxelles Par Thierry Borsa, Christian De Villeneuve et
François Vey, avec la collaboration de Marine Brugeron

La semaine dernière, Jacques Delors séjournait à nouveau à Bruxelles, en marge de la remise du Prix du livre européen.
Après deux heures d’échanges de haute volée sur l’avenir de l’Union
européenne avec l’ancien chancelier allemand Helmut Schmidt,
l’ex-président de la Commission de Bruxelles, infatigable défenseur de
l’Europe, nous a livré son analyse et ses convictions.
Quelle est, pour vous, la signification du prix Nobel de la Paix, remis à l’Union européenne, lundi 10 décembre ?
Cette distinction est exceptionnelle car généralement le comité du prix
Nobel choisit une personnalité qui s’est illustrée par son combat pour
la liberté, la dignité de l’homme. Pour une fois, le comité a décidé de
le donner à une institution. C’est la célébration de deux concepts : la
paix et la grande Europe. C’est le signe que les Européens ne doivent
pas poser la veste sur le bord de la route. Même s’ils ont des
difficultés, et Dieu sait si elles sont grandes, cela ne doit pas
occulter le chemin parcouru. C’est un encouragement. Dans notre think
tank Notre Europe-Institut Jacques Delors nous parlons à des jeunes. Et
nous nous servons de ce prix Nobel pour expliquer ce qui est en cause.
L’autre jour, avec Valéry Giscard d’Estaing, à la Mutualité à Paris,
nous avions 500 jeunes de terminale, 70 professeurs et nous avons pu
expliquer cela dans le cadre du lancement du concours « Eustory » en
France. Le prix Nobel est un élément de relance: n’oubliez pas d’où
vous venez ! Nous devons accueillir cette distinction comme un
encouragement.

A quelles personnalités avez-vous pensé en apprenant l'attribution de ce prix à l’Europe ?
J’ai pensé à tous ceux qui, depuis longtemps, même pendant la guerre,
en luttant contre le nazisme, contre le totalitarisme avaient rêvé
d’une Europe rassemblée dans la paix. Il y avait déjà, avant-guerre, un
mouvement pour l’Europe : c’était le mouvement fédéraliste. Puis il y a
eu ces hommes et ces femmes engagés dans la Résistance, même en
Allemagne. Je vous rappelle que quand il avait 15 ans, après la guerre,
Helmut Kohl (chancelier d'Allemagne de 1982 à 1998, NDLR) est allé
casser les bornes-frontières entre la France et l’Allemagne. J’ai pensé
à tout cet élan. Et puis, le 9 mai 1950, est arrivé l’appel de Robert
Schuman (ministre français des Affaires étrangères, NDLR), qui a eu une
portée autant morale et spirituelle que politique. Il lui a été inspiré
par Jean Monnet et avait reçu l’accord explicite du chancelier allemand
Konrad Adenauer, puisqu’il avait lu l’appel avant que Robert Schuman ne
le prononce.
A partir de là, il y aurait beaucoup de gens à citer. Quand je parle
devant des jeunes, des philosophes ou des historiens, j’insiste sur la
portée de cet acte et je me réfère souvent à la philosophe Hannah
Arendt, qui a dit : « Le pardon – qui n’est pas l’oubli – est la
promesse que les générations qui arrivent seront réintégrées dans la
communauté internationale. » Avec ce « pardon », Hannah Arendt a trouvé
la plus belle formule pour expliquer l’appel de Robert Schuman. Je
pense donc à tous ces gens-là, mais aussi aux militants qui continuent
de se battre pour l’Europe. Ça n’existe pas en France, puisque nous
avons eu une majorité de « nonistes » (ceux qui ont rejeté le traité
sur la Constitution européenne lors du référendum de 2005, NDLR), mais
dans d’autres pays, c’est très important.

Aujourd’hui, êtes-vous optimiste ?
L’Europe est en déclin, l’Europe perd de son influence. Après la
guerre, nous représentions 30% de la population mondiale, et nous ne
serons plus que 12% dans quelques années. Raison essentielle pour
choisir – par le renforcement de l’Union européenne – la survie, et
dire non au déclin.
Est-ce que les
effets de la crise et cette distance de certains dirigeants actuels par
rapport à l’Europe n’aboutissent pas à la conclusion que l’Europe est
en danger ? Quelles sont les principales menaces pesant sur l’idée
européenne ?
Comme me disait un de mes patrons, « l’air du temps n’est pas bon ». Ce
qui explique parfois pourquoi je ne suis pas parmi les plus virulents
critiques de ceux qui nous gouvernent, qu’ils soient de droite ou de
gauche. D’une part, l’évolution interne de nos sociétés se traduit par
un individualisme de plus en plus grand et de plus en plus exacerbé. Il
m’arrive de parler devant des jeunes qui me disent : « Mais, Monsieur
Delors, je suis le seul maître de mon choix ». Il y a bien sûr des
formes d’amitié et de communauté, mais cet individualisme exacerbé ne
tient pas compte de l’idée de communauté de l’Union européenne, une
idée du vivre-ensemble. La mondialisation perturbe les Européens, qui
ont le sentiment que les décisions leur échappent. Ce qui se traduit
par deux phénomènes : une recherche d’identité d’un côté et, de
l’autre, la résurrection d’un nationalisme rampant. Ce second phénomène
est tout à fait flagrant quand on suit de près les discussions au
niveau de l’Europe. Les gouvernements sont élus, et certains d’entre
eux sont obligés de faire des coalitions avec des éléments de
populisme. Donc c’est très difficile, en ce moment, d’avancer.

Quelles initiatives faudrait-il prendre ?
Pour lutter contre ces menaces, il faut expliquer ce que fait l’Europe.
Quand on va dans un Conseil européen et qu’on en revient, la moindre
des choses serait que, comme en Grande-Bretagne, le Premier ministre
aille devant le Parlement, deux jours avant pour dire « voilà la
problématique » et deux jours après « voilà le compte-rendu ». Et en
donnant aussi des motifs d’espoir et pas que des motifs d’excuse. Il
n’y aura pas de meilleure connaissance de l’Europe, en dépit du travail
remarquable du Parlement européen, tant que la relation avec les
parlements nationaux ne sera pas plus étroite. Je ne connais pas de
remède miracle. Il y a deux axes de travail, le premier, c’est la
consolidation de ce qui a été fait par l’Europe, autour de l’euro. Un
échec de l’euro constituerait un terrible retour en arrière de la
construction de l’Union européenne. Deuxièmement, il faut offrir à la
grande Europe, celle des 27 – et l’année prochaine des 28, avec
l’entrée de la Croatie –, des perspectives positives. Or personne ne
parle de la grande Europe, personne ne dit ce qu’elle peut faire du
point de vue de la paix. La grande Europe, c’est une organisation
originale dont s’inspirent d’autres pays pour tenter d’avoir entre eux
plus de compréhension et de coopération.
La grande Europe, c’est la première distributrice d’aide au
développement, d’aide aux réfugiés ; c’est quand même celle qui a
permis à de nombreux pays de sortir de l’obscurité pour rejoindre le
continent de la liberté et de la démocratie. Ça a été vrai pour la
Grèce, l’Espagne et le Portugal, ainsi que pour les pays de
l’ex-Yougoslavie. Aujourd’hui, la Croatie va adhérer, les relations
avec la Serbie sont bonnes. C’est plus difficile avec la
Bosnie-Herzégovine, mais l’Europe continue son œuvre de paix, de
pluralisme et de démocratie. J’ai beaucoup regretté que certains aient
dit « La Turquie, jamais ! » parce que nous apparaissons alors pour les
musulmans comme un bloc chrétien, ce qui est ridicule, prétentieux et
négatif. Je ne peux pas dire que la Turquie va rentrer dans l'Union
mais au moins il faut montrer une attitude ouverte. Parce que si
l’Europe n’a pas une attitude ouverte, où est son âme ? Ça ne veut pas
dire qu’on devient naïf. Positiver la grande Europe, consolider l’union
économique et monétaire sont deux objectifs majeurs qui doivent être
réalisés très rapidement. Il faut un échéancier clair et rapide. Il ne
faut plus non plus que l’Europe se donne en spectacle comme elle l’a
fait pendant trois ans, en intervenant trop tard et trop peu. Non
seulement il n’y avait plus d’architecte, mais en plus, les pompiers
étaient mauvais.
Il vaut mieux expliquer ce que l’on décide au niveau européen et ce que
l’on garde au niveau national plutôt que d’avoir des systèmes qui
deviendraient essentiellement punitifs. On ne tombe pas amoureux d’un
marché sans frontières, d’un marché commun, mais on ne tombe pas non
plus amoureux d’un système punitif. C’est pour cela qu’il faut redonner
à la zone euro une justification politique, économique et sociale.

L'avenir de l'Europe
passe selon vous par des abandons de souveraineté limités mais
significatifs qui seront d'autant mieux acceptés que l’Europe
proposerait une politique très volontariste sur la croissance ?
Oui, c’est d’ailleurs ce qu’a compris le président de la République,
François Hollande. Il a obtenu au Conseil européen ce Pacte de
croissance qui n’est qu’un début mais, symboliquement et politiquement,
c’est très important. Actuellement, les chefs d'Etat discutent du
budget des 27. Or, dans ce budget, les dépenses d’innovation, de
recherche et de croissance représentent 10% du budget. C’est-à-dire 1
pour 1 000 du PIB de l’Europe. C’est pour cela que j’aime beaucoup la
formule de l’ancien président du think tank Notre Europe qui est
malheureusement décédé, l'ancien ministre italien des Finances, Tommaso
Padoa-Schioppa, lui aussi un père de l’Europe, un homme remarquable: «
Aux Etats, la rigueur, à l’Europe, la relance. » C’est ce qu’a défendu
François Hollande : la bonne voie pour que la construction européenne
aide les pays membres à retrouver la santé financière et le chemin de
la croissance et de l’emploi.

Sur quels leviers peut se faire cette relance ?
Le premier levier, je l’avais déjà proposé en 1993 (dans un Livre blanc
sur croissance, compétitivité, emploi) c’est avoir une politique
européenne des infrastructures. Ça vous amusera de savoir que j’avais
dit qu’on les financerait grâce à des euro-obligations. Mon projet a
été enterré ou distillé à petites gouttes. Mais avoir un projet
d’infrastructures en Europe, non seulement pour les transports, pour
l’énergie, ça nous permettrait d’avoir une politique commune de
l’énergie que l’on n’a pas.
Le second levier, c’est la recherche. Il y a eu beaucoup de progrès de
faits : le système est devenu moins bureaucratique, mais nous pouvons
faire davantage ensemble sur la recherche. Il se trouve qu’il y a
autour des institutions européennes les meilleurs chercheurs et les
meilleurs savants.
Le troisième levier, la politique de cohésion économique et sociale qui
existe déjà. Et qui a permis à tous les pays en retard de gagner 20
points par rapport à la moyenne européenne. Cette politique, qui
représente un peu plus du tiers du budget, doit être continuée.
En quatrième levier, il y a l’action par l’entremise de la banque
européenne d’investissement. La banque européenne sait faire des
montages originaux pour permettre de donner des crédits ou des soutiens
financiers à tous ceux qui veulent entreprendre.
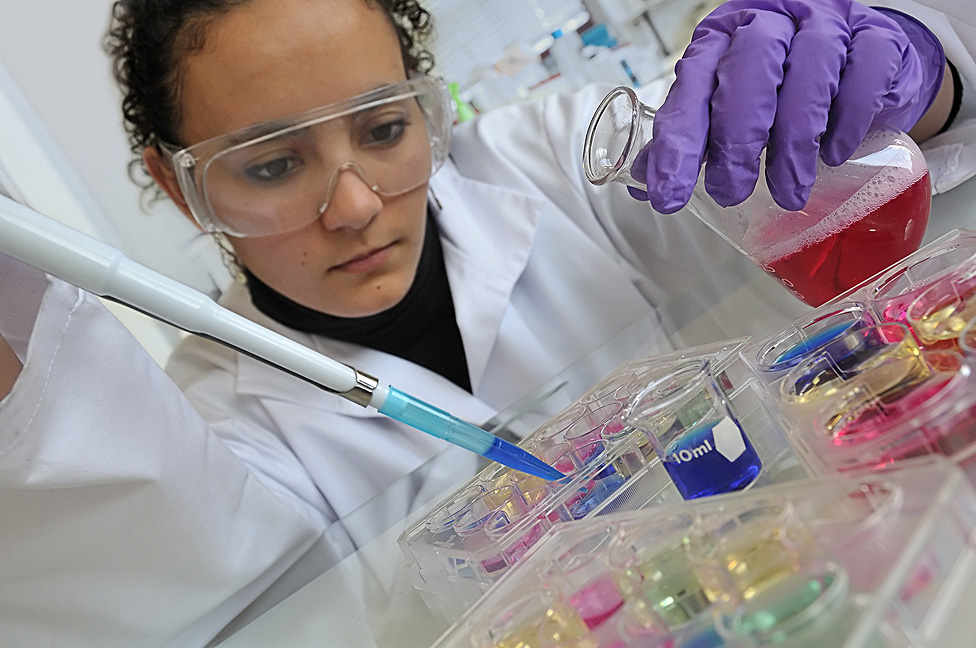
Est-ce compatible avec votre défense très véhémente de la politique agricole commune (PAC) ?
On a fait la PAC pour des raisons de bargaining, de grands accords,
c’était très important pour la France au moment du traité du marché
commun. Mais pour moi, je pense que dans un pays comme la France, mais
je pourrais dire la même chose en Allemagne avec le Schleswig-Holstein
ou d’autres régions, le poumon d’un pays, son équilibre, ce sont les
zones rurales. Et si vous laissez les zones rurales à l’abandon, alors
votre société ne respire plus, vous aggravez les problèmes urbains.
Dans nos journaux, on parle beaucoup d’urbanisme mais qui parle du
développement rural ? Il n’y a pas simplement les Français qui vont en
vacances dans ces régions. La ruralité, qui la défend ? Ce sont d’abord
les agriculteurs. Trop de concentration, trop d’esprit industriel dans
le développement de l’agriculture nous coûtent de l’argent.
Si on avait une comptabilité nationale qui tienne compte du temps passé
dans les transports, du coût des transports, des territoires en
jachère, des déséquilibres biologiques, vous verriez que la politique
agricole commune, ce n’est pas simplement une affaire européenne, c’est
une affaire vitale pour un pays comme la France.
La croissance peut-elle repartir en Europe en 2014 ?
Si on prend les mesures dont j’ai parlé, oui, la croissance peut
reprendre dans la zone euro. C’est absolument indispensable parce
qu’aux conséquences de la non-croissance s’ajoutent les conséquences de
la crise financière. Et cela donne des situations dramatiques comme en
Grèce et en Espagne, etc. Mais d’un autre côté, la vitalité des peuples
y fait pour beaucoup. Regardez les Irlandais ! Ils ont payé cher, mais
ils sont costauds. Est-ce que nous vivons vraiment sur nos rentes ou
est-ce que nous avons un projet pour nos enfants ?

Trouvez-vous que le budget de l’Union européenne est insuffisant ?
Oui, insuffisant. Une telle déclaration n’est pas très populaire dans
les Etats membres. Si on applique la rigueur à tous les niveaux, d’où
vient l’espoir, la plus-value ? L’objectif de l’UE et de la zone euro,
c’est d’apporter des possibilités raisonnables, pas démagogiques. Ce
n’est pas une hérésie de dépenser plus au niveau européen parce qu’il
est facile de démontrer que 1 000 euros dépensés dans chacun des 27
pays ont moins de poids que 27 000 euros dépensés en actions communes.
Il y a deux problèmes à résoudre. Premièrement, la taille du budget
européen : on devrait avoir cette année une hausse de 20% pour relancer
les pays membres. Et deuxièmement, le problème des ressources propres
de l’Union pour assurer le financement de ses actions.
Quelle pourrait être cette recette ?
Il faut une combinaison de contributions nationales, de TVA et d’impôts
verts. Nicolas Sarkozy avait songé à un impôt destiné à empêcher les
consommations excessives d’énergie. Il y a renoncé. C’est pourtant la
voie d’un nouveau développement riche en emplois. Théoriquement et
intellectuellement, nous sommes en retard. Nous avons un chômage
inquiétant avec, dans certains pays comme l’Espagne, une crise sociale
terrible. Evidemment, quand j’arrive en disant : il y a un nouveau
modèle de développement qui inclut davantage les conséquences de
l’environnement, qui donne davantage de temps pour le repos, le loisir,
qui décompresse les villes, on me dit non. Alors que ce modèle créerait
plus d’emplois, mais il faudrait changer notre manière de compter. Je
vous donne un exemple : avec l’urbanisation croissante, le temps mis
par les Français pour aller travailler a été multiplié par deux.
Qu’est-ce que dit la comptabilité nationale ? Que nous nous sommes
enrichis ? Si on continue comme ça...
Raisonner et compter en termes de croissance classique, ça ne va pas.
Changer notre façon de voir demande un immense travail. Mais ce travail
de création intellectuelle est passionnant. Il est aussi important que
le reste. Aujourd’hui, on a l’impression de voir naître un axe
Merkel-Cameron. Ce qui est frappant c’est la faiblesse accrue du
système communautaire avec un recul des pouvoirs de la Commission,
voulu par Sarkozy et Merkel. Le problème, c’est la tentation, pour
faire avancer les choses, de se rapprocher de la Grande-Bretagne. Ce
serait faire trop de concessions à une vision de libre-échange,
c’est-à-dire une Europe sans son modèle social et sans consistance
politique.
Vous préconisez une
augmentation du budget européen, n’est-ce pas contradictoire avec la
posture de certains Etats comme la Grande-Bretagne ?
La situation est compliquée car le Premier ministre anglais, David
Cameron, travaille déjà à contre-courant des idées européennes qui nous
lient… On lui fait des concessions en espérant qu’il acceptera l’union
bancaire. Mais l’union bancaire, en veut-il ? Or comme l’a indiqué le
gouverneur de la Banque de France au Financial Times : « Il faut
absolument que nous rapatriions une partie de nos transactions dans la
zone euro. » La puissance de la zone euro est là. On arrive à se
demander si la politique d’obstruction de la Grande-Bretagne n’a pas
pour conséquence d’affaiblir l’Europe et de la freiner dans les
changements nécessaires. Je ne veux pas en faire le bouc-émissaire mais
bon quand même.... La Grande-Bretagne semble ne pas vouloir d’une
Europe qui combine le marché, la concurrence, l’ouverture vers
l’extérieur avec une économie mixte au niveau européen – ou une
économie sociale de marché – qui constitue la personnalité de notre
Europe. L'Europe doit aussi faire preuve de cohésion en matière de
politique sociale. Or voici que le plombier polonais est de retour avec
des entreprises qui emploient des salariés à bas coût en France... Je
suis inquiet de savoir qu’en dépit des garanties qui avaient été
données, il y a des moyens aujourd’hui de détourner la volonté des
gouvernements. Cela peut être arrangé, il peut y avoir des accords
bilatéraux. C’est fâcheux pour l’idée européenne que l’on ait découvert
ça et que des entreprises françaises se prêtent à ça. Dans le fond, on
a deux formes de dumping qui sont inacceptables : le travail au noir
avec généralement des immigrés et ces contrats passés de détachement du
personnel. Il faut suivre cela de près. Je suis pour la libre
circulation des travailleurs. Il y a eu une mémorable action dans un
pays où les syndicats méritent vraiment leur nom, en Suède.
Ils se sont battus pour éviter cela chez eux avec des travailleurs
baltes et autres. Il faut être correct. Le système social européen est
fondé sur le marché, l’Etat et la concertation sociale. Cela marche
plus ou moins bien selon les pays. Les pays où cela fonctionne sont
bien plus en avance que nous. Suède, Danemark, Allemagne qui a fait de
gros efforts avec le consentement du syndicat DGB. En Suède, c’est
assez intéressant de voir que c’est un gouvernement de centre-droit
mais qui n’a pas remis en cause les fondements du modèle suédois qui
est fondé sur une concertation forte, des négociations entre patronat
et syndicats voire entre Etat, patronat et syndicats. C’est ce que le
président de la République, François Hollande, essaye de faire en ce
moment en lançant cette grande négociation.
Comment jugez-vous l’action du président Hollande en matière européenne ?
Au dernier Conseil européen, il a ouvert la voie à un rééquilibrage. Il
a d’ailleurs remporté cette bataille avec l’aide de l’Espagne et de
l’Italie, ce qui réaffirme l’idée de communauté. Mais, à mon avis, il
bute sur le problème de l’acceptation d’un transfert de souveraineté
compte tenu de sa majorité et de son électorat. Ce n’est pas une
réticence purement hollandienne, c’est une réticence française. Ce qui
me contrarie, c’est qu’on perd ainsi de notre capacité d’autonomie. On
dit que la souveraineté est l’essentiel, et on ne se rend pas compte
qu’implicitement, on en perd, sans le dire. Moi, je préfère que l’on se
mette autour d’une table et qu'on décide ensemble d'un meilleur
fonctionnement. C’est la souveraineté partagée.
13 Décembre 2012
Abonnez-Vous au Parisien
Retour à l'Europe
Retour
au sommaire
|
