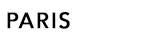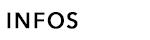Europe : Que faire ? Continuer…
Par Arnaud Leparmentier

En
ce début d'année, on serait tenté d'appliquer à l'Europe l'aphorisme de
Pierre Dac. Le Vieux Continent « a son avenir devant lui, mais il
l'aura dans le dos chaque fois qu'il fera demi-tour ». L'Europe regarde
son avenir dans le rétroviseur : il suffisait pour s'en convaincre
d'écouter Angela Merkel, lors de ses voeux du Nouvel An, associer les
élections européennes du mois de mai aux commémorations du passé :
centenaire de la guerre de 1914, 75e anniversaire du début de la
seconde guerre mondiale – les Allemands célèbrent peu le Débarquement –
et vingt-cinquième anniversaire de la chute du mur de Berlin, qui
marqua la fin de la partition de l'Allemagne et de l'Europe.
Merkel
III marche dans les pas de Helmut Kohl, qui expliquait à la fin de son
règne que l'Europe était « une question de guerre et de paix au XXIe
siècle ».

La paix, c'est ce qu'évoquent les dirigeants européens quand ils n'ont
rien à proposer. Ils tendraient à donner raison à Causeur, la revue
d'Elisabeth Lévy, qui titre, en ce début d'année électorale, « L'Europe
c'est fini ! Et si on essayait la France ? ». On peut partager une
partie du diagnostic – le rebond de la France réside essentiellement en
elle-même –, mais nous réfutons la petite musique nationaliste qui va
animer l'année électorale. Voici le retour des nations, ces fichues
nations, IIIe République comprise, qui ont fait tant de mal au Vieux
Continent.
Car la paix, c'est aussi ce qui reste de l'Europe quand on a tout
oublié. Les Européens, selon le sondage Eurobaromètre d'automne,
plébiscitent, parmi « les résultats les plus positifs de l'Union
européenne », la libre circulation (57 %) et la paix entre les pays de
l'UE (53 %). Bien loin devant l'euro (25 %) et les programmes
d'échanges universitaires Erasmus (23 %). Etre européen, c'est pouvoir
traverser son continent en paix.

Tirons les leçons du passé. En une décennie, le projecteur s'est
déplacé du « plus jamais cela », après la Shoah et les crimes nazis, à
une sourde inquiétude sur le jeu des empires européens devenus
mini-puissances. La peur des totalitarismes s'estompe, car ceux-ci sont
jugés vaincus, pour laisser la place aux conflits
diplomatico-économiques qui peuvent déraper. Sans qu'on s'en aperçoive
vraiment. On pourrait repartir comme en 14. C'est ce qu'a laissé
entendre Angela Merkel, en citant, lors du dîner du Conseil européen de
décembre, le livre Les Somnambules, de Christopher Clark (Flammarion,
2013), sur la marche vers la guerre à l'été 1914 : « Ils ont tous
échoué et cela a mené à la première guerre mondiale. »

Les Européens, oserait-on dire, savent mieux gérer la guerre que la
paix. C'est l'enseignement du père de l'Europe Jean Monnet. Responsable
des approvisionnements pendant la première guerre mondiale, il constata
que Français et Anglais retournèrent bien vite à leurs petites affaires
une fois la guerre finie. Après l'échec de la Société des nations
(SDN), après 1945, il décida de bâtir l'Europe sur le roc des
institutions supranationales. D'où le célèbre adage de Monnet : « Rien
n'est possible sans les hommes, rien n'est durable sans les
institutions. »
Forte de cette conviction, l'Europe s'est abîmée depuis un quart de
siècle dans des débats institutionnels sans fin, soucieuse de bâtir un
projet fondé sur le droit plus que sur la volonté politique. Puis l'on
s'est aperçu que cette construction était vaine, faute de volonté
politique. Les Chirac, Jospin, Schröder, Blair et Aznar n'avaient aucun
désir d'Europe et l'ont laissée moisir.

Certes, en temps de guerre, les Européens réagissent. Tardivement, trop
tardivement, contraints d'appeler autrui à leur secours – comprendre
Washington –, comme l'ont montré les guerres en ex-Yougoslavie dans les
années 1990 et la crise de l'euro une décennie plus tard. Chaque
nation, chaque peuple se jette dans la bataille parce que sa survie est
en jeu. Lorsqu'il s'agit de la guerre militaire, chacun reprend ses
billes une fois le conflit achevé – l'Europe de la défense n'existe pas.
Mais en économie, chacun finit par céder un peu de souveraineté, comme
ce fut le cas avec les fonds de sauvetage européens et l'union
bancaire. C'est ainsi que progresse l'UE. « J'ai toujours pensé que
l'Europe se ferait dans les crises, et qu'elle serait la somme des
solutions qu'on apporterait à ces crises », expliquait Jean Monnet dans
ses Mémoires (Fayard, 1976).

Mais lorsque la poussière retombe, les gouvernements renâclent. Tant
pis si l'édifice se mine de l'intérieur. C'est ce qu'a répété Angela
Merkel à Bruxelles, qui ne pense pas que l'euro soit sauvé. Elle a osé
comparer l'Europe à la RDA ou l'URSS finissantes. « Si tout le monde se
comporte comme on pouvait le faire sous le communisme, alors nous
sommes perdus », a assené la chancelière.
Les peuples ne veulent pas d'un diktat européo-allemand, et il suffit
pour s'en convaincre de voir la joie amère des Irlandais enfin sortis
de la tutelle financière du FMI et de l'UE. Mais à l'Elysée, on
reconnaît que le statu quo n'est pas viable et qu'il faut plus
d'intégration pour sauver définitivement la monnaie commune. Le
cheminement étroit, c'est le destin de l'UE. « L'Europe sera en
difficulté très longtemps », confiait Monnet en 1974, alors que la
communauté était confrontée au premier choc pétrolier, à la fin du
système de change fixe et à l'adhésion du Royaume-Uni. A la question «
Que faire ? », il répondit : « Continuer, continuer, continuer… ».

17 Février 2014
Abonnez-Vous au Monde
Retour à l'Europe
Retour au sommaire
|