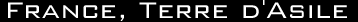|
Election présidentielle en France L’élection
française va-t-elle entraîner un changement de président sans que les
débats décisifs de la période ouverte depuis 2007 soient tranchés pour
autant ? L’alternance politique constituerait un soulagement pour
les Français. Car, au-delà des travers les plus notoires du président
sortant — son omniprésence, son exhibitionnisme, sa capacité à dire
tout et puis son contraire, la fascination que lui inspirent les
riches, à peu près égale à sa disposition à transformer les chômeurs,
les immigrés, les musulmans ou les fonctionnaires en boucs émissaires
de toutes les colères —, les cinq années écoulées ont marqué un
recul de la démocratie politique et de la souveraineté populaire.
 Après le référendum de mai 2005, les candidats à l’Elysée des deux principaux partis représentés au Parlement ont ignoré l’opposition de la majorité des Français à une construction européenne dont toutes les erreurs de conception se révèlent aujourd’hui. Le scrutin référendaire s’était pourtant traduit par un vote sans appel, à l’issue d’un débat national de meilleure qualité que l’actuelle campagne électorale. Et la présidence de M. Nicolas Sarkozy, qui devait marquer le retour en grâce du volontarisme en politique, s’achève sur une suite de déclarations déconcertantes. Ainsi, alors que l’ensemble des candidats de gauche semoncent les banques, M. François Baroin, ministre français de l’économie, prétend que « s’en prendre à la finance, c’est aussi idiot que de dire “je suis contre la pluie”, “je suis contre le froid” ou “je suis contre le brouillard” ». De son côté, le premier ministre François Fillon recommande au candidat socialiste François Hollande de « soumettre son programme électoral à Standard & Poor’s (1) ».  La subordination des cercles dirigeants français à une droite allemande de plus en plus arrogante, attachée à son credo d’une « démocratie conforme au marché », érode également la souveraineté populaire. La levée de cette hypothèque est au cœur du scrutin en cours. Et oblige à poser sans détour les termes du débat européen. Nul n’ignore que les programmes d’austérité mis en œuvre avec acharnement depuis deux ans n’ont apporté — et n’apporteront — aucune amélioration aux problèmes d’endettement qu’ils prétendent résoudre. Une stratégie de gauche qui ne remettrait pas en cause ce garrot financier est par conséquent condamnée d’emblée. Or l’environnement politique européen interdit d’imaginer que ce résultat puisse être obtenu sans combat. A l’heure actuelle, l’embolie générale est contenue par un torrent d’argent que la Banque centrale européenne (BCE) déverse à bas prix sur les banques privées, à charge pour celles-ci de le reprêter plus cher aux Etats. Mais ce répit ne dépend que du bon plaisir de l’institut d’émission, arc-bouté sur une « indépendance » que les traités ont imprudemment consacrée. A plus long terme, la majorité des pays membres de l’Union se sont engagés, conformément aux exigences allemandes docilement relayées par Paris, à durcir leurs politiques de rigueur et à soumettre les éventuels contrevenants à un mécanisme de sanction draconien, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG), en cours de ratification. 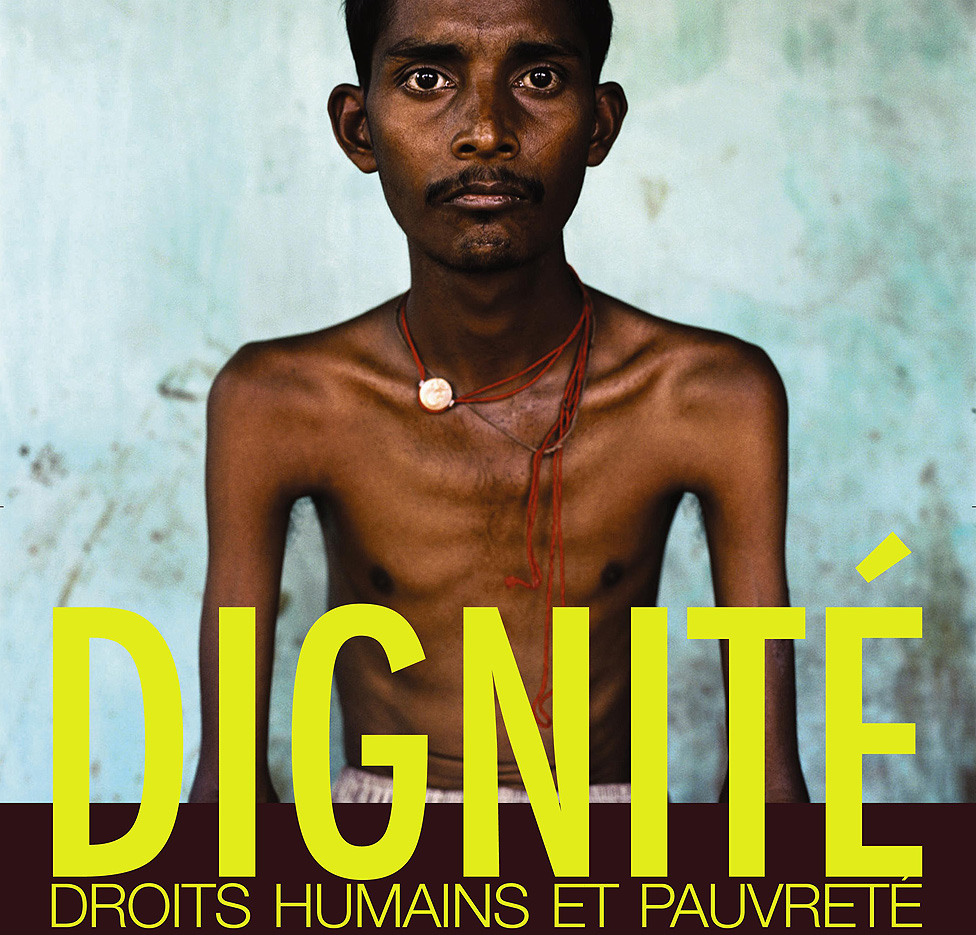 Le châtiment infligé à la Grèce menace désormais l’Espagne, sommée de réduire d’un tiers son déficit budgétaire alors que son taux de chômage atteint déjà 22,8 %. Le Portugal n’est pas loin, qui doit amputer ses dépenses publiques, bien que le taux d’intérêt de ses emprunts explose (14 % en mars) et que le pays s’enfonce dans la récession (— 3 % de croissance en 2011). Infliger un tour de vis budgétaire à des Etats en proie à un chômage de masse, la chose n’est pas inédite ; telle fut la grande recette économique et sociale de la droite française des années 1930... Les socialistes expliquaient alors : « La déflation aggrave la crise, elle diminue la production et elle diminue le rendement des impôts (2). »  La stupidité des politiques actuelles n’est pourtant déconcertante que pour qui imagine encore qu’elles ont vocation à servir l’intérêt général, et pas l’oligarchie rentière accrochée aux manettes de l’Etat. Si la finance a un visage, c’est bien celui-là (3). Nommer cet ennemi permettrait de mieux mobiliser contre lui. En cas d’alternance politique en France, la remise en cause du TSCG (ou d’autres politiques d’austérité du même acabit) devra constituer la priorité absolue du nouveau président, quel qu’il soit. Le succès ou l’échec de cette entreprise déterminera le reste : éducation, services publics, justice fiscale, emploi. M. Hollande aimerait dissocier la solidarité européenne, qu’il défend, de la thérapie de choc libérale, qu’il conteste. Il s’est engagé à « renégocier » le TSCG, avec l’espoir d’y ajouter « un volet de croissance et d’emploi » adossé à des projets industriels à l’échelle continentale.  « Aucune politique de gauche n’est possible dans le cadre de ces traités », estime en revanche M. Jean-Luc Mélenchon. Assez logiquement, le candidat du Front de gauche s’oppose donc au TSCG, tout comme au mécanisme européen de stabilité (MES), lequel prévoit une assistance financière aux seuls pays en péril qui auront préalablement accepté des mesures impitoyables d’équilibre budgétaire. La candidate écologiste et les candidats trotskistes mènent également campagne pour un « audit européen des dettes publiques » (Mme Eva Joly), voire pour frapper celles-ci d’illégitimité en arguant que les baisses d’impôts de ces vingt dernières années et les intérêts versés aux créanciers expliquent l’essentiel de leur niveau actuel (M. Philippe Poutou et Mme Nathalie Arthaud).  Le « repli élastique » de 1997 Opposés à une renégociation des traités, la plupart des Etats européens, Allemagne en tête, n’imaginent rien de tel. Et pas davantage de prêter des sommes importantes à des Etats en difficulté financière sans que ceux-ci aient donné des gages de leur « bonne » gestion. C’est-à-dire accepté à la fois de nouvelles privatisations et la remise en cause de pans importants de leur protection sociale (retraites, allocations de chômage, salaire minimum, etc.). « Les Européens ne sont plus assez riches pour payer tout le monde à ne pas travailler », a d’ailleurs ironisé le 24 février dernier M. Mario Draghi, président de la BCE, dans un entretien au Wall Street Journal. L’ancien vice-président de Goldman Sachs a ajouté qu’une « bonne » austérité réclamerait de réduire à la fois les impôts (ce qu’aucun candidat français ne propose, pas même M. Sarkozy...) et les dépenses publiques.  Autant dire qu’un président de gauche se heurterait aussitôt à l’opposition de la plupart des gouvernements de l’Union, très majoritairement conservateurs, et à celle de la BCE, sans oublier la Commission européenne présidée par M. José Manuel Barroso. C’est donc tout à fait délibérément que les premiers ministres britannique, polonais et italien, comme la chancelière allemande, ont refusé de recevoir le favori français des sondages, jugé moins accommodant que le président actuel. « Nous ne sommes certainement pas en faveur d’une renégociation, a déjà indiqué M. Jan Kees de Jager, ministre néerlandais des finances. En revanche, si M. Hollande veut mener davantage de réformes, alors nous serons à ses côtés, qu’il s’agisse de la libéralisation des services ou des réformes du marché du travail (4). » En somme, le soutien des Pays-Bas est acquis à tout président français de gauche qui mettrait en œuvre une politique plus libérale encore que celle de M. Sarkozy...  Mme Angela Merkel ne fait pas davantage mystère de son inclination partisane : elle s’est déclarée disposée à participer aux meetings de la droite française. Les socialistes allemands montrent moins d’enthousiasme envers leurs camarades d’outre-Rhin. Le président du parti, M. Sigmar Gabriel, s’en proclame solidaire, mais un autre dirigeant, M. Peer Steinbrück, qui espère lui aussi succéder à la chancelière dans dix-huit mois, a jugé « naïf » l’engagement de M. Hollande à « renégocier une nouvelle fois tous ces accords [européens] ». Il anticipe un revirement du candidat français : « S’il est élu, sa politique pourrait concrètement différer de ce qu’il a dit (5). » On ne saurait en effet exclure une telle hypothèse. En 1997, déjà, les socialistes français avaient promis avant les élections législatives qu’ils renégocieraient le pacte de stabilité européen signé à Amsterdam — une « concession faite absurdement au gouvernement allemand », estimait alors M. Lionel Jospin. Une fois au pouvoir, la gauche française n’obtint pourtant guère plus que l’ajout des termes « et de croissance » à l’intitulé du « pacte de stabilité ».  M. Pierre Moscovici, actuel directeur de campagne de M. Hollande, est revenu en 2003 sur cette pirouette sémantique. En le relisant, il est difficile de ne pas penser à la situation qui pourrait s’ouvrir dès mai prochain : « Le traité d’Amsterdam avait été négocié — fort mal — avant notre arrivée aux responsabilités. Il comportait de nombreux défauts — et d’abord un contenu social très insuffisant. (...) Le nouveau gouvernement aurait pu légitimement ne pas l’approuver (...), ou à tout le moins demander de reprendre sa négociation. Ce ne fut pas notre choix final [M. Moscovici était alors ministre délégué chargé des affaires européennes]. Car nous étions confrontés, avec Jacques Chirac à l’Elysée, à la menace d’une triple crise. Crise franco-allemande, car un recul de notre part aurait compliqué d’emblée notre relation avec ce partenaire essentiel (...). Crise avec les marchés financiers, dont les opérateurs souhaitaient l’adoption de ce traité. (...) Crise de cohabitation enfin. (...) Lionel Jospin choisit, à juste titre, de déplacer le terrain, en cherchant à la fois un repli élastique et une sortie par le haut. C’est-à-dire en obtenant, pour le prix de son consentement au traité d’Amsterdam, la première résolution d’un Conseil européen consacrée à la croissance et à l’emploi (6). » Dans l’hypothèse d’une victoire présidentielle, puis parlementaire de la gauche en mai-juin 2012, deux éléments différeraient du tableau brossé ici. D’une part, le pouvoir exécutif français ne serait plus partagé comme il y a quinze ans ; mais, d’autre part, l’équilibre politique de l’Europe, qui penchait au centre gauche en 1997, incline désormais fortement à droite. Cela dit, même un gouvernement aussi conservateur que celui du premier ministre espagnol Mariano Rajoy en est venu à s’inquiéter de la cure d’austérité à perpétuité que lui réservent les gouvernants allemands. Le 2 mars dernier, il a ainsi fait connaître sa « décision souveraine » de ne pas accepter la camisole de force budgétaire européenne.  Presque au même moment, une douzaine d’autres pays, dont l’Italie, le Royaume-Uni et la Pologne, ont également réclamé une réorientation de la politique économique concoctée par le tandem germano-français. M. Hollande pourrait s’en réjouir. Il espère en effet que son éventuelle élection bouleversera les rapports de forces continentaux, sans qu’il doive engager un bras de fer — auquel manifestement il répugne — avec plusieurs gouvernements européens, la BCE et la Commission de Bruxelles. Seulement, la réorientation voulue par les pays libéraux n’a guère à voir avec celle que lui-même et ses amis recommandent. Le mot « croissance » signifie chez les uns l’adoption de politiques de l’offre thatchériennes (baisse des impôts, déréglementations sociales et environnementales), chez les autres une petite panoplie d’investissements publics (éducation, recherche, infrastructures). L’équivoque ne sera pas entretenue indéfiniment. Très vite, il faudra envisager la « désobéissance européenne » que recommandent M. Mélenchon et d’autres forces de gauche. Ou bien poursuivre sans espoir le cours déjà engagé. Au-delà de ce qui les distingue — en matière de justice fiscale, par exemple —, MM. Sarkozy et Hollande ont soutenu les mêmes traités européens, de Maastricht à Lisbonne. Ils ont tous deux entériné des objectifs draconiens de réduction des déficits publics (3 % du produit intérieur brut en 2013, 0 % en 2016 ou en 2017). Ils récusent l’un et l’autre le protectionnisme. Ils attendent tout de la croissance. Ils défendent des orientations de politique étrangère et de défense identiques, dès lors que même la réintégration par la France du commandement intégré de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) n’est plus remise en cause par les socialistes français.  L’heure est pourtant venue de rompre avec l’ensemble de ces postulats. Changer de président en est assurément la condition. Mais ni l’histoire de la gauche au pouvoir ni le déroulement de la campagne actuelle n’autorisent à imaginer qu’elle pourrait suffire. Serge Halimi (1) Respectivement sur RTL, 22 janvier 2012, et dans Le Journal du dimanche, Paris, 15 janvier 2012. (2) Préambule à la proposition de loi budgétaire du groupe socialiste pour 1933. (3) Lire notre dossier « Le gouvernement des banques », Le Monde diplomatique, juin 2010. (4) Le Monde, 1er mars 2012. (5) Agence France-Presse, Paris, 15 février 2012. (6) Pierre Moscovici, Un an après, Grasset, Paris, 2003, p. 90-91. Mai 2012 |
| INFORMATIQUE SANS FRONTIERES • contact • |
 |