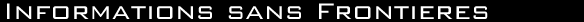
L'information
face à la communication
par Michel Diard et Alain Goguey

Il y a soixante-dix ans, le 29 mars
1935, du fait de l'impasse dans laquelle s'étaient enlisées
les discussions entre syndicats et patrons de presse pour élaborer
une première convention collective, les députés
et sénateurs ont su faire preuve d'audace pour doter les
journalistes d'un double statut d'auteur et de salarié. Il
s'agissait alors de permettre aux journalistes de travailler librement
et en conscience, de leur donner les moyens de résister aux
pressions internes ou externes dont ils peuvent faire l'objet.
Aujourd'hui, le contexte particulier et dramatique de la presse
et des médias exige une audace aussi grande pour empêcher
que les élus de la République ne se retrouvent en
situation de dépendance, et que le débat démocratique
ne soit confisqué par des puissances économiques et
industrielles liées aux commandes de l'Etat.
La presse, écrite et audiovisuelle, n'est pas une industrie
comme les autres, un journal ne se fabrique pas comme une paire
de chaussures. Nous pensons que le but principal d'un journal n'est
pas l'enrichissement de son propriétaire ou des fonds d'investissement,
ni que le rôle d'une chaîne de télévision
se résume à vendre du temps de cerveau humain à
un fabricant de soda. En son temps, le rapporteur de la loi à
l'Assemblée, M. Brachard, l'a dit avant nous à la
tribune du Palais-Bourbon : "Un journal n'est pas une denrée
assimilable à toutes les autres denrées. L'industrie
de la presse, c'est autre chose que des cylindres qui tournent et
des bobines de papier qui s'impriment."
Nous avons encore la faiblesse de penser que le journal quotidien
et le journal télévisé de 20 heures doivent
avant tout informer et éduquer le public et être le
nécessaire instrument de contrôle de la vie publique.
Aujourd'hui, nous nous éloignons de cette conception de l'information.
Les mouvements de concentration entre les mains de quelques groupes
industriels ou de fonds d'investissement ou de pension entraînent
la profession dans une dérive inexorable. Les coûts
de recherche et de traitement de l'information sont réduits
; les nouveaux propriétaires des médias dictent des
obligations en termes de profits identiques à ceux des autres
secteurs d'activité.
L'arrivée du groupe Dassault à la tête de la
Socpresse, l'ampleur prise par le groupe Lagardère, l'expansion
du groupe Ouest-France, le poids pris par les fonds d'investissements
Carlyle, Cinven, Candover dans les médias, l'influence politique
du groupe Bouygues dictant ses ordres au gouvernement pour créer
une chaîne d'information internationale font peser de lourdes
menaces sur l'information. Nous avons la nette impression que le
lobby patronal paralyse toute velléité de légiférer.
D'ailleurs, le sénateur Serge Dassault avoue tout haut ce
que d'autres propriétaires de médias imposent aux
rédactions de façon plus insidieuse : la priorité
aux "idées saines" . Nous devons nous soumettre
aux méthodes douces de la communication. Nous sommes invités
en permanence à privilégier les "techniques de
persuasion complexes et intimes" directement inspirée
des techniques du marketing depuis que l'information est devenue
un produit.
Dans de grandes régions, comme le Nord - Pas-de-Calais par
exemple, le groupe Dassault impose des pages communes à ses
trois titres, La Voix du Nord ,Nord-Eclair et Nord Littoral , dans
lesquelles certains groupes de pensée sont interdits de séjour.
On s'achemine vers une région où la pensée
unique régnera sans partage puisque La Voix du Nord vient
aussi de racheter une télévision locale, Canal 9.
Qui peut garantir aujourd'hui que la liberté d'expression
du journaliste ne sera jamais utilisée pour mentir, tromper
ou manoeuvrer ?
Le statut professionnel des journalistes de 1935 était une
formidable avancée démocratique. Par respect du public,
il était enfin reconnu à notre profession les droits
les plus élémentaires du code du travail, ceux du
code de la propriété intellectuelle, mais aussi un
certain nombre de droits nouveaux. Ce statut devait nous préserver
des dérives des employeurs tentant de nous imposer d'écrire
contre notre conscience. Il s'agissait aussi, en faisant du journalisme
un véritable métier, avec un statut protecteur, de
mettre les professionnels à l'abri de toutes les pressions
et de leur assurer des garanties morales et matérielles.
Les principales dispositions de ce statut sont la clause de conscience,
les indemnités de congédiement, l'instauration d'une
carte d'identité professionnelle et les minima de salaires.
Aujourd'hui, les nouveaux dirigeants des médias martèlent
que le statut des journalistes, exorbitant du droit commun, est
un handicap pour l'économie de l'information. En fait, l'information
est surtout victime des erreurs de gestion, et c'est la volonté
de l'encadrer qui amènent le lecteur, l'auditeur et le téléspectateur
à douter de ce qu'il lit ou entend comme des journalistes.
Elle est enfin malade des appétits démesurés
en matière de profits immédiats.
Ils n'hésitent pas non plus à dénaturer certaines
dispositions du statut du journaliste : le groupe Dassault a transformé
la clause dite de cession en un vaste plan social. Cette variante
de la clause de conscience assimile le refus du journaliste de travailler
avec le repreneur du journal à un licenciement (avec le versement
d'une indemnité d'un mois de salaire par année d'ancienneté).
Plus de 250 journalistes ont refusé de travailler pour Dassault.
La Socpresse refuse de compenser ces départs, fragilisant
des rédactions déjà exsangues.
Les nouveaux patrons des médias mènent aussi des offensives
contre les droits d'auteurs des journalistes. Ils sont pourtant
l'un des moyens de nous opposer à la marchandisation de l'information.
Les patrons de presse précarisent la profession, affaiblissant
les garanties matérielles et morales du statut. Tous leurs
efforts sont tendus vers un objectif : réduire le nombre
de salariés intervenant dans la fabrication d'un journal
écrit ou audiovisuel.
Les qualifications professionnelles sont également au centre
de leurs préoccupations, sous prétexte de l'introduction
dans les rédactions des technologies numériques. Dans
l'écrit, c'est le secrétaire de rédaction qui
est visé, c'est-à-dire celui qui met en forme l'information,
auquel on voudrait imposer des tâches techniques supplémentaires
et opérer un sulfureux mélange entre les responsabilités
rédactionnelles de mise en forme de l'information et de réalisation
technique des pages. Dans l'audiovisuel, le reporter devrait remplacer
le technicien chargé du montage, au risque de ne plus avoir
le recul suffisant sur l'information.
Dans l'un comme dans l'autre cas, de lourdes menaces pèsent
sur la qualité de l'information livrée au public.
Notre métier, c'est l'information. Le journaliste ne peut
remplir sa mission sociale que dans la liberté garantie par
un statut de haut niveau.
Le
Parlement a, dans la conjoncture d'aujourd'hui, le devoir et
le pouvoir de lui assurer cette indispensable liberté
en complétant le statut professionnel des journalistes
et la responsabilité de garantir le pluralisme en légiférant,
notamment, pour limiter les concentrations.
Michel Diard est secrétaire général
du Syndicat national des journalistes CGT (SNJ-CGT), Alain Goguey
est membre du bureau national.
Article paru dans l'édition du Monde du 29 mars 2005
Abonnez-Vous
au Monde
INFORMATIQUE SANS FRONTIERES •
contact/contact
us •
|
 |
|


