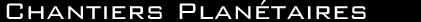
La
Banque mondiale dans la gueule du loup
Par Pascal
RICHE

Pour
diriger la «banque du développement», Bush a
proposé Paul Wolfowitz, son faucon en chef. Essentiellement
intéressé au maintien de la puissance américaine,
ce théoricien va-t-en-guerre et néoconservateur n'en
a pourtant pas le profil.
Au loup ! Depuis que George W. Bush a proposé celui
qu'il appelle «Wolfie» pour diriger la Banque mondiale,
un vent de panique agite le village global. Les diplomates s'alarment,
les ONG spécialisées dans le développement
hurlent à la «provocation», les employés
de la Banque mondiale se demandent ce qui leur est tombé
sur la tête, et certains organisent déjà la
«résistance». Car Paul Wolfowitz, numéro
2 du Pentagone, est l'incarnation de tous les maux du premier mandat
de Bush : chef de file des néoconservateurs, théoricien
de la guerre préventive, architecte de l'invasion de l'Irak,
chantre de l'unilatéralisme...
Les gouvernements européens, qui théoriquement peuvent
mettre leur veto (1), enragent en coulisse, mais ne tiennent pas
à rouvrir les récentes plaies. Ils se sont, semble-t-il,
résignés . De Bruxelles, hier, le chancelier allemand
Gerhard Schröder a donné le ton: Wolfowitz «ne
suscite pas des débordements d'enthousiasme en Europe»
, mais sa nomination «n'échouera pas à cause
de l'Allemagne et j'ai l'impression qu'elle ne sera pas bloquée
par les autres (pays) en Europe.» Wolfowitz s'active pour
faire oublier son image de «velociraptor», une étiquette
que lui avait collée un jour The Economist , à la
recherche d'un superlatif de «faucon». Il a donné
plusieurs interviews, dans lesquelles il jure qu'il n'entend pas
se servir de la Banque mondiale pour bouleverser l'organisation
et y imposer un quelconque programme politique.
Le plus puissant des «neocons»
Ses défenseurs s'affligent des «caricatures»
qu'on dresse de lui. Wolfowitz est certes plus un spécialiste
de la défense que du développement, mais il n'est
pas moins qualifié que ses prédécesseurs, arguent-ils.
Sous Reagan, il a été secrétaire d'Etat adjoint
pour l'Asie du Sud-Est et ambassadeur en Indonésie. De plus,
n'a-t-il pas acquis, au Pentagone, l'expérience de la gestion
d'une immense bureaucratie ? «Je le connais depuis vingt ans.
Il n'est pas cet idéologue de bande dessinée qu'on
fait de lui. Il est très pragmatique et sa carrière
montre qu'il n'a rien d'un illuminé», soutient Gary
Schmitt, directeur du club de néoconservateurs Project for
a New American Century. Mais, pour être subtil, il n'en est
pas moins dangereux. S'il est nommé, prévient Joseph
Stiglitz, ancien économiste en chef de la Banque mondiale,
l'organisation deviendra «l'instrument explicite de la puissance
américaine». Comment ne pas redouter de voir arriver,
à la tête d'une des plus grosses tirelires du monde,
un homme qui considère que le leadership consiste à
«montrer à vos amis qu'ils seront protégés,
à vos ennemis qu'ils seront punis et à ceux qui refusent
de vous soutenir qu'ils le regretteront» ?
A 61 ans, Wolfowitz est le plus puissant des «néoconservateurs»,
ces intellectuels issus de la gauche qui ont, essentiellement pour
des raisons de politique étrangère, viré à
droite dans les années 60 ou 70. Les neocons estiment que
les Etats-Unis forment une combinaison unique, à la fois
superpuissance et démocratie et ont le devoir de faire reculer
les tyrannies. «Pour Paul, la puissance américaine
n'est pas une fin en soi, c'est un instrument pour améliorer
le monde», assure Charles Fairbanks, spécialiste de
l'Asie centrale, qui connaît Wolfowitz depuis l'université.
Certains néoconservateurs ont viré vraiment à
droite, d'autres restent ouverts sur les sujets de société.
A écouter ceux qui le connaissent, c'est le cas de Wolfowitz,
qui n'a jamais vécu dans un bocal conservateur. «Sa
petite amie est une féministe arabe...» (2) glisse
l'un de ses supporteurs, pour démontrer qu'il est à
cent lieux de l'étroitesse d'esprit de la droite religieuse
américaine. «Petite amie» ,«féministe»
,«arabe» : les trois mots sont importants.
Le protégé du «Dr
Folamour»
Le père de Wolfowitz, Jacob, était un juif polonais,
mathématicien, dont les parents se sont installés
aux Etats-Unis en 1920. En Pologne, la presque totalité de
sa famille a péri dans les camps nazis. Jacob Wolfowitz avait
l'habitude de répéter à ses enfants combien
ils avaient de la chance d'avoir échappé aux horreurs
du totalitarisme et d'avoir pu être élevés aux
Etats-Unis. Selon la soeur de Wolfowitz, qui vit aujourd'hui en
Israël, l'un des fréquents sujets de conversation, à
la table familiale, portait sur la responsabilité morale
des Etats-Unis vis-à-vis du monde.
Lycéen, Paul Wolfowitz soutient la campagne de Kennedy. A
19 ans, il participe au grand rassemblement pour les droits civiques
des Noirs à Washington, dont le clou fut le «rêve»
de Martin Luther King. Il étudie les mathématiques
à l'université de Cornell (New York), où son
père les enseigne, et s'apprête à se consacrer
à une carrière de biochimiste. Là, le flamboyant
professeur Allan Bloom, dépeint sous les traits de «Ravelstein»
dans le roman à clés de Saul Bellow (3), le prend
sous son aile. Bloom est un disciple de Leo Strauss, philosophe
en rébellion contre la modernité et le relativisme,
qui deviendra l'icône des néoconservateurs. Il convainc
l'étudiant de laisser tomber la biochimie et de suivre sa
passion, la science politique. Wolfowitz s'inscrit à l'université
de Chicago, où Leo Strauss enseigne. Son intelligence impressionne
: «Quand on jouait aux cartes, il gagnait toujours. Il calculait,
il savait ce que les autres joueurs avaient en main», se souvient
Charles Fairbanks. Il est repéré par le mathématicien
et stratège Albert Wohlstetter. Inspirateur de la doctrine
nucléaire américaine, il considère l'idée
de détente comme une dangereuse folie (ses théories,
radicales, ont inspiré le Dr Folamour de Kubrick). La guerre
du Vietnam fait rage. Wolfowitz y est plutôt favorable, mais
pas jusqu'à se porter volontaire : ses études lui
permettent d'y échapper.
«S'assurer qu'aucune autre superpuissance
n'émerge»
Après quelques années d'enseignement à Yale,
il rejoint le Pentagone, par l'entremise de son mentor Wohlstetter.
A Washington se forme un réseau des protégés
du mathématicien, animé par Richard Perle, alors conseiller
du sénateur démocrate et anticommuniste Henry «Scoop»
Jackson. Le but de ce petit club est de combattre la stratégie
de coexistence pacifique d'Henry Kissinger, sa bête noire.
A partir de là, pendant vingt ans, Wolfowitz fera des allers
et retours entre le Pentagone et le département d'Etat, se
distinguant par sa propension à imaginer des menaces sur
la sécurité du pays. Sous Ronald Reagan, leader quasi
idéal à ses yeux, il passe du Parti démocrate
au Parti républicain.
A la fin de la première guerre du Golfe, en 1991, il s'efforce
de convaincre George Bush père de déloger militairement
Saddam Hussein, qui s'emploie alors à écraser dans
le sang les rébellions chiites et kurdes. Il perd face à
la ligne légaliste et prudente incarnée par Colin
Powell, à l'époque chef d'état-major interarmes.
C'est après la chute de l'Union soviétique que Wolfowitz
s'impose comme le «théoricien» des néoconservateurs.
Les faucons sont un peu perdus, leur ennemi ayant disparu. Que faire
si c'est «la fin de l'histoire» ? Wolfowitz, en charge
de la stratégie politique au Pentagone, suggère de
saisir ce moment historique : l'unipolarité soudaine du monde,
juge-t-il, doit être prolongée le plus longtemps possible.
En 1992, un document, rédigé par ses services, suggère
sans ambages que désormais «la mission politique et
militaire des Etats-Unis» est de «s'assurer qu'aucune
autre superpuissance n'émerge» . Le texte fait l'objet
d'une fuite, provoquant un scandale. Le président Bush ordonne
qu'il soit entièrement réécrit. La version
initiale, document fantôme, devient un mythe dans les rangs
néoconservateurs.
L'obsession irakienne
Retourné au monde universitaire sous Clinton, comme doyen
de la Sais (School for Advanced International Studies) à
Washington, Wolfowitz ne cesse d'appeler à la confrontation
avec l'Irak. En octobre 1998, George W. Bush l'enrôle dans
son équipe de campagne pour seconder Condoleezza Rice. Secrétaire
adjoint à la Défense, après le 11 septembre,
il plaide sans relâche pour le renversement de Saddam Hussein.
Lors d'un séminaire à Camp David, quatre jours après
les attentats, il se fait si insistant que George W. Bush doit le
faire rappeler à l'ordre. Au début, sa lubie semble
saugrenue ; mais patiemment, toujours prudent, toujours loyal, «Wolfie»
saura convaincre Bush que la chute du régime irakien est
la clé d'une évolution positive au Moyen-Orient...
Cet homme peut-il devenir le président de la Banque mondiale
? A la différence de bien d'autres faucons américains,
tel John Bolton, juste nommé ambassadeur des Etats-Unis auprès
de l'ONU, il affiche une forme d'idéalisme. Son ami Fairbanks
assure que l'un de ses moteurs est sa «sensibilité
à la souffrance des hommes». On l'a même vu se
faire un jour huer, lors d'un congrès pro-israélien,
parce qu'il avait évoqué celle du peuple palestinien.
Sous Reagan, lorsqu'il s'occupait de l'Asie au département
d'Etat, il a encouragé plusieurs régimes asiatiques
à l'ouverture et il a joué un rôle non négligeable
dans la chute du dictateur philippin Ferdinand Marcos. Mais le problème
de fond, avec Wolfowitz, c'est qu'il a toujours raisonné
en termes de projection du pouvoir américain, une habitude
dont il risque d'avoir du mal à se défaire à
la Banque mondiale. «Wolfowitz a eu de jolis mots pour expliquer
comment le tsunami avait inspiré son envie de se consacrer
au développement (4). Mais gare ! c'est essentiellement un
homme qui s'énerve si d'autres pays ne font pas ce que les
Etats-Unis veulent», prévient Steve Clemons, spécialiste
des questions économiques internationales à la New
America Foundation. Lorsqu'on demande aux amis de Wolfowitz ce qui
le motive le plus, entre l'amélioration du sort du monde
et le maintien de la puissance de l'Amérique, ils haussent
les épaules. Car, explique Gary Schmitt, la conviction profonde
de l'aspirant patron de la Banque mondiale est que «l'un et
l'autre coïncident».
jeudi 24 mars 2005
Abonnez-vous à Libération
http://www.liberation.fr
(1) Par tradition, les Américains choisissent le président
de la Banque mondiale, et les Européens, le directeur du
FMI. Le candidat doit être confirmé par les 24 membres
du conseil d'administration de la Banque, qui représente
184 pays. Les pays européens ont 30 % des voix, les Américains
16 %.
(2) Citoyenne britannique née à Tunis et élevée
en Arabie Saoudite, Shaha Ali Riza,
51 ans, s'occupe des relations extérieures du département
Moyen-Orient et Afrique du Nord à la Banque mondiale. Elle
est, comme Wolfowitz, divorcée.
(3) Dans Ravelstein, Wolfowitz apparaît sous les traits de
Philip Gorman, le contact du professeur homosexuel au Pentagone.
(4) Wolfowitz affirme qu'il a commencé à apprécier
ce poste lors de sa visite sur les lieux du désastre, le
26 décembre.
|
