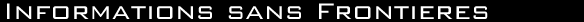
Internet
dans le monde arabe

Le colloque est dirigé par deux intervenants
spécialistes des questions relatives aux technologies de
la communication et de l'information, Mr Gonzalez-Quijano et Samir
Aita. On note d'entrée que la revue Hermès est en
train de produire un numéro sur le Maghreb où on trouve
une Lettre d'information sur les responsables du monde arabe.
Y
a t-il un internet arabe ?
Y.
Gonzalez-Quijano
L'internet dans le Monde Arabe est
un phénomène récent "immatériel"
et transnational, qui date des années 1995-2000. Nous sommes
face à une situation de décalage plutôt que
retard. Ces technologies présentent un faible coût
d'entrée, mais l'infrastructure est lourde à mettre
en place et nécessite une régulation importante pour
la région. L'aspect transnational de celle-ci, avec une langue
ou des paramètres communs, est indiscutable, mais il produit
des colorations particulières. Cela nous pose plusieurs questions.
Où ? Comment ? Pourquoi ?
La définition par les acteurs, est-elle le bon critère
? Les consommateurs offrent vis-à-vis de leurs pratiques
une meilleure définition. Mais une bonne part de la clientèle
se situe à l'étranger. Les contenus ? La langue serait
l'approche la plus simple, mais c'est effectivement simpliste. Autour
de la religion, il y a des sites non arabes destinés à
des non musulmans, ou des sites arabes dans d'autres langues. On
constate néanmoins que la révolution de l'information
dans le monde arabe est une réalité, même si
celui-ci n'est pas encore entré dans l'ère numérique.
La rand corporation affirme qu'Israël et la Turquie seraient
les seuls "pays démocratiques" (sic) qui seraient
intégrés.
Apparemment, il n'existe
pas !
Le PNUD a établi un rapport sur les libertés
et la démocratie, et un autre sur le rôle des femmes
(dont la publication devrait intervenir dans le courant de l'année).
Il est conçu par des experts arabes. Seulement 2,5% de la
population utiliserait Internet et le monde arabe serait à
la traîne de la planète dans le développement
de ces technologies.
Et pourtant c'est une réalité...
Elaph.com semble penser que l'on serait plutôt
aux alentours de 6 pour mille de l'offre mondiale, pour 3,1% à
l'Internet italien, et 2,5% au portugais. Il y a souvent des accès
internet via des cybercafés. C'est un public jeune (70% des
usagers ont entre 20 et 30 ans) où les femmes on une part
importante (1 personne sur 4), ce qui n'est pas mal. En France on
n'est pas à la parité... Il y a intégration
de la nouvelle technique aux pratiques culturelles. Un jeune cairote
passe plus de temps devant son ordinateur ou sa console que devant
la télé... Quand on sait le rôle que jouent
les chaînes arabes, c'est intéressant. Il y a un renversement
des habitudes culturelles.
C'est un paysage très contrasté qui est en évolution
rapide. Pour 300 millions d'habitants répartis dans 22 pays,
on trouve une multitude de petits fournisseurs, pas moins de 40
opérateurs de téléphonie et 20 pour le fixe,
en plus de 300 ISP, et de plus de 100 chaînes satellite et
radios FM.
14 millions d'internautes soit 5% de la population (+du double du
rapport du PNUD, d'il y a deux ans). Les taux de pénétration
sont parmi les plus hauts du monde pour quelques pays de la région
(les Emirats par exemple). Des raisons économiques (Mauritanie,
Soudan) ou politique (Irak, Palestine) peuvent expliquer les retards.
La Tunisie, l'Algérie avancent, l'Egypte aussi (+20% par
an). 650000 d'abonnés en 2003. 2 millions en 2008, soit 6
millions d'utilisateurs.
Deux dates clés (à placer dans la "longue
histoire" des TIC arabes).
La numérisation de l'arabe date de la fin
des années 70. On trouve alors des Quotidiens pan-arabes
ou pan-islamiques. 1995, marque le
lancement d'Explorer 5.5, compatible. L'intérêt d'Explorer
5 est d'avoir facilité la navigation pour les sites en arabe.
1999, est l'année de l'entrée
de l'Arabie Saoudite sur le réseau mondial. Poids économique
et démographique, en plus de son dynamisme sur le terrain
des enjeux culturels. Les impératifs économiques,
en général, et financiers, en particulier, ont rendu
le cloisonnement impossible. On note un retrait de Mac sur les systèmes
pré-presse ou professionnels. On note également un
renversement des flux, une appropriation de l'outil et une démocratisation
de la technique. De manière bourgeonnante, le monde arabe
se met à produire du contenu. Les professionnels arabes trouvent
des emplois sur le terrain, quitte à aller d'un pays à
l'autre. L'outil est largement plus présent. Même des
analphabètes peuvent utilisent les chats (sauf dans certains
pays comme la Libye). Cela est comptabilisé sur la bande
passante et fait partie des flux, ce qui n'est pas le cas en France
(et devrait d'ailleurs l'être, pour que la comptabilisation
soit plus équitable).
Internet et les puissances publiques.
Le développement d'Internet passe par la puissance publique
pour laquelle il serait un "service public". Des dirigeants
plus jeunes arrivent au pouvoir (Maroc avec Mohammed VI, Jordanie
avec le roi Abdallah, Syrie avec Bashar El Assad) et ils ont des
liens directs ou indirects avec les nouvelles technologies.
La censure existe : on trouve des zone sombres dans un paysage en
demi-teintes (Arabie Saoudite, Tunisie, Syrie, ...). Tout n'est
pas interdit en Arabie Saoudite, ou ailleurs, mais le contrôle
policier paraît gagner du terrain, en Egypte notamment (modification
de la charte des cafés internet), au Koweit ou à Bahrein,
où on pratique un renforcement du contrôle des usages,
en particulier vis-à-vis des cafés politiques. C'est
immédiatement devenu un enjeu de pouvoir, comme pour le Minitel.
On trouve néanmoins des politiques de collaboration l'état
et le secteur privé. On remarque, d'ailleurs, que le contrôle
policier se fait sur les nœuds de communication, avant l'accès
des fournisseurs eux-mêmes.
Bilan Provisoire
C'est un désert avec des oasis. Les obstacles sont plus ou
moins insurmontables. On note un retard de l'éducation (que
l'on pourra préciser). Les coûts économiques
sont handicapants (multipliés par certaines décisions
politiques, comme en Syrie avec Cisco et les USA). Les utilisateurs
ont appris à s'appuyer sur un système D "efficace".
Les PC sont surexploités. L'intégration régionale
est faible en termes de marché. Celui-ci existe, mais il
est largement insuffisant.
On note aujourd'hui des signes encourageants. L'arabisation se poursuit.
C'est un signe (les grands s'arabisent, portails, moteurs, grands
médias) et c'est un vecteur (cette technique est sortie de
sa tour d'Ivoire). L'apport démocratique du numérique
commence à jouer un rôle.

Y a t-il une Révolution internet
?
Non sur le plan médiatique, social, économique, politique,
mais Internet est néanmoins un vecteur de mutations profondes
(la massification de l'enseignement supérieur, de 5 à
50% parfois). La massification de la culture, avec un accès
des femmes, et une entrée massive, elle aussi, dans les marchés
de la consommation, La massification de la communication concerne
15 millions de personnes. Al Jazeera est regardée par 50
millions de personnes pour 5 millions sur Internet. Al Arabia se
situe à un tiers de cette audience. La massification de l'information
devient une réalité quand on constate le développement
des médias satellitaires, mais aussi celui d'Internet...
Une question ouverte sur le XXIe siècle
Il y a, en définitive, un balancement dialectique entre cultuel
et culturel. Ce qui revient à placer l'arabité face
à l'Islam. Quel espace politique arabe peut émerger
? Quelle traduction politique la communauté rêvée
arabe va t-elle permettre ? C'est un espace qui sera investi par
les progressistes, mais il l'est actuellement par les plus extrémistes
des religieux ou des nationalistes, avec les conséquences
que nous observons depuis plusieurs années... Quand l'Islam
éclairé investira t-il le Net ?
Enjeux
Sociaux, Culturels et Economiques des technologies de l'Information
et de la communication dans le Monde Arabe
Séminaire
CNRS
Laboratoire de communication et politique
Avril 2005
INFORMATIQUE SANS FRONTIERES •
contact/contact
us •
|
